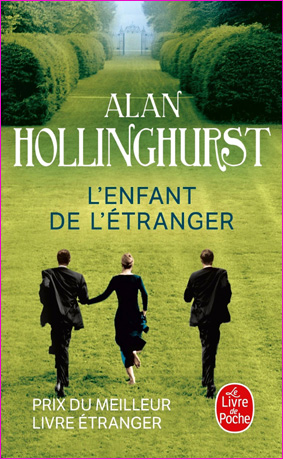
Dès le premier quart du roman, le lecteur se dit que c’est un livre qu’il va relire. Ainsi sont les classiques et il est rare d’un distinguer un au moment de sa parution. L’auteur, né en 1954 et gay, qualifié de « l’un des plus grands romanciers anglais contemporain » en quatrième de couverture, brosse le panorama complet d’un siècle : 1911-2008. Son titre vient d’un poème de Tennyson que les parents de Daphné et de George ont connu brièvement. La scène s’ouvre en 1913, l’évocation de 1911 aura lieu en cours de texte. Elle présente le meilleur de l’aristocratie du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du nord, chef de l’Empire à son apogée. Cette Belle époque, qualifiée outre-Manche d’Edouardienne en référence au roi régnant Edouard VII, a sonné le glas de la race et de la culture anglaise, comme le démontre l’auteur.
Nous saisissons les personnages principaux dans un manoir du Middlesex proche de Londres nommé Deux-Arpents. George Sawle, le fils cadet d’une famille de grande bourgeoisie sans être titrée, invite durant les vacances son ami et mentor Cecil Valance, qu’il connait en première année d’université à Cambridge. Cecil, à 22 ans, est un modèle pour George, 18 ans et plutôt timide qui entretient pour lui un « culte du héros » comme le dira sa sœur de 16 ans, Daphné. Mais nous sommes dans une société masculine, individualiste et aristocratique vouée au modèle grec de l’éducation. George est « choisi » par son « père » Cecil pour adhérer à « la Société » (dite des apôtres) qui est un club secret d’étudiants. On est sensé y « échanger », comme on dit maintenant sans préciser s’il s’agit de seules conversations et d’idées. Cecil, en père viril, l’a « introduit » comme dit joliment George, le mot ayant le même sens ambigu en anglais qu’en français.
Le lecteur comprendra vite combien ces sous-entendus convenables sont en réalité crus : Cecil, durant son bref séjour à Deux-Arpents, contemple, caresse, embrasse, enfourche et sodomise son jeune camarade dans les bosquets, sur la pelouse, au bain, sur le toit… Il multiplie « les galipettes à la manière d’Oxford », comme il le décrit avec humour p.125, il « s’agitait en rythme sur lui » si vous n’aviez pas compris, comme le précise l’auteur p.124. « George raffolait de l’assurance avec laquelle il s’exhibait, même si elle l’effrayait un peu, une frayeur presque agréable » p.123. La jeunesse athlétique de Cecil adore se déshabiller et se repaît de la beauté des jeunes mâles qu’il élit. Une photo resurgie des décennies plus tard le montrera torse nu et musclé sur le toit, près d’un George « la chemise entrouverte, l’air timide mais excité » p.633.
En gentleman, fils de baronnet et diplômé de Cambridge, poète publié, résidant au manoir victorien de Corley Court avec ses plafonds « en moules à gelée », Cecil mène la danse ; ses us et coutumes ont force de loi sociale pour ses pairs comme pour les domestiques masculins dont le jeune Jonah, 15 ans, vigoureusement constitué et qui se méfie des femmes. Ces dernières sont, à cette époque rigide, les gardiennes de la morale et des convenances sociales. Ce pourquoi Cecil joue avec Daphné, la jeune sœur de George ; il la circonvient, la courtise officiellement, lui dédie sur son carnet d’autographes un poème ambigu en fait destiné à George et intitulé « Deux-Arpents ».
Le roman est construit en cinq actes comme une tragédie et montre en un seul siècle la dégradation du paysage, la décadence de la culture et la dépravation démocratique de la morale sur l’île d’Albion.
- La première partie, viride et lumineuse, est l’Arcadie 1913 et la poésie à la Cecil qui déclame « l’amour n’entre pas toujours par la porte d’entrée » p.100.
- La seconde, en 1926, montre les dégâts de la guerre, Cecil tué à 25 ans comme capitaine, George rassis devenu historien et marié à une hommasse historienne comme lui, Daphné mal mariée à Dudley, le frère cadet de Cecil, beau mais pédé comme un phoque, la poésie « de second ordre » récitée par les élèves en classe pour ses évocations de la guerre.
- La troisième partie en 1967 saisit le moment où l’homosexualité est dépénalisée au Royaume-Uni (sauf pour la marine marchande, les forces armées, en Écosse et Irlande du Nord) et où explose la marginalité tandis que le prof à tout enseigner Peter Rowe, diplômé d’Oxford et pédé, n’enseigne justement ni les maths ni la gymnastique, ces piliers de l’éducation grecque antique, montrant ainsi la décadence des collèges anglais. Les garçons, gardés des filles, même en couverture du Docteur No où sévit James Bond, s’embrassent toujours « dès 13 ou 14 ans » sur le toit de la demeure même de Cecil transformée en collège privé. Peter fait visiter à Paul Bryan le jeune banquier pédé la chapelle où se trouve le tombeau en marbre pompeux de Cecil.
- La quatrième partie en 1979 commence à la veille de l’ère Margaret Thatcher et voit un retour à la rigueur moraliste et au déni des « horreurs » (Jonah, 81 ans) du passé. « L’esprit de la fin des années 1970, dans un contexte où tant de choses finissaient par remonter à la surface, (…) « gay » à l’anglaise, c’est-à-dire réprimé – « niable » comme aurait dit Dudley » p.546. Paul Bryan a décidé d’écrire une biographie scandaleuse de Cecil Valance.
- La cinquième et dernière partie, en 2008, la plus courte, achève le portrait des générations gâchées par la ruine des bâtiments, où un enfant de 6 ans brûle les derniers vestiges de la maison vouée à la démolition, l’oubli des poèmes et le culte réduit à quelques spécialistes bibliophiles de Cecil et de sa famille dans une société qui se numérise de plus en plus et lit de moins en moins tandis que les gays se marient officiellement.
La façon d’écrire participe au plaisir du vrai lecteur. L’auteur évoque par allusions certaines choses qu’il ne précise qu’ensuite, plusieurs centaines de pages plus loin, laissant libre d’imaginer avant de se voir confirmé ou non. Ce style rebute beaucoup de lectrices et de lecteurs français, trop rationalistes et pressés de comprendre le foisonnement des personnages et leurs déterminants. Sans parler de la longueur des phrases. Mais c’est justement ce qui fait pour moi le charme d’Alan Hollinghurst : il exige le temps de savourer. A l’époque du fast-food, c’est beaucoup demander et les prix littéraires français montrent combien la longueur et la complexité deviennent étrangers aux rares qui lisent encore aujourd’hui. Raison de plus pour rester entre Happy few.
Si les hommes sont libres au début du XXe siècle en Angleterre, surtout en leur jeunesse, les femmes sont constamment contraintes et ce n’est pas un hasard si l’époque édouardienne a vu l’essor du féminisme. Daphné sait que Cecil était amoureux de son frère George mais a feint de croire qu’il était amoureux d’elle par son poème dédié et dans ses lettres du front. Elle entretiendra cette fiction volontairement jusqu’à ce que sa mémoire soit façonnée à la façon d’Orwell dans 1984, et donnera des entretiens aux biographes en ce sens. « Ce qu’elle ressentait alors ; ce qu’elle ressentait maintenant ; et ce qu’elle ressentait maintenant par rapport à ce qu’elle ressentait alors : voilà qui n’était pas facile à expliquer, loin de là » p.257. C’est ainsi que se construit le souvenir, par la déformation, la sélection, l’idéalisation et le formatage des convenances. « Il exigeait des souvenirs, trop jeune qu’il était pour savoir que les souvenirs n’étaient que des souvenirs de souvenirs. Il était très rare de se rappeler un moment de première main » p.677. L’auteur saisit combien les faits vécus sont racontés, diffusés, remémorés et deviennent des légendes.
Deux-Arpents sera avalé par la grande banlieue de Londres et démolie, ses jardins lotis. Des deux enfants du baronnet, Cecil sera tué à la guerre de 14, son cadet Dudley épousera Daphné mais ne lui donnera qu’un enfant, Wilfrid, qui demeurera célibataire, les deux autres étant les enfants probables de Cecil (Corinna) et de Mark (Jenny), un ami peintre. Car, obsession de l’auteur, son premier mari Dudley comme son second mari Revel étaient gays… La race glorieuse s’éteindra. Du côté de George, son frère aîné Hubert (seulement lieutenant) sera tué également à la guerre et lui-même n’aura pas d’enfant. Tous étaient gay comme l’énumère drôlement l’auteur en fin de volume et aucun n’aimaient les enfants, considérés par eux comme des « gênes » personnelles et sociales. De même que leurs biographes tels Sebastian Stokes, Peter Rowe et Paul Bryan, tous gays, qui ne chercheront qu’à traquer cette manière de vivre dans les lettres, documents, souvenirs et photos rescapées, cachées et peu à peu détruites. La morale victorienne aura eu raison du gentleman et de sa culture. Le dernier descendant mâle du côté de Daphné, Julian, adolescent magnifique à 17 ans, finira marginal dans l’après-68. Les dernières parties voient les biographes pacsés avec un Noir ou un Chinois tandis qu’un Indien, étudiant fasciné par les gays, passe en conférence.
Tout un univers disparu qui fascine aujourd’hui, raconté comme si la reconnaissance du désir grec avait précipité l’Angleterre dans le grand mix d’une modernité où les différences disparaissent.
Prix du meilleur livre étranger 2013
Alan Hollinghurst, L’enfant de l’étranger (The Stranger’s Child), 2011, Livre de poche 2018, 767 pages, €8.90 e-book Kindle €9.99



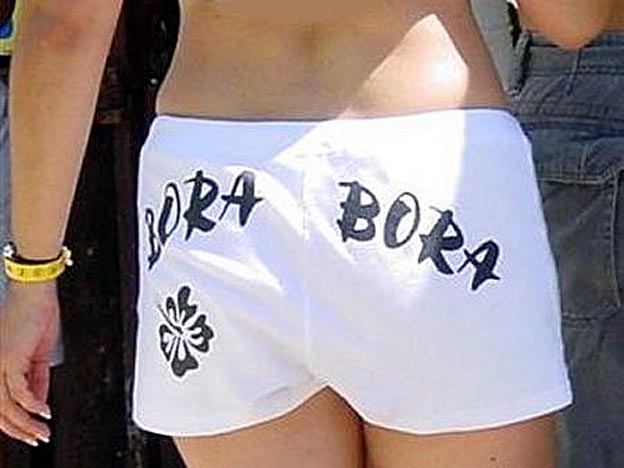
Commentaires récents