Pierre Boulle est surtout connu pour La planète des singes, roman duquel a été tirée toute une série de films, sans parler de la télé ; il est aussi connu pour Le pont de la rivière Kwaï, qui a été célébré au cinéma. Les jeux de l’esprit sont une curiosité. Ingénieur à l’imagination vive, Pierre Boulle s’était décentré en orient, d’où il avait une vision plus globale du monde qu’à Paris. Il propose dans ce roman de science fiction pas moins que de refaire le monde au début du XXIe siècle.
Nous y sommes et rien n’est venu de ce qu’il pensait possible cinquante ans auparavant, lorsqu’il a publié son roman après le grand bazar de 1968 dans le monde entier (mais oui, pas qu’au Quartier latin!). Il met en scène des savants, tous prix Nobel dans leur spécialité, qui mûrissent le projet d’un gouvernement mondial dirigé par des gens compétents, avancés dans le savoir. Mélange de saint-simonisme et de platonisme selon La République, ils ne veulent cependant pas former une nouvelle caste mais épousent la méritocratie à la française qui est celle du concours. Des savants volontaires, présélectionnés sur leurs titres, devront passer une série d’épreuves comme en écoles de commerce. L’ultime sélection des cinq planchera en finale sur un projet de gouvernement mondial.
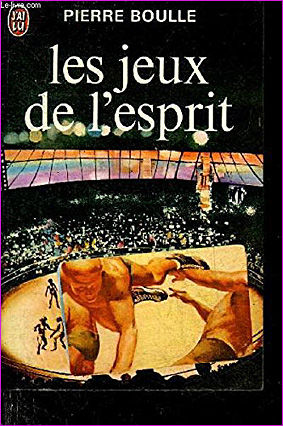
L’un d’eux l’emporte – Fawell l’Américain. Il est physicien puisqu’à l’époque le nucléaire et les mystères des particules forment la pointe la plus avancée du savoir. Le second lauréat est double : Yranne, un mathématicien français (nous avions les meilleurs) au curieux nom et une Chinoise (américanisée), Betty Han, qui a commencé à étudier les sciences avant de bifurquer vers la philosophie puis la psychologie. Ce trio va gouverner le monde, surveillé par le sénat des Nobel.
Tout se passe bien, ce qui est étonnant, même les peuples en ont assez de leurs dirigeants incompétents et parfois corrompus (ce n’est pas nouveau), mais aussi des querelles de bac à sable nationalistes (ce qui est plus étrange). La fin des années soixante était à l’optimisme et à l’internationalisme, la morale était universelle et les religions ne comptaient pas, reléguées dans la sphère privée comme il se devrait. Pierre Boulle ne les évoque même pas. Pour marquer les esprits, un hymne mondial est créé, fait de bouts d’hymnes nationaux, et un drapeau mondial, blanc avec une femme à poil dessus (la vérité sortant du puits). Car la Science est reine et l’administration des choses, centralisée au niveau global (comme dans l’URSS de l’époque, encore triomphante), devrait rationaliser et engendrer des économies comme un surplus de bien-être égalitaire.
Sauf que, quelques années plus tard, la planète s’ennuie (comme la France de 68 vue par Viansson-Ponté au Monde quelques mois avant « les événements »). Les gens, ayant tout le confort, ne sont plus motivés. Ils n’aspirent à rien et l’aisance matérielle ne leur suffit pas. La spiritualité est absente, même si les horoscopes et l’astrologie les intéressent encore, le sexe est gommé (l’auteur, né en 1912, n’a pas fait siens les débordements de libido pré et post-68). Des pilotes se retrouvent même incapables de décision au moment crucial aux commandes de leur avion ; ils ne savent plus prendre d’initiative, se confiant aux robots. Cette anomie un brin mystérieuse, comme l’augmentation du taux des suicides, fait réagir le gouvernement. Comment inverser la tendance et rendre du goût à la vie ?
Betty la psychologue a une idée : il faut les divertir. Comme à Rome le pain et les jeux allaient de pair, laissant les sénateurs gouverner en paix, instaurons des jeux. Sauf qu’il faut que ces jeux soient autre chose que ces compétitions de midinettes d’avant, où seule la xénophobie des supporters de chaque équipe mettait du piment. Il faut que ce soient de vrais combats où la mort est au bout – à moins que ce ne soit la gloire. Rien de tel qu’un catch à poil entre hommes et femmes par équipes mixtes pour susciter l’enthousiasme. Les corps plastiques se mettent en valeur, les coups engendrent la souffrance et le plaisir sadique du voyeur, le sang qui gicle et enduit les peaux est d’une somptuosité barbare, tout comme les cris et grognements des combattants. Mais le catch finit par lasser. Il en faut toujours plus… On reconstitue in vivo les grandes batailles du passé, Trafalgar, Waterloo, le Débarquement. Les équipes (uniquement des volontaires) sont plus nombreuses et doivent s’organiser elles-mêmes pour leurs armes et leurs positions ; seule règle : les armes d’époque peuvent être améliores, mais seulement avec les techniques connues à l’époque. Gagnera qui sera le meilleur, pas comme dans la vraie histoire. C’est grandiose, la télévision est incluse et se poste aux endroits stratégiques pour des plans spectaculaires. Les vaincus sont tous tués évidemment.
La planète est heureuse… mais tout ça pour ça ?
Eradiquer les nationalismes pour rationaliser la production sans épuiser la planète, quatre milliards d’habitants seulement autorisés et le contrôle des naissances installé, l’utopie de favoriser la connaissance par l’éducation de tous et la recherche fondamentale de quelques-uns – tout cela réduit à organiser des jeux de guerre comme de vraies guerres et à détourner les savants du fondamental pour inventer de nouvelles techniques pour tuer et améliorer la prévision sur les paris ?
La morale de ce conte philosophique est probablement qu’il est vain de vouloir « changer le monde » ; les gens sont tels qu’ils sont et rien n’y fera. Ils seront toujours avides et égoïstes, moins férus de connaissance que de divertissements, toujours volontaires pour gagner, même si c’est pour se faire tuer. Ce n’est pas un grand cru Boulle, mais une curiosité – intéressante à lire un demi-siècle après.
Pierre Boulle, Les jeux de l’esprit, 1971, J’ail lu 1972, 307 pages, occasion €17.00

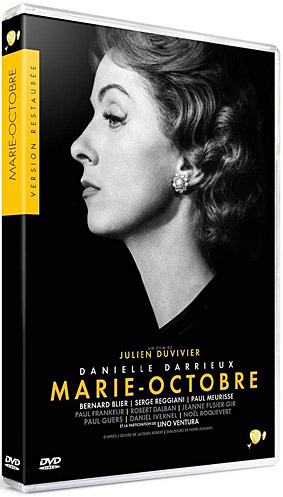






Commentaires récents