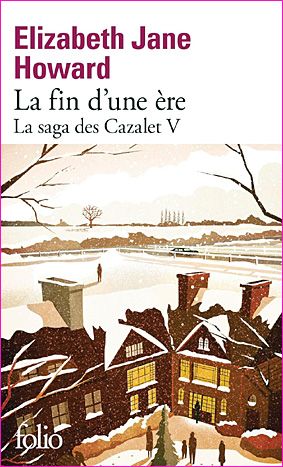
Dernier tome de l’histoire de la famille anglaise des Cazalet sur quatre générations, depuis la guerre de 14 à l’orée des années soixante. Écrit dix-huit ans après le tome précédent, ce volume porte sur les années 1956-58. L’auteur effectue une coupe stratigraphique de la famille, prenant à poignée chacun des membres de cette lignée prolifique.
Si le couple initial du Brig et de la Duche (nés dans les années 1860) ont eu quatre enfants, leurs garçons en ont eu de deux à quatre, leur fille Rachel restant célibataire, dévouée aux autres et affectivement lesbienne (faute de mieux). Les douze petits-enfants sont adultes et ont eu eux-même sept enfants… ce qui porte la famille à un nombre multiplié. De quoi se perdre dans la généalogie (heureusement rappelée dans l’arbre généalogique en début de volume – sauf Georgie, oublié semble-t-il), et un défi pour l’écrivain. Comment rendre compte de chacun dans cette inflation exponentielle ?
Déjà écrire sec et court, effet de l’âge qui simplifie (l’auteur a 89 ans, elle décèdera l’année suivante, mission accomplie), avec parfois une chute étonnante, comme dans une nouvelle. Ensuite couper des tranches annuelles pour balayer large. Enfin regrouper les îlots familiaux pour évoquer chacun, et les pièces rapportées. Cela donne un livre pudding, comme les Anglais les aiment, avec beaucoup de fruits confits dans la pâte dense, et une longueur en bouche qui en fait le charme. A déguster avec un excellent whisky, cela va de soi.
La Duche finit par mourir, deux ans après son mari. La famille a perdu la tête. D’ailleurs l’entreprise, mal gérée par les fils amateurs, périclite de plus en plus. En conservateur bon teint, Hugh l’aîné tergiverse, procrastine, il n’ose pas trancher dans ce que son père a bâti. C’est le drame du conservatisme que de « croire » que tout va s’arranger en surtout ne faisant rien. Le libéral, à l’inverse, suit le mouvement et l’épouse. C’est le conseil de Joseph, amant marié de Louise, qui est banquier : il faut vendre une partie de l’immobilier pléthorique de la firme et rembourser les dettes pour présenter un bilan attractif, puis ouvrir le capital. De l’hébreu pour les hommes formés à Eton et Cambridge ou Oxford avant la Première guerre. Donc tout s’écroule : l’empire comme l’entreprise, Home Place et la famille.
Tout change (titre anglais) et une nouvelle ère commence (titre français). Elle ne sera plus familiale dynastique, mais individuelle et réduite aux couples nucléaires. L’auteur, qui est de la génération des petits-fils, aura disparue et les swinging sixties bouleverseront les mœurs, l’économie et les mentalités. Avant l’ère numérique, et de la mondialisation malheureuse. Ce sera une autre histoire, écrite par Georgie, fan d’animaux avec un rat dans la poche et un python autour du cou, à même la chair sous le foulard ; ou Roland, fan de bricolage électronique ; ou les jumeaux rapportés Tom et Henry, heureux de vivre du moment qu’ils sont à deux ; ou Jane et Eliza, jumelles de pas encore dix ans qui vivront 68 ; ou d’Harriet, Bertie, Andrew un peu plus jeunes ; sans compter le gros bébé Spencer qui n’a encore qu’un an.
Home Place, achetée dans les années vingt comme maison de campagne familiale par le couple fondateur, est évacuée : elle a été achetée sur les actifs de l’entreprise et sera liquidée avec elle. C’était l’époque où l’entrepreneur confondait volontiers ses biens propres avec ceux de la firme. Heureusement, les notaires ont conseillé de mettre les résidences principales au nom des épouses, ce qui empêchera d’emporter dans la tourmente les biens personnels. Rachel, restée seule dans la maison de famille après la mort de Sid d’un cancer, n’a plus rien : ni Home, ni parts d’entreprise, ni salaire puisqu’elle n’a jamais travaillé, ni enfant puisqu’elle est restée vierge victorienne. Elle est le symbole, avec Hugh qui connaît sa première crise cardiaque, de la chute de la maison Cazalet. La petite dernière de la Duche et du Brig, comme l’aîné des fils, ont failli faute de s’adapter. Le monde change et pas eux, confits en mœurs surannées et en principes qui n’ont plus court ; n’osant surtout pas prendre une initiative quelconque.
Les autres se débrouillent tant bien que mal, Edward s’associant avec Archie pour réduire les coûts et tenter de fonder une école d’art ensemble, se remettant à peindre ; Simon se découvre la vocation de pépiniériste, et une sensualité homosexuelle avec un aide-jardinier au beau corps, fils de prisonnier italien ; Neville papillonne avec ses mannequins, après avoir été amoureux de sa (demi) sœur de 15 ans, il réussit en photographie ; Clary, après avoir pondu plusieurs romans et quatre gosses, écrit une pièce intime à succès, fondée sur sa propre expérience des passions ; Teddy, après avoir engrossé une servante irlandaise qu’il a aidé à avorter, a rencontré une fille unique égoïste et gâtée à la mère snob avec laquelle il va rompre après expérience, il va se retrouver au chômage après la faillite de la maison Cazalet – il a trop tendance à prendre ses désirs pour des réalités.
Un dernier Noël réunit toute la famille à Home Place avant la vente, sur l’initiative de Rachel. Même Diana, seconde épouse d’Edward, passe boire l’apéro, malgré la présence de Villy la première femme, et de Roland, fils délaissé de son père trop lâche. Diana se révèle comme une égoïste qui a mis le grappin sur un homme faible qu’elle croyait riche – elle déchante. Tout le contraire de Clary, qui a épousé l’ami de la famille Archie et s’en trouve épanouie, ou Polly qui a rencontré le pas beau mais doux Gerald. Il y a malgré tout une justice immanente.
Une belle fin pour la saga qui a des relents biographiques, Elisabeth Jane étant fille d’un négociant en bois et d’une danseuse de ballet qui a renoncé à sa carrière après mariage – comme le Brig et la Duche. Elle a été mariée de 1965 à 1982 à l’écrivain Kingsley Amis dont le fils Martin Amis est devenu écrivain à l’aide de ses conseils.
Elisabeth Jane Howard, La fin d’une ère – La saga des Cazalet V (All Change), 2013, Folio 2024, 677 pages, €10,40, e-book Kindle €16,99, livre audio (avec abonnement : 3 mois €0,99 puis €9,95 par mois)
(mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés Amazon partenaire)
Les autres tomes de la saga des Cazalet déjà chroniqués sur ce blog

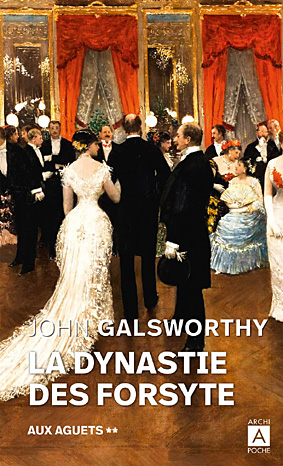
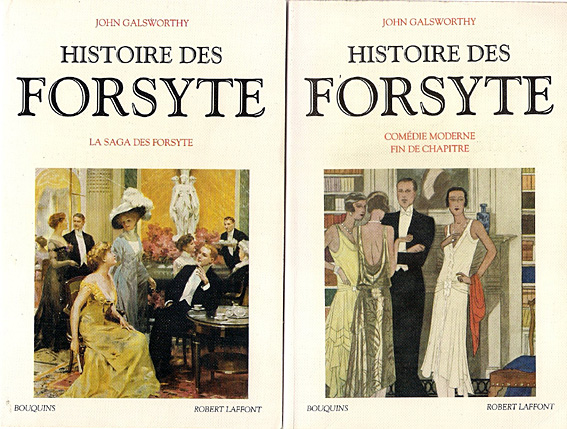
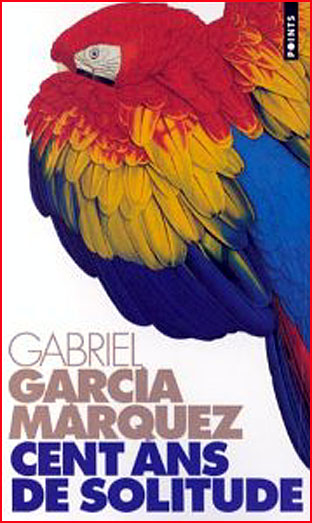

Commentaires récents