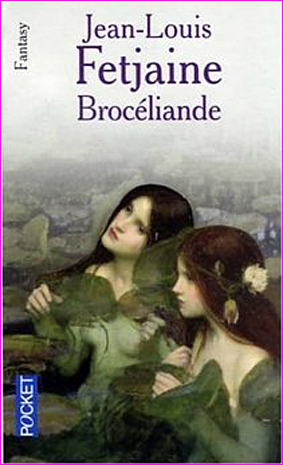
La suite du Pas de Merlin, chroniqué sur ce blog. Le jeune prince Emrys Myrddin, fils de la reine Aldan, doit fuir la grande Bretagne ravagée par la guerre durant la conquête de l’ouest des Saxons sur les Bretons. Il s’embarque avec le moine Blaise, ex-chapelain de la reine sa mère, qui l’a mandaté pour protéger son fils.
Sur le coracle qui transporte les réfugiés, les trois marins sortent leurs coutelas ; ils vont égorger les migrants pour s’emparer de leurs biens. Par son regard et son agilité, Merlin les met en déroute, aidé du guerrier Bradwen qui rejoint la petite Bretagne pour s’y tailler une place. La brume, la volonté et la rapidité de l’action effraient les paysans ignares qui croient à la sorcellerie, ce pourquoi Merlin et son moine sont dénoncés au seigneur du lieu, l’île de Batta, ancien nom de Batz.
Les évêques, convoqués par le comte de Leon Withur, ont à juger du moine, accusé d’hérésie car il croit en la bonté de Merlin, enfant non baptisé, qui ne peut « donc » (soulignez bien cette manifestation de sectarisme) bénéficier de la grâce divine. Pourtant, Dieu n’est-il pas le créateur de toutes choses ? De tous les êtres ? Y compris le diable ? Blaise est excommunié et condamné à se racheter en fondant sous les ordres du moine Méen un monastère aux marges de la grande forêt celtique qui couvre le centre de la Bretagne. Merlin, lui, s’évade avec l’aide de Bradwen, un soir de brume épaisse sur les marais de Yeun Elez, infesté selon les superstitions de farfadets, korrigans, lutins, fées, elfes et poulpiquets, créatures du diable comme chacun croit savoir.
Les chemins de Merlin et de Blaise se séparent. Bradwen est éliminé par les fines flèches des elfes, une fois dans la forêt, au grand dam de Merlin, fils d’elfe lui aussi, qui en avait fait son ami. Il se retrouve maîtrisé d’une pression sur la veine du cou, déshabillé, couché dans un berceau de fougères. Il dort deux jours, épuisé, avant de se lever, toujours nu, et de scruter la forêt au seuil de son berceau. Il est né à nouveau, chez lui, dans le domaine de son père Morvryn, un elfe qui a aimé la future reine Aldan au point de lui faire un fils.
Merlin fait donc connaissance de son peuple, son grand-père Gwydion, sa demi-sœur Gwendyd qui va toujours nue, les elfes en tunique ou sans rien qui se fondent entre les feuilles et se confondent avec les souches ou la mousse – ce pourquoi un œil humain ne les voit pas. Il apprend la langue elfique, où son nom est Lailoken ; il joue avec les enfants tout nus ; il est initié par les fées des arbres qui tracent sur son corps des runes oghamiques. Puis il se fond dans les éléments durant des mois, étant tour à tour eau, poisson, loutre, daim… Car le peuple des elfes est immergé dans la nature, il ne fait qu’un avec elle – contrairement aux chrétiens, dont le Dieu sépare radicalement l’esprit de la matière, ordonnant à ses créatures humaines d’être maîtres et possesseurs de la nature.
Mais son passé humain, trop humain, rattrape Merlin. Cylid, le serviteur breton de la reine Guendoloena, devenu libre, a hésité longtemps avant d’accomplir la dernière mission : avertir Merlin que son fils est en danger. Treize ans ont passés et Cylid se met en route pour traverser la Manche et rejoindre la petite Bretagne où Blaise est confiné. Juste avant de mourir, il lui demande d’alerter Merlin. Blaise s’enfonce dans la forêt, manque d’être dévoré par les loups, mais Gwendyd la chef de meute, sœur elfe de Merlin, les en empêche in extremis.
Merlin retrouve son moine et entreprend avec lui la traversée vers Dal Riada, où règne son mari Aedan Mac Gabran, le roi des Scots. Mais il est trop tard : le jeune Arthur, fils de Merlin et bâtard d’Aedan, a été adopté par lui comme son fils et traité comme les autres. Son demi-frère aîné Garnait le hait, comme il hait sa marâtre Guendoloena, un peu plus jeune que lui, qui lui a ravi son père. Dans la guerre qui se prépare, il confie à Arthur, 13 ans, un commandement dans l’armée, et se garde bien de se porter à son secours lorsqu’il est pris au piège. C’est le destin historique d’Arthur que de mourir vers 537 à la bataille de Camlann.
Merlin le pressent. Il n’a plus rien qui le retienne, sauf la vengeance envers Ryderc, le roi trop faible, qui se croit roi suprême de tous les Bretons mais est incapable d’obtenir une victoire contre les Saxons. Il se rend à son fort au-dessus de la Clyde pour lui ravir son torque, que le roi Guendoleu avait confié personnellement à Merlin pour le donner au plus valeureux des rois bretons. Ryderc en est indigne. Merlin s’élance en haut de la tour et jette le bijou d’or dans la rivière. Ryderc, fou de rage le tue d’un lancer d’épieu et Merlin meurt empalé, pendu, noyé, comme il l’avait prédit, par l’épieu qui lui a transpercé le corps, le filet sur lequel il est tombé qui l’a étranglé, et l’eau de la Clyde dans laquelle sa tête a plongé.
Fin de l’histoire, un peu rapide. L’auteur conclut, « mais c‘est ainsi que s’achève l’histoire de Merlin, fils et père d’Arthur, ni vraiment fils ni vraiment père, dont on dit que l’âme vit toujours en Brocéliande auprès de Gwendyd. » Intéressante fantaisie historique, proche des faits avérés par les textes, mais qui laisse sur sa faim.
Jean-Louis Fetjaine, Brocéliande, 2004, Pocket Fantasy 2006, 335 pages, €2,14, e-book Kindle €12,99
(mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés par amazon.fr)

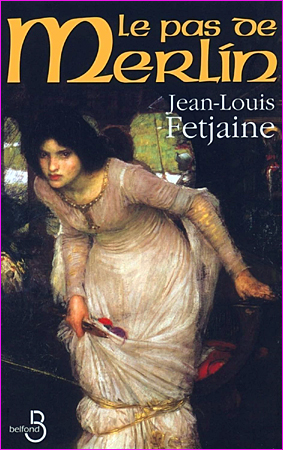
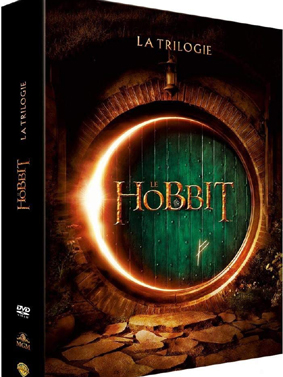








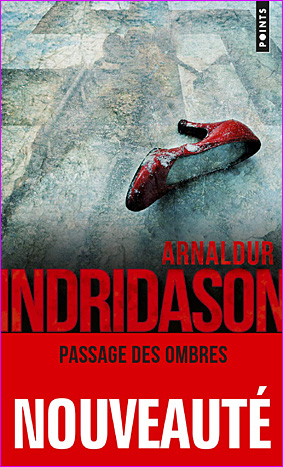








Commentaires récents