Aujourd’hui est la « journée supplémentaire » gratuite et non prévue, en raison des changements d’horaires de la compagnie de charter pour le retour. Nous sommes libres d’aller et de venir, ce qui est un vrai luxe après deux semaines de groupisme forcé.
Nous partons à quatre de l’hôtel Kohly, peu après 9h, à pied vers le centre-ville. Nous prenons la 42ème rue jusqu’à la 5ème avenue (on se croirait à New-York) afin de voir de plus près les vieilles maisons coloniales rénovées qui servent aujourd’hui majoritairement aux ambassades. Nous passons devant Big Ben, l’horloge. Puis devant les ficus centenaires de l’église Santa Rita moderne, au toit en barque renversée. Nous passons le fleuve Almendares par le tunnel routier. Nous voici, de l’autre côté, sur le Malecon.
Le restaurant « 1830 » propose son chic cossu. Quelques pêcheurs noirs, désœuvrés, traquent le pescado sous la tour. Ils regardent le large, inaccessible à ceux qui n’osent pas se lancer. Nous suivons la promenade du front de mer jusqu’au bout de ses huit kilomètres. Les grands immeubles récents précèdent les façades délabrées, rongées, la suite s’étant parfois carrément écroulée. Plus on se rapproche du centre, plus les immeubles sont décrépits. Plus l’heure avance vers midi, plus on rencontre de monde. Les Jineteros, dragueurs de femmes et de touristes de tous sexes, tentent d’engager la conversation pour gagner quelques dollars. Nous ne sommes pas des clients pour leurs sourires aux dents blanches aiguisées. Il s’agit le plus souvent de jeunes, des collégiens aux universitaires, avides de gagner quelques dollars sans s’investir physiquement. La version femme draguant les touristes mâles est plus rare, du moins en ce jour et à cette heure.
Nous prenons une bière glacée peu après l’église Immacolada. Des lycéens reconnaissables à leur pantalon moutarde et à leur chemisette blanche ouverte par la chaleur, y déjeunent d’un sandwich et d’un cola local. Ils sont hâbleurs, rigolards et chaleureux. Ils parlent avec tout le corps, ponctuant leurs phrases de grands gestes de la main. Un jeune Noir de treize ans se dandine en balançant les épaules comme il l’a vu faire à la télé américaine. Il aborde une table voisine comme un homme, serrant la main des diplomates noirs qui prennent l’air important et enflent la voix dans leurs téléphones portables quasi inexistants ici.
La serveuse aux yeux bruns qui nous sert les bières bat des cils et suce ses lèvres pulpeuses par réflexe, tout en me parlant espagnol. Elle drague inconsciemment tout touriste qui passe, porteur des précieux dollars. Au sortir du bar, une fille étroitement moulée dans un body qui fait ressortir sa poitrine d’obus, me susurre des bruits de baisers. Marie-Jo : « c’est pour toi, ça ? ». Je crois bien que oui.
En suivant la mer, des garçons à peine sortis du primaire ont retiré leurs vêtements pour jouer sur les rochers, sous la promenade. Les embruns les rafraîchissent parfois, à leur grand plaisir, mais leur jeu consiste à lancer de petits galets à deux de leurs copains restés habillés sur le Malecon. Ceux-ci ripostent en ramassant les projectiles envoyés et l’un des slips se tord de douleur pour avoir pris un galet directement dans les couilles. Les vêtus rient de cette bonne blague – macho cubaine type. Au bout du Malecon, des 14 ans en caleçon rivalisent de pompes sur le ciment, deux à deux. Ils se lancent des défis à qui en réussira le plus, pieds nus sur le béton brûlant. L’air salin émoustille leurs jeunes forces. Passent des filles portant encore ces nichons qui vous sautent à la gueule, à peine contenu par un boléro minimum. Ces poitrines afro-ibériques sont presque inexistantes chez nous où sévit la mode anorexique sur le modèle protestant.
Le musée révolutionnaire, devant lequel nous passons, est sur le point d’avaler sa cargaison de petits en foulards rouges, tel un ogre. Sur un côté du bâtiment, pieds nus sur la pelouse, un douze ans en débardeur exécute tout seul des roues et des soleils, des sauts avant et des retournements arrière. Quand il me voit le regarder, il en refait une série pour se faire admirer. J’applaudis en silence, battant des mains sans les claquer. Il me fait un signe. Il faut bien que s’use toute l’énergie de la jeunesse.
Nous suivons l’avenidad de las Misiones jusqu’à la calle de Obispo. En nous voyant regarder le plan, les gens sont obligeants et nous aident. Nous cherchons la cathédrale ? Facile. Nous retrouvons les rues à touristes ; ils y sont agglutinés comme à Venise, sans jamais quitter ces artères où se retrouvent leurs semblables. Nous passons un bâtiment vert pistache portant l’inscription « Cruz Verde », puis devant la pharmacie Taquerel, que nous a montré Sergio hier, avec ses alignements de bocaux antiques, l’hôtel d’Hemingway, pour aboutir Plaza de Armas, devant « le » restaurant conseillé dans tous les guides, Routard et Lonely Planet compris (sauf dans le guide illustré Gallimard) : La Mina.
Son patio nous attend pour le déjeuner. Les clients ne sont que des touristes – aucun cubain (trop cher ? trop surveillé par la police du régime ?). Des musiciens placés en angle jouent trop fort, des paons en liberté et quelques poules se promènent en grappillant des miettes entre les tables. Le décor est « touristique » en diable, outrageusement touristique, mais reconnaissons que l’on y mange bien. Après un mojito, le plat de porc grillé aux crevettes est très bon. Nous nous en tirons pour 22$ chacun quand même, avec eau minérale et café. Ici, les dollars filent vite, déjà 335$ dépensés depuis le début du séjour, y compris la taxe d’aéroport réservée pour le départ.
En sortant, je veux voir le musée juste en face. Devant est une ruelle aux pavés de bois, fraîchement retraités au goudron. C’est un beau bâtiment au large patio ombré de palmiers et de kapokiers. Nous payons trois dollars pour y avoir accès. Il s’agit du palais des gouverneurs généraux, « Los Capitanes Generales », qui sert aujourd’hui de musée d’histoire de la ville. L’architecte de ce palais élevé en 1791 a un nom qui emplit pleinement la bouche : Antonio Fernandez de Trebejos y Zaldivar. Le bâtiment a servi d’Hôtel de Ville de 1921 à 1967. La cour centrale, carrelée de noir et blanc, a des arcades qui éclairent des salles disposées en pourtour où sont exposés les vestiges de l’histoire de la cité. Des carrosses, des cuivres, des marbres 19ème imitant l’antique, des restes de monuments funéraires et des objets du culte de l’ancienne église, détruite, emplissent les premières salles du rez-de-chaussée. Un bas-relief funéraire serait « le plus ancien vestige colonial conservé à Cuba » : une face d’ange joufflu surmonte une croix posée à l’intérieur d’un temple à quatre colonnes. Il avait été érigé dans l’église paroissiale de La Havane, détruite lors de l’explosion du vaisseau Invencible au 18ème siècle. Il commémorait l’endroit où une jeune fille de la noblesse avait été tuée par un tir d’arquebuse accidentel. Une statue de Christ « de l’Humilité et de la Patience » ornait, au 18ème siècle, le couvent Santo Domingo ; elle a échoué ici, offrant un corps nu, percé, souffrant, ascétique, tout à fait dans le style tourmenté du catholicisme doloriste espagnol. Saint Matthieu et Saint Luc, en bois, viennent de l’église San Juan de Latran, du 18ème. À l’étage, des « ambiances » reconstituent des salles d’époque au mobilier luxueux et à la vaisselle importée. Une salle de bain aux baignoires de marbre et aux pots de faïence, le Salon du Trône, la salle des glaces où l’Espagne a rendu le pouvoir aux États-Unis lors de la première guerre d’indépendance de Cuba le 1er janvier 1899. Une salle des Drapeaux sacrifie au nationalisme pompier tandis qu’un immense tableau présente le général Antonio Maceo agonisant le 19 mai 1895 dans un champ, sur fond de palmiers. Un canon artisanal en bronze, renforcé de tresses de cuir, date de la lutte pour l’indépendance en 1869.
Une salle aux fenêtres voilées renferme quelques peintures locales modernes. Je note un tableau de Cosume Prenza Almaguer de 1948, Cecilia, d’un lyrique achevé. Les plis et les ombres se multiplient comme sur une façade baroque ; loin de se fondre dans l’ensemble ils prennent toute leur place. La personnalité de la jeune fille ainsi peinte apparaît sophistiquée et tourmentée ! Un autre tableau de José Braulio Bedia Valdès, de 1959, présente El hijo – le fils – des jambes et un ventre d’enfant nu sur les genoux de sa mère dont on ne voit que ce détail. Du sexe du fils part une étoile filante, vers une planète dont le signe zodiacal figure Saturne. À l’emplacement du sexe de la mère est figurée une lune, lourdement symbolique. Le tout est en traits blancs sur fond bleu nuit.
Dans une autre salle, à laquelle on accède par un escalier, est installée une exposition contemporaine du peintre Pastor Perez Rodriguez. De loin, les tableaux figurent des bâtiments de la ville, la nuit, dans des couleurs éclatantes. Cela n’a guère d’intérêt croyez-vous ? Approchez-vous et regardez de plus près : des couples d’anges mâles et femelles sont installés sur les balcons, dans les chambres aux fenêtres ouvertes, sur les toits, dans les recoins sombres des trottoirs – et ils copulent allègrement ! Certains planent au-dessus de la ville, comme des rêves érotiques non encore incarnés. C’est étrange, drôle et séduisant – une figuration surréaliste.
Nous nous rendons ensuite au septième et dernier étage de l’hôtel Ambos Mundos, cher à Hemingway, pour prendre vue sur la ville. De la terrasse, nous voyons surtout les toits. La chambre du Maître existe, au cinquième étage, elle se visite sur demande, mais elle n’a plus guère d’intérêt. La machine à écrire exposée n’est pas la sienne et la vue qu’il avait est masquée par des immeubles récents !


















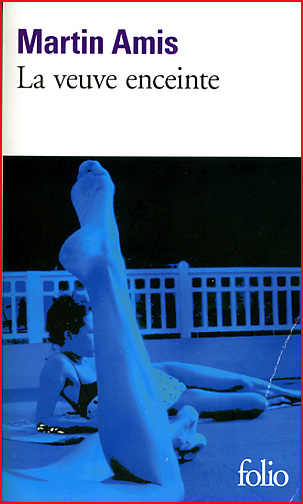

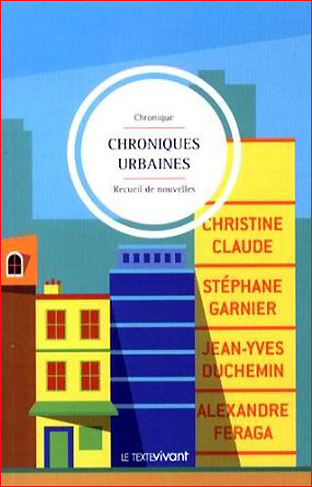
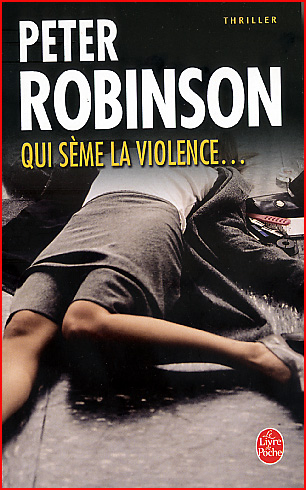
Commentaires récents