Auguste Mouliéras, professeur de la chaire publique d’arabe d’Oran vers 1890 parle l’arabe littéraire et l’arabe vulgaire, ainsi que le berbère. Ses cours d’arabe pour les Français sont encore édités. Il compose une encyclopédie anthropologique sur le Maroc. Il utilise notamment les 23 années d’enquête du derviche Mohammed ben Tayyeb, un voyageur kabyle né en Tunisie, taleb passionné, parti étudier sur les routes dès l’âge de dix ans. Il a vérifié avec des centaines de Marocains les indications de son guide à la mémoire prodigieuse.
Mouliéras est animé d’un optimisme des Lumières sauce saint-simonienne bien loin de la mission civilisatrice des coloniaux à la même époque, sans parler des évangélistes catholiques. Il évoque « la grande Association universelle et fraternelle qui transformera un jour notre planète en un vaste atelier de charité, de paix et de travail » p.786. Bien que non exempt de préjugés de son époque, notamment sur les Juifs qui vivaient au Maroc, l’auteur est attentif aux témoignages bruts et au compte-rendu d’observations sans jugements des habitants eux-mêmes.
 Le second tome de son œuvre sur ‘Le Maroc inconnu’ décrit les mœurs des Djebala, ces montagnards du Rif marocains, Berbères islamisés. Par exemple le mariage au village :
Le second tome de son œuvre sur ‘Le Maroc inconnu’ décrit les mœurs des Djebala, ces montagnards du Rif marocains, Berbères islamisés. Par exemple le mariage au village :
« A son arrivée à la déchra d’El-K’alaâ, le derviche eut la satisfaction de tomber sur une noce arabe, la propre noce du caïd de la tribu. On attendait justement la fiancée, qu’un détachement de 200 hommes armés était allé chercher au village voisin. Dans le lointain, de sourdes détonations annonçaient le retour du cortège nuptial. Tout El-K’alaâ était dans.la banlieue, en habits de fête, attendant impatiemment la nouvelle mariée.
Au bout d’une heure, on vit s’avancer, voilée de pied en cap et montée sur une mule, une petite poupée blanche qui pouvait avoir une douzaine d’années. Autour d’elle, les feux de salve crépitaient, effrayant sa monture, dont les brusques écarts entraînaient, pendus à la bride, les deux hommes qui la maintenaient. On vit soudain des femmes, les parentes du caïd, courir vers la poupée, l’emporter pantelante dans la maison conjugale, pendant que les guerriers restés dehors continuaient l’infernale fusillade. Les cris déchirants des hautbois arabes, les coups profonds et répétés des grosses caisses éclataient à leur tour, pendant les intermèdes.
Dans la riante contrée des Djebala, les mariages se font généralement en automne, époque de l’année où tout est en abondance, même dans les plus humbles chaumières. Avec l’inflexible loi coranique, il ne faut pas s’attendre à trouver chez les disciples du Prophète la douce poésie des fiançailles de nos-pays d’Occident. Très souvent, l’homme épouse une femme ou une jeune fille qu’il n’a jamais vue. Sa mère, ses sœurs l’ont renseigné à peu près sur le physique de celle qui doit venir s’asseoir à son foyer, et cela lui suffit. La question importante, c’est le douaire. Achetant sa femme, il entend ne pas la payer cher. C’est une affaire commerciale à débattre, comme s’il s’agissait de la vente d’une bête de labour, d’un animal de boucherie. La demande se fait selon des règles fixes, dans le cérémonial. Accompagné de plusieurs notables de son hameau, le prétendant arrive au domicile de celle dont il sollicite la main. D’abord, le futur beau-père offre un repas aux étrangers. Il feint d’ignorer le but de la démarche de ses hôtes et il s’entretient avec eux de choses banales. Quand le thé est servi, le plus distingué de la députation prend solennellement la parole et s’exprime en ces termes : – Donne ta fille à A conformément à la loi de Dieu et du Prophète.
Tous, en entendant le nom sacré de l’Apôtre, se passent la main sur le visage et la barbe, en prononçant gravement la formule obligatoire – Çalla Llahou àléïhi oua sellama : que Dieu Lui accorde sa bénédiction et sa paix. Ensuite le père répond – Voici mes conditions. Et il énumère la dot, le trousseau, les cadeaux qu’il exige. S’il est pauvre, il se contente d’une cinquantaine de francs. Mais il en demande 100, 200, 300, 500, et parfois davantage, s’il a quelque fortune. Puis, toutes les questions réglées, il dit, non sans solennité – Elle est à vous.
Cependant le jour du mariage n’est pas encore fixé. Le futur est obligé de retourner chez lui avec ses compagnons pour se mettre en mesure de remplir ses engagements, Il court les boutiques, les marchés, achetant le trousseau, les bijoux, le linge, les vêtements promis. Alors seulement il annonce la grande date et il fait les préparatifs de la fête. Chez lui, la maison est bouleversée. Sa mère, ses sœurs, ses tantes allument les fourneaux, font cuire dans vingt marmites des quartiers de bœuf et de chèvre, préparent le beurre, l’huile, le miel, tous les aliments qui seront dévorés dans l’énorme liesse. Et, à l’époque fixée par l’époux, musiciens, hautbois, grosses caisses et tambourins, font éclater, dès l’aurore, devant la porte du marié, une aubade endiablée.
C’est le grand jour. Le fiancé, peinturé de henné aux chevilles, aux poignets, fait son apparition dans une chambre remplie d’amis. Son burnous blanc le distingue suffisamment de ses camarades qui sont vêtus de djellaba plus ou moins sombres. Il est leur sultan, et eux sont ses ministres, ses ouzara, de véritables vizirs, attachés à sa personne, ayant à remplir auprès de lui un rôle important que nous indiquerons dans un instant. Remarquons, en passant, que les Djebaliens ne portent le burnous que le jour de leur mariage. Chaque hameau a son burnous des noces. Il sert à tous ceux qui se marient et il se trouve en dépôt chez un notable de l’endroit.
Voyons maintenant ce qui se passé chez la fiancée. Aussitôt après le consentement du père, la jeune fille s’abandonne à ses parentes et à ses amies. La première des opérations de la toilette y est celle de l’application du henné aux chevilles et aux poignets. La chevelure est lavée au r’asoul, débroussaillée au peigne fin, emplâtrée de henné. Par-dessus la chemise, on enveloppe la petite poupée de cotonnades, de tissus légers, de h’aïk d’une blancheur éclatante. Chaussée de babouches rouges, voilée des pieds à la tête, elle va en visite chez toutes ses parentes, à tour de rôle. Elle s’y rend avec le cortège de ses amies, et elle est reçue à la porte par les graves matrones qui la saluent d’un joyeux – El-IFamdou llah Mbarek ez-zouaj, in cha Allah : Dieu soit loué Votre union sera bénie, s’il plaît à Dieu.
Introduite dans le gynécée, elle se débarrasse de ses voiles, grignote des friandises, boit du thé, jacasse avec ses compagnes. Celles-ci ne doivent jamais la quitter d’un pas, et nous verrons tout à l’heure pourquoi. Durant sept jours, la mariée fait ses tournées dans le village, fêtée partout, gracieusement et copieusement hébergée. Le septième jour, elle attend l’arrivée de la députation qui doit l’amener sous le toit conjugal.
Ce jour-là, l’animation est grande chez les amis et compatriotes du futur. Ils font leurs préparatifs de départ. Sanglés, habillés comme s’ils allaient au combat, le fusil au poing, ils font marcher devant eux l’assourdissant orchestre des hautbois et des tambours, dont le vacarme ne cesse que devant la demeure du beau-père. Quelques parentes du prétendant suivent la députation et pénètrent seules chez la fiancée, qu’elles sont chargées d’accompagner à sa nouvelle résidence. Pendant ce temps, les hommes du cortège sont reçus chez les proches parents du beau-père où on leur offre un grand repas.
Enfin, somptueusement vêtue, le visage couvert d’un grand voile, l’épousée quitte sa maison au milieu de ses sœurs, de ses tantes, de ses cousines, les parentes de son mari la font monter sur une mule sellée d’un vaste bât, et l’on se met en marche.
Dès les premiers pas, la fusillade commence elle dure, sans interruption, jusqu’à l’arrivée du cortège devant l’habitation de l’époux, avec accompagnement des you-you stridents des femmes et du tapage infernal de l’orchestre. Tandis que les femmes emportent la jeune fille dans sa chambre, le fiancé reste dans la sienne avec ses amis. Il s’est bien gardé d’aller chercher sa fiancée. La peur du thik’af le tient cloué chez lui. Patience! Vous connaîtrez bientôt le thik’af, le grotesque, le ridicule maléfice dont tout le monde a peur au Maroc [sortilège pour rendre impuissant].
Les invités affluent à la tombée de la nuit, et les douzaines de plats de viande, cuite à l’huile, selon la mode djebalienne, les corbeilles de pain, le beurre, le miel, les msemmen, le thrid, les beignets, les fruits, font leur apparition dans les pièces respectives des hommes et des femmes, pendant que des babour de thé se préparent devant l’assistance. Des lampes à huile en terre cuite éclairent la mastication des affamés. Quand tout le monde est rassasié, des gitons et des gitonnes, dans la salle des hommes, exécutent leurs danses, évoluent à travers les épais nuages des pipes de kif. Les musiciens soufflent et tapent sans désemparer, accompagnant successivement les chorégraphes et les épithalames des bardes populaires.
Au dehors, la fusillade pétarde sourdement, en un roulement lointain de tonnerre. Ce sont les jeunes, les impatients, ceux qui n’ont pu supporter l’immobilité, après les formidables agapes, qui vont ainsi se dégourdir les jambes, rire, causer et décharger en plein air leurs fusils bourrés jusqu’à la gueule. Et, jusqu’à l’aurore, les mêmes réjouissances se poursuivent de cette manière, sans la moindre variation, telles qu’elles devaient être dans le cours lointain des âges.
 Revenons au marié. Le premier soir, au crépuscule, il sort de sa chambre, fausse compagnie à ses vizirs, et il entre, armé d’un fusil, dans la pièce où ces dames tiennent société à celle qu’il considère comme sa proie, sa chose à, lui. A la vue du mâle, la nichée féminine s’envole, le laissant en tête-à-tête avec sa fiancée. Entre ces deux êtres qui se voient pour la première fois, la conversation n’est pas longue. Saisissant la frêle poupée par le bras, le guerrier l’entraîne vers le lit, ou sur la natte, s’il n’y a pas de lit. Se donne-t-il seulement la peine de regarder sa douce moitié à la lueur du lumignon fumeux qui éclaire cette scène d’un réalisme si peu poétique ? Le rustaud n’a qu’une pensée en finir au plus tôt, prouver au bourg tout entier l’incomparable vigueur de ses muscles. Puis, comme un fou, il se précipite dans la cour, il fait feu de son fusil et il va rejoindre ses camarades avec lesquels il passe la nuit à manger et à boire du thé.
Revenons au marié. Le premier soir, au crépuscule, il sort de sa chambre, fausse compagnie à ses vizirs, et il entre, armé d’un fusil, dans la pièce où ces dames tiennent société à celle qu’il considère comme sa proie, sa chose à, lui. A la vue du mâle, la nichée féminine s’envole, le laissant en tête-à-tête avec sa fiancée. Entre ces deux êtres qui se voient pour la première fois, la conversation n’est pas longue. Saisissant la frêle poupée par le bras, le guerrier l’entraîne vers le lit, ou sur la natte, s’il n’y a pas de lit. Se donne-t-il seulement la peine de regarder sa douce moitié à la lueur du lumignon fumeux qui éclaire cette scène d’un réalisme si peu poétique ? Le rustaud n’a qu’une pensée en finir au plus tôt, prouver au bourg tout entier l’incomparable vigueur de ses muscles. Puis, comme un fou, il se précipite dans la cour, il fait feu de son fusil et il va rejoindre ses camarades avec lesquels il passe la nuit à manger et à boire du thé.
Le lendemain, les femmes visitent le linge de la mariée. S’il est maculé de sang, ce sont des you-you frénétiques, interminables, des rires étouffés, des plaisanteries grasses, chuchotées à l’oreille : – Ah notre gars est un rude étalon ! Si, au contraire, aucune tache rouge n’est relevée, quel concert de malédictions contre la prétendue vierge ! Séance tenante, elle est répudiée, renvoyée ignominieusement chez ses parents, et le douaire est rendu au mari trompé.
Le deuxième soir, toujours à la tombée de la nuit, le marié retourne trouver sa femme. Cette fois, son absence est plus longue ; elle se prolonge près d’une heure, puis il revient dans la chambre de ses ministres pour achever la nuit avec eux, buvant, mangeant, causant, se reposant tour à tour. C’est ainsi que s’écoulent les sept premiers jours de son mariage. Emprisonné avec ses gardes du corps, il se borne à aller chaque soir chez sa femme pour retourner ensuite auprès de ses amis qui ne le quittent jamais.
De son côté, la mariée ne bouge pas de la chambre où les femmes lui tiennent compagnie durant sept jours consécutifs, sauf, bien entendu, à l’heure du tête-à-tête avec son mari. Quant aux invités, ils sont dans une pièce spéciale. Ne se souciant nullement des jeunes époux, qu’il n’aperçoivent jamais du reste, ils concentrent leur attention sur les danses des nymphes et des ganymèdes et ils paraissent s’intéresser aussi très vivement aux allées et venues des porteurs de victuailles. On les voit accroupis des journées entières sur plusieurs lignes parallèles, ayant, derrière eux, la cohue des femmes et des bambins, une tourbe de beautés problématiques, qui regardent d’un œil, elles aussi, les évolutions lascives des ballerines et de leurs répugnants cavaliers. Jamais, au grand jamais, un invité ne se retourne pour lorgner du côté des dames, et, encore moins, pour se rapprocher d’elles. Une telle dérogation aux règles de l’étiquette marocaine entrainerait indubitablement la mort immédiate de l’imbécile qui en serait l’auteur.
Je dois ajouter que les danses, la fusillade et la musique ne durent que les trois premiers jours du mariage. Les quatre derniers jours, les retardataires se rattrapent sur les aliments, toujours copieux et assez variés. Les réjouissances nuptiales constituent, cela va sans dire, un régal artistique et culinaire pour les écoliers étrangers auxquels on ne manque pas une seule fois d’envoyer leur part de nourriture quand ils ne viennent pas eux-mêmes se mêler à la foule des convives. »
Auguste Mouliéras, Le Maroc inconnu tome 2 – exploration des Djelaba, 1899 – disponible gratuitement sur Gallica
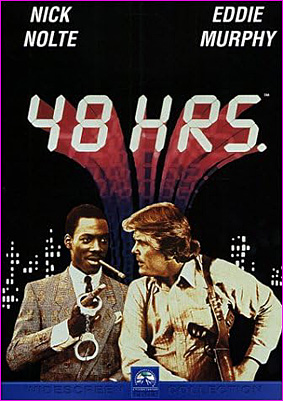








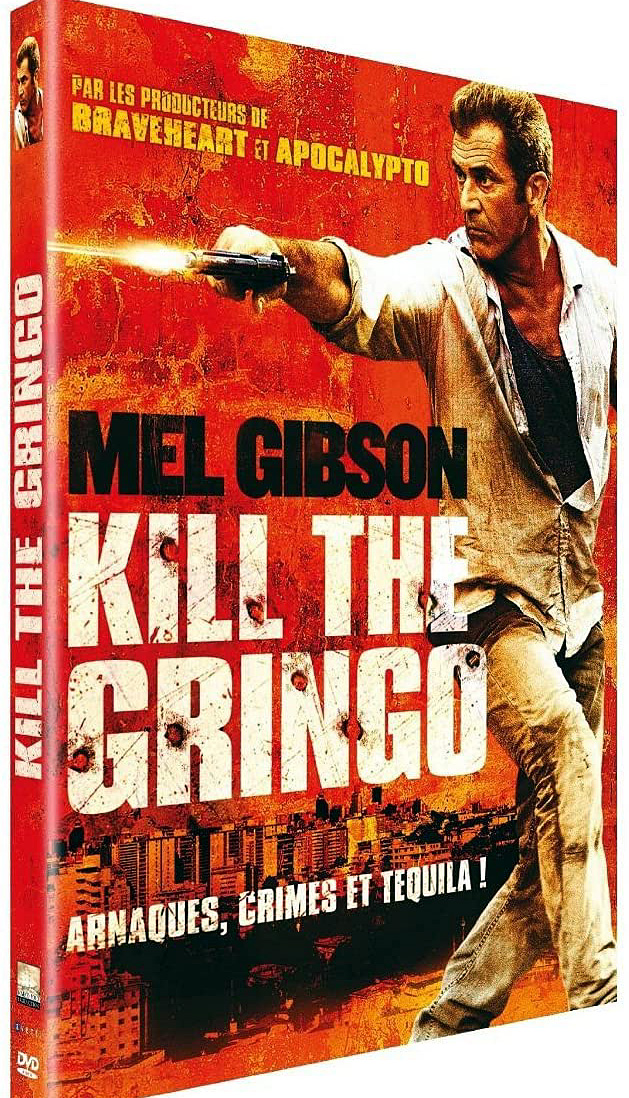



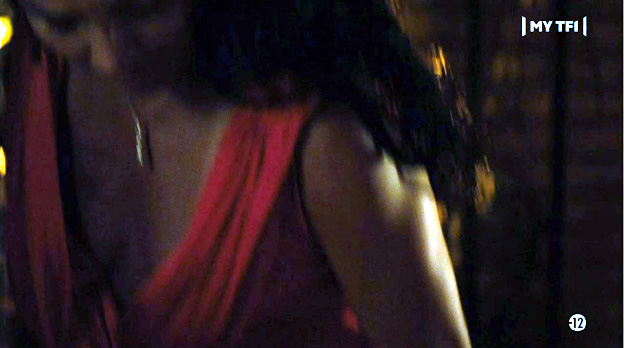



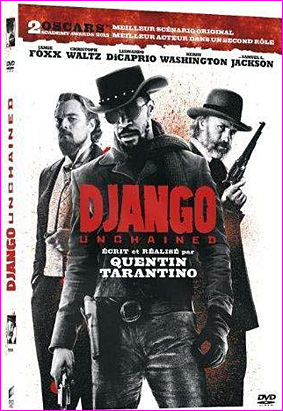







Commentaires récents