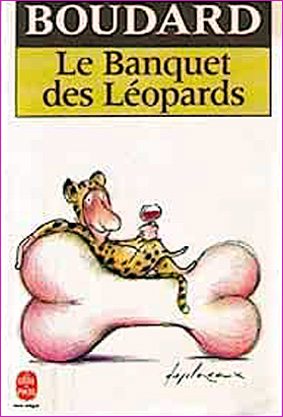
Boudard continue de faire du cinéma écrit avec sa vie. Il a le style dru, vivant mais argotique, ce qui vieillit vite. La langue verte des années soixante, issue de l’avant-guerre, paraît presque aussi archaïque que la langue de Montaigne. Si le lecteur d’un certain âge comprend le sens général, de nombreux mots sont perdus et demandent un dictionnaire. Boudard n’est pas Céline, bien qu’il flatte le même style. Le banquet des Léopards n’est pas son meilleur livre mais il s’emballe dès le milieu et accroche sur la fin.
Dans la vie de Boudard, le passage par la case prison lui a permis de connaître Auguste, dit Vulcanos, un géant voyant, grand et ample, musclé velu qui plaît aux femelles. Très souvent en effet certaines femmes se sentent irrésistiblement attirés par les gros durs, mauvais garçons et violents notoires – tels les tueurs en série. Vulcanos est plutôt du genre gentil, brassant du vent, bateleur de première mais intuitif, en outre doté d’un organe sexuel hors norme que les « fumelles » tâtent au travers le pantalon. Lui n’hésite pas à mettre tout sur la table lorsqu’il est entre hommes.
La rencontre de l’auteur avec avec Vulcanos a lieu en prison, en 1950. Il est en cellule avec Karl, un Alsacien « malgré nous » (dit-il) de la Das Reich, 25 ans, « tout muscles, mâchoire et sexe », « l’éducation spartiate nazie… (…) ramper, courir, flinguer, riffauder les enfants, les aïeules, les prêtres, les Israélites… violer les lingères légères, les dames patronnesses, les petites filles modèles ! Ach ! Kolossale rigolade ! Il s’en est payé, je me goure, ce joyeux drille en campagne ! » p.17 Folio. Il a une « faim féroce de tringler », il vise tous les trous qui passent et attend un giton juteux comme troisième homme dans la piaule. Car l’auteur n’a pas voulu, dit-il. Ce troisième ne sera pas un blondinet jeunot bien tendre mais « le lanternier Auguste Brétoul ». Pas le bon genre désirable à troncher. « La tronche qu’il m’offre là… son crâne dégarni… une grosse trogne rouge… la lèvre avachie.. . le pli d’amertume » p.22. Il est en préventive pour avoir fourgué de faux Renoir, Utrillo, Matisse, le toutim. Comme voyant, il prendra le pseudo de Vulcanos le mage et aura de vraies intuitions. Tubard, comme l’auteur, « il ne croyait pas à la médecine, ou très peu… Sa théorie… qu’on ne s’en sortirait qu’en rejetant la maladie. Vivre à tout prix… tringler, boire, becter ! N’attendez surtout pas demain ! Ça lui a, je dois dire, parfait réussi » p.115. Il crèvera quand même passé 75 ans de la boisson et de la bonne chair après la chère, d’avoir trop vécu, quoi.
Sortis de tôle, les aminches se rejoignent dans la picole et la rigole. Vulcanos, Farluche, l’Arsouille, la Licorne, Jo Dalat, Bobby le Stéphanois, toute une bande qui alpague le gros niais Ap’Felturk, lequel veut à tout prix financer l’édition des œuvres complètes de Bibi Fricotin sur papier bible, la présentation littéraire en étant confiée à Boudard au vu de sa récente réputation d’écrivain. Puis c’est la vie auguste d’Auguste qui doit faire l’objet d’une publication, lancée par un grand banquet rabelaisien sponsorisé par l’éditeur mécène Ap’Felturk et soutenue par le club des Léopards, un entre-soi de déguisés médiévaux. Là, c’est le grand jeu, Boudard se lâche, contre les cons et les écrivaillons. Sa conne de voisine qui a mis en avant durant toute sa jeunesse sa carrosserie acceptable tout en laissant en friche son intellect, confond Alphonse Boudard avec Lucien Bodard ou Philippe Bouvard. Comme sa carrosserie s’avachit, elle tente toutes les flatteries pour se faire « égoïner » quand même.
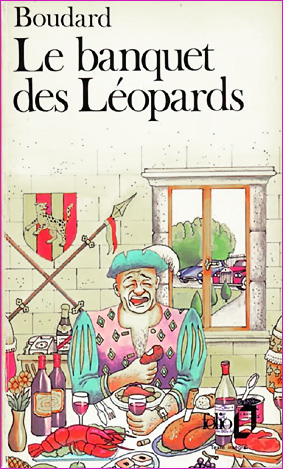
Quant aux minets aigris du milieu littéraire parisien, ils en prennent pour leur grade. « S’ils sont presque tous révoltés de l’adjectif, séditieux du verbe, insoumis du participe, insurgés de la conjonction, émeutiers de la forme pronominale ! Une fois dans le vif du réel, vous les trouvez plutôt larbinos dans l’ensemble… flagorneurs au cours des cocktails… obséquieux avec les puissants, les riches, les excellences, les animateurs de télévision… au sprint dès que l’Élysée leur fait signe ! S’ils se plient en deux… l’échine extra-souple… les miches tendues dès qu’ils aperçoivent monsieur le directeur littéraire » p.219.
Vécu, imagé, réjouissant !
Alphonse Boudard, Le banquet des Léopards, 1980, Livre de poche 1991, 287 pages, occasion €3,00 – autre édition Folio 1982, occasion


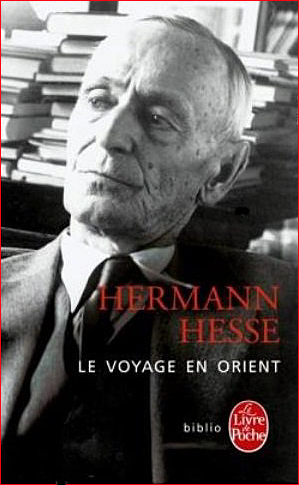




Commentaires récents