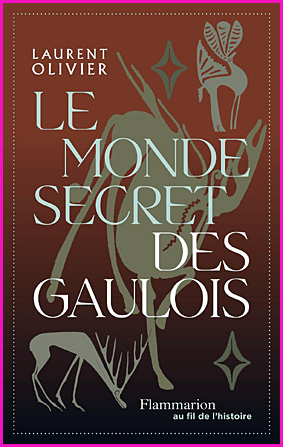
Conservateur général du Patrimoine au musée des Antiquités nationales de Saint-Germain-en-Laye, Laurent Olivier nous livre ses réflexions d’historien et d’archéologue sur « nos ancêtres » que l’on croit connaître – et dont il s’avère que nous ne connaissons que la vision acculturée de la puissance coloniale romaine. En 25 chapitres peu cousus, on peut dire que le livre est mal structuré. D’où les redondances, les répétitions, le délayage parfois. Mais le propos s’avère au final très intéressant, en tout cas bouleversant notre façon de voir – celle qui nous a été entonnée par les « maîtres » d’école.
Le fil conducteur du propos est le suivant : que connaissons-nous des Gaulois ?
Pas grand-chose, et de seconde main puisqu’ils n’ont laissé aucun texte, aucun monument en pierre. Seuls les Grecs et les Romains, parfois tardivement, ont rendu compte de ce peuple tout d’abord effrayant, puis vaincu par César. Les textes sont à lire avec esprit critique et dans leur contexte, notamment La Guerre des Gaules, texte écrit pour justifier les campagnes militaires du général. L’archéologie, depuis les années 1980, nous en apprend plus grâce aux fouilles et au nouveau regard porté sur les découvertes. C’est ainsi qu’il faut relativiser l’absence de restes de bâtiments, puisqu’il s’avère que la plupart étaient en bois, matériau périssable. De même l’absence de « villes », si l’on considère le modèle méditerranéen : les « villes » gauloises étaient des regroupements lâches de fermes étendues et des centres d’artisanat, pas des centres organisés d’un pouvoir civique.
La dépréciation des Gaulois a été l’apport des auteurs romains qui ont souligné leur « barbarie » – autrement dit leur non-conformité à la norme romaine – et qui ont vanté la « civilisation » apportée par Rome (routes, ponts, aqueducs, villes, cirques, chauffage par le sol, etc.) – autrement dit leur acculturation pour se soumettre aux normes d’existence, d’organisation sociale et de façons de penser romaines. Cela rappelle la conquête de l’Ouest et l’acculturation des Indiens ; cela rappelle aussi l’entreprise de « civilisation » des Français en Algérie, l’hégémonie coloniale économique, militaire et culturelle des États-Unis sur l’Europe – ou celle de Staline et de son imitateur petits bras Poutine sur son « glacis stratégique ».
En fait, nous dit Laurent Olivier, c’est Jules César qui a créé le peuple gaulois ; auparavant, il n’y avait que des Celtes, quel que soit le nom qu’on leur attribue selon les pays et les auteurs (Galates, Keltoï, Galli, Germains). Oui, les Germains sont des Celtes, venus par la même migration depuis le Caucase et installés plus à l’est et peut-être plus tard. César, repris par Tacite, oppose les Gaulois, vaincus puis acculturés en Gallo-Romains soumis à Rome, et les Germains, autres Celtes d’au-delà du Rhin, frontière de l’empire, considérés comme encore plus barbares et sauvages. Ce mythe a été adopté avec enthousiasme par les nationalistes du XIXe siècle, dès Napoléon III. L’empereur des Français se prenait pour le successeur de Rome, d’esprit « latin », en opposition avec l’empire prussien, d’esprit « romantique » germain. Cette vision déformée, donc fausse, a duré jusque dans les années 1970 ; elle était enseignée dans les manuels du Primaire, inchangés depuis la IIIe République – et accentuée sous Pétain qui faisait des Gallo-Romains des collabos de César, en cours de civilisation et de progrès, tout comme les Français vaincus par Hitler allaient se re-civiliser grâce à la discipline germanique.
Mais pourquoi tant de haine et de fausseté ?
Parce que les Gaulois ont pillé Delphes sous le nom de Galates, puis Rome en -390 sous le nom de Galli, suscitant une frayeur intense que l’Urbs n’a cessé de vouloir effacer – jusqu’au génocide. César fera dans les 1,2 millions de morts, massacrant non seulement les guerriers qui se rendent, mais aussi les femmes et les enfants, rasant des villes, embarquant comme esclaves tout le reste. Les chiffres romains sont à prendre à la lettre, dit l’auteur, car ils étaient comptabilisés par les scribes sur le terrain pour le Sénat, et donnaient la mesure des cérémonies de victoire. « Rome fait aussi de la terreur qu’inspire la menace gauloise un instrument de sa politique extérieure. Ce péril barbare, qui menacerait sans cesse d’anéantir les Romains, permet de justifier en effet une politique de domination expansionniste qui ne dit pas son nom. Face à la ‘sauvagerie gauloise’ qui minerait l’ordre du monde, les Romains n’exportent pas la violence, disent-ils : ils se bornent à répondre à l’appel de cité ou de nations amies, qui implorent leur aide, afin qu’ils les aident à recouvrer la paix » p.42. George W Bush, Poutine, n’ont pas dit autre chose…
Les historiens grecs sont moins méprisants envers les Keltoï – les Celtes, dont les Gaulois installés en Aquitaine, Transalpine, Celtique, Belgique. Ils sont « perspicaces, élégants et ouverts d’esprit » ; ils sont passionnément épris de parole et d’apparence, un peuple très politique. Ils s’habillent avec recherche, soignent leur chevelure, portent de lourds bijoux en or. Ils sont de mœurs libres : dès la prime adolescence les garçons cherchent à séduire les mâles (comme dans la Grèce antique), et voient dans un refus un déshonneur. Le pays est extrême, disent les Romains habitués à la tempérance du climat méditerranéen ; tout chez les Gaulois est excès. Ils ont, comme chez nous dans la période archaïque, des « grands guerriers », disent les Grecs, de beaux mâles à la Achille qui combattent quasi nus par héroïsme et entraînent une cour de jeunes hommes qui leurs sont dévoués. Beaucoup de stéréotypes de la part des historiens romains surtout – pour se distinguer.
Que retenir, après critique, des historiens antiques ?
Deux grandes époques successives (p.240) : la période archaïque, cinq siècles avant Vercingétorix, où les grands guerriers aimaient la bataille et l’honneur, où les rois étaient ostentatoires et généreux en redistribuant vin et richesse alentour, où l’État n’existait pas, et où l’économie était celle du don et de la réciprocité (les monnaies ne servaient que de cadeaux ostentatoires, pas au commerce).
Puis la période récente, proche de la conquête de César, après le IIe siècle : la monétarisation croissante de la société gauloise à cause des échanges inégaux avec les Romains (le vin contre des métaux ou des esclaves – une cruche contre le jeune garçon qui la sert), le rôle politique de la plèbe et l’approbation de la multitude, les royautés populaires du type de celle de Vercingétorix, et l’organisation en « semi-Etats ». Les richesses ne sont plus redistribuées mais accumulées dans les tombes « princières », une inversion des valeurs qui fait passer les riches du service de la communauté à la communauté à leur service.
Mais toujours la trame fondamentale : la séparation des pouvoirs systématique à la Montesquieu (« le pouvoir arrête le pouvoir »), la place des conseils et assemblées, le rôle d’arbitre des femmes (bien moins « soumises » qu’à Rome), et la fonction régulatrice des druides qui, devins, disent la Loi – qui s’applique à tous, puissants comme misérables. Les femmes « arrêtent le pouvoir des hommes avant qu’ils n’aillent trop loin, ou dans une direction qu’elles jugent inappropriée. (…) [Ce pouvoir] incarne plutôt une faculté d’arbitrage, qui se place au-dessus de toute prise de décision comme de toute action » p.219.
Le pouvoir n’est pas de droit mais doit se justifier par l’approbation de tous. « La société gauloise est par conséquent une société d’opinion profondément respectueuse de la liberté individuelle, c’est-à-dire de la capacité de chacun à raisonner de manière personnelle. Chacun est libre de développer son jugement, car chacun entend se faire son propre avis, en toute indépendance. Comment peut-on alors parvenir à s’entendre dans une telle cacophonie ? Par l’omniprésence des conseils, qui constituent la troisième grande caractéristique des sociétés non étatiques » p.224. Les auteurs libéraux du XVIIIe siècle, Locke, Montesquieu, retrouveront cette façon de faire société politique chez les « sauvages » de Nord-Amérique.
Les trouvailles archéologiques, depuis les années 1980 mais surtout depuis les années 2000, ont modifié la vision misérabiliste imposée par le colonialisme romain, puis reprise par les nationalistes des XIXe et XXe siècles qui opposaient ruralité à la gauloise au progrès urbain à la romaine. Armes en fer de Gergovie, sanctuaire de Gournay-sur-Aronde, édifices monumentaux de Bibracte, cité oppidum de Titelberg ou de Corent… « Depuis qu’on les a remarquées, les trouvailles gauloises nous présentent avec insistance la marque d’une civilisation raffinée, que nous avons encore du mal à reconnaître » p.340.
En conclusion, « ce que nous dit la Gaule » devrait nous servir de leçon.
« Les Gaulois n’ont pas édifié de pyramides, car ils n’ont jamais imaginé que leurs souverains puissent être des dieux vivants sur terre. C’est pourquoi ils ne leur ont pas construit de palais gigantesques, car ils ne leur étaient pas asservis. Ils n’ont pas élevé non plus de temples majestueux, ni édifié d’extraordinaires capitales de marbre, car ils n’ont pas voulu être gouvernés par des pouvoirs aveugles et écrasants – qu’ils soient sur la terre comme au ciel. Ces réalisations grandioses, que nous prenons pour des marques supérieures de civilisation, ne sont en réalité que l’expression de formes les plus brutales de domination de l’humanité. Car la civilisation, considère la pensée gauloise, ne peut être l’écrasement de l’autre, sa réduction à l’état de chose » p.379.
C’est peut-être un peu surinterprété, mais c’est passionnant.
Laurent Olivier, Le monde secret des Gaulois – Une autre histoire de la Gaule, IXe siècle avant-Ier siècle après JC, 2024, Flammarion collection Au fil de l’histoire, 415 pages dont 8 pages centrales dillustrations en couleur, €23,90, e-book Kindle €15,99
(mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés Amazon partenaire)
Un autre livre de l’historien archéologue Laurent Olivier, déjà chroniqué sur ce blog :











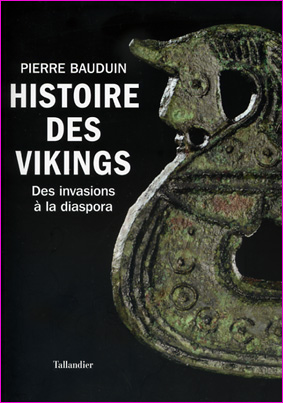

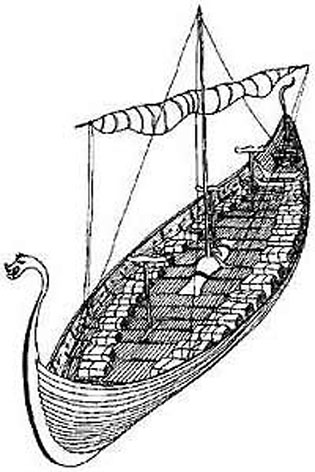


Commentaires récents