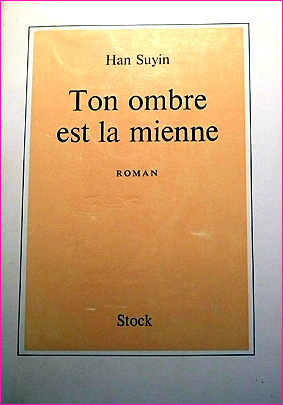
Étrange roman que celui-ci, publié en 1962 par une sino-belge qui deviendra médecin et égérie de Mao à cause du racisme blanc contre les métis eurasiens, avant de connaître le grand succès mondial avec son autobiographie, Multiple splendeur (dont Hollywood fera évidemment un film en 1955, La colline de l’adieu). Kuanghu Matilda Rosalie Elizabeth Chou, est née en 1917, s’est mariée trois fois, a adopté deux filles et est décédée à 95 ans en 2012 – une vie bien remplie.
Elle s’est intéressée à tout, aimant le chaos fertile où la réflexion peut naître, loin des conformismes. Mais elle s’est laissée happer par la propagande maoïste, méprisant le Tibet et les opposants concentrés dans les camps du Laogai. Sa célébrité l’a persuadée qu’elle avait toujours raison – ce qui est assez courant chez les gens de gauche qui n’ont pas la tradition pour les soutenir.
Ce roman est un écart dans son œuvre ; il est fondé sur l’histoire vraie de la petite hollandaise Maria Huberdina Hertogh, laissée seule en Indonésie après que ses parents eurent été emprisonnés après l’invasion japonaise, et recueillie par une femme du pays qui l’a élevée comme sa fille et l’a mariée à 13 ans avec un jeune musulman. Un jugement de Singapour l’a rendue à sa famille européenne, mais elle a voulu rester avec sa famille d’adoption – qui a fini, vu son jeune âge et la loi anglaise de Singapour, à la récupérer pour l’emmener en Hollande. Han Suyin, métisse qui en a souffert, prend cœur à romancer cette histoire en la transplantant au Cambodge, critiquant les certitudes des Blancs et et se plaisant à opposer la culture bouddhiste à la culture occidentale.
Au Cambodge, pays paisible, les Japonais ont fait irruption durant la Seconde guerre mondiale pour en chasser les Français favorables à Vichy et prendre possession des plantations d’hévéas. Comme toujours, le massacre des Blancs, le viol des femmes et des jeunes garçons, est un sport guerrier. « C’est arrivé à tant de gens ! Cela arrive tous les jours. Ce que ces soldats vous ont fait, à vous et votre mère avant qu’elle ne meure, n’était que la représentation parodique de l’exercice de la puissance. C’est le lieu commun de toutes les guerres, repris par tous les soldats depuis des millénaires » p.29. L’astrologue du village khmer parle ainsi à Philippe, rescapé du massacre à 12 ans car laissé pour mort, frère de la petite Sylvie qui a été enlevée par un Japonais. Lequel a vu sa moto tomber en panne et a été tué par les ouvriers cambodgiens de la plantation, tandis que la fillette était adoptée par une villageoise qui passait par là avec son fils Rahit, de deux ans plus âgé. La petite blonde est devenue sa fille, malgré l’écart de race et de culture ; Rahit est devenu un beau jeune homme au corps harmonieux élevé dans la nature.
Dès lors, Philippe et Rahit sont décrits comme deux caractères qui s’opposent. Tous deux aiment Sylvie, devenue Devi, l’un comme un frère quasi incestueux, l’autre comme un fiancé promis dès son adoption. La « nature » penche pour Rahit, bien qu’il soit cambodgien, la « loi » penche pour Philippe, car il a des « droits » de famille sur sa sœur. Philippe s’est marié à Anne, malgré son viol, décrit complaisamment par l’astrologue qui a tout vu mais lui impose la vérité des faits : « Sur la véranda, maintenu par deux soldats dans une position favorable, vous étiez chevauché par l’officier comme un animal » p.31. Crudité du réel, que nie Philippe, tout comme son désir illégal pour sa sœur. Il a choisi Anne pour sa ressemblance avec elle mais ne l’a jamais aimée, ce pourquoi elle cherche des amants, dont le docteur Jacques, lui aussi tombé amoureux (mais dans les « normes ») de Sylvie, qui a désormais 15 ans. Sauf qu’il l’a tuée lui-même, la prenant lors d’une chasse de Blancs pour un faon.
La critique du monde blanc prend alors toute son ampleur : les Occidentaux se grisent de mots ; tout ce qui n’est pas nommé n’existe pas et seul existe la vérité qui est dite. C’est le règne de « la belle histoire », le film que chacun se fait pour se justifier et se conforter moralement. Philippe affirme qu’il a résisté aux Japonais pour défendre sa petite sœur, que c’est Anne qui n’a pas aimé leur couple, que Jacques ne pouvait par devoir désirer Sylvie, que sa sœur se souvenait de son frère et des bons moments passés avant son enlèvement. Mais la vie réelle n’est pas ainsi faite qu’elle obéisse aux fantasmes des uns et des autres. La reconnaissance de soi implique l’exorcisme du double, le personnage enflé que l’on s’est créé, le paraître dont on s’est maquillé. Sylvie ne peut – ne veut – se souvenir du traumatisme d’avoir assisté au massacre de sa mère, d’avoir été enlevée par un soldat sur une moto pétaradante, d’avoir été abandonnée en pleine forêt ; elle ne veut se souvenir que des bons moments après, passés avec sa nouvelle mère Maté et son grand frère Rahit, à qui elle se donne, juste adolescente. Il l’aime, elle l’aime. C’est ainsi.
Philippe vient la récupérer au village, le droit avec lui ; Rahit va la rechercher à la ville, son amour avec lui. Elle suit l’un comme l’autre, sans comprendre l’amour des uns et des autres. Elle « aime être aimée », au fond (p.101). L’auteur les détaille et les contraste, ces façons d’aimer : l’amour d’occident est possessif, celui d’orient harmonique ; les deux garçons sont proches de l’inceste, mais Philippe plus que Rahit puisqu’il a fait de sa petite sœur, avec qui il jouait enfant, une image de pureté et d’angélisme hors du monde, tandis que Rahit vivait au jour le jour avec une sensualité partagée sous le même amour d’une mère commune ; Jacques représente l’amour normalisé européen bourgeois, rassurant mais tiède ; tandis que l’amour d’une mère, même adoptive, est inconditionnel. Que se passe-t-il dans l’amour, lorsqu’une guerre vient tout bouleverser ?
L’écart des façons de penser entre Orient et Occident est le principal du livre, au-delà du fait divers et de la réflexion sur l’amour – qui ne se confond pas avec le sexe, la scène du viol le montre. Tout change, et seul le silence peut pénétrer les âmes de chacun, dit l’astrologue. Impossible de s’abandonner ainsi, dit l’Européenne. « N’y a t-il rien de réel, alors ? Demanda Anne. N’y a-t-il rien de plus solide que les mots ? N’y a-t-il rien de sûr ? Notre esprit se meut-il sur des sables mouvants ? Je refuse de vivre dans ces conditions. Je veux avoir quelque chose à quoi me raccrocher » p.95. Nous ne sommes que dans la Presque Vérité, enseigne le bouddhisme, aucun individu n’est seul et libre mais fait partie du Tout, avec les autres, et en interaction avec eux. Les Possibilités sont orientées dans le Devenir, et aucune volonté ne peut vraiment choisir. Les choses se font naturellement.
Han Suyin, Ton ombre est la mienne (Cast But One Shadow), 1962, Stock 1963, 185 pages, occasion €9,43
(mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés Amazon partenaire)


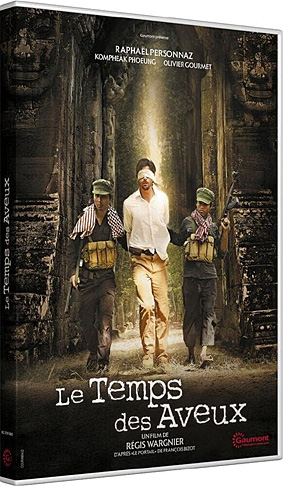
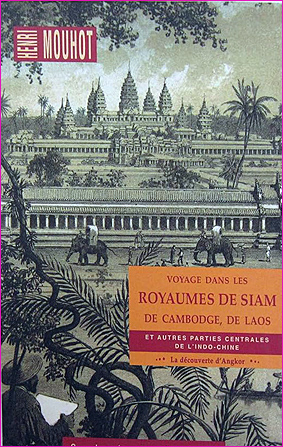
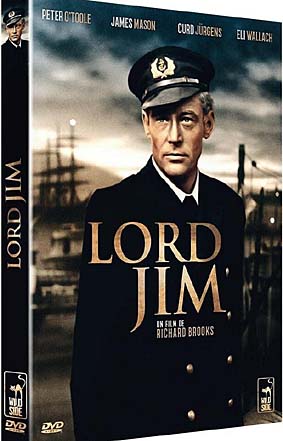






Commentaires récents