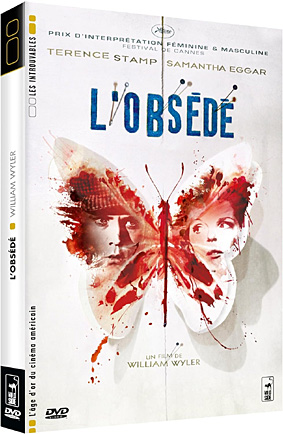
Dangers de l’inadaptation aux normes sociales : Freddie Clegg (Terence Stamp), un jeune employé de banque moqué par ses condisciples au collège, puis par ses collègues au bureau, a gagné 510 000 £ au loto foot, une belle somme qui lui permet d’acheter une demeure ancienne et isolée dont il découvre avec un frisson de joie les caves voûtées lors d’une chasse aux papillons particulièrement fructueuse. Car l’homme est un collectionneur névrotique. Peu importe qu’il tue des centaines de papillons, il les pique et expose leur beauté à sa seule admiration. Il a gagné un prix pour un « arrangement » en forme de tableau, mais ce qui l’intéresse est de les posséder. C’est son trésor.
En revanche, côté sexe, c’est le désert. Il est inhibé envers les femmes, sans pour cela se sentir en apparence attiré par les hommes – encore qu’une psychanalyse pourrait révéler que sa distance est peut-être le signe d’une absence de désir féminin. Comme souvent les impuissants, ou les homos refoulés, il idolâtre les femmes, une à une, comme les papillons. Il admire leur beauté, leur aisance, leur façon de marcher. Dans sa camionnette de tueur en série, il en suit une, la surveille, veut tout savoir sur elle. Il agit envers la jeune femme comme envers un papillon dans toute la gloire de son vol.


Il ne tarde d’ailleurs pas à lancer son filet pour capturer la belle élève d’une école d’art Miranda Grey (Samantha Eggar). Il désire le fragile, le diaphane, l’éphémère. Le papillon est ainsi, la jeune femme aussi – à ses yeux. Il traque par désir obsessionnel, il chloroforme la beauté et enferme dans son bocal la vilaine chenille devenue éblouissant papillon par la métamorphose de l’art et de la culture.
Dès lors, le huis-clos commence. Un drame psychologique car s’il désire, il est trop coincé pour ne pas « respecter » et trop inhibé pour savoir comment se faire aimer. Il déploie donc les codes sociaux de ce qui se fait : offrir des fruits, un bain, du champagne, un repas fin devant la cheminée. Mais rien n’y fait. Son péché originel est le rapt : nul ne peut aimer dans la violence, sauf si la cruauté et l’attaque sont suffisamment fortes pour engendrer le « syndrome de Stockholm » où les otages s’attachent à leur bourreau. Mais Freddie en est incapable, là encore inhibé.


Il en est touchant et la femme le sent. Il est sincère lorsqu’il dit désirer qu’elle soit son épouse et qu’elle cohabite avec lui – sans la toucher – juste comme un bel objet mort de sa collection. Mais ce n’est pas ce que désire une femme, elle le luit dit ; elle désire être prise et fusionner physiquement avec l’homme qu’elle épouse. Lui est toujours froid, tiré à quatre épingles, conventionnel d’extérieur mais solitaire d’intérieur. Miranda le ressent et en joue. Carrément hostile et révoltée au début, elle ruse et joue la séductrice ensuite, se faisant serpent pour manipuler Freddie et le pousser à faire des erreurs. Elle tente alors de profiter de la moindre occasion pour se faire connaître de l’extérieur ou s’évader : en faisant déborder la baignoire alors qu’un raseur de colonel voisin vient se présenter en passant, en dégageant sa poitrine pour affoler les sens du jeune homme et l’amener à relâcher sa surveillance, en laissant tomber ses objets de toilette pour qu’elle puisse saisir une bêche laissée à portée et lui asséner un bon coup sur la tempe.



Mais rien n’y fait. Freddie aux yeux de glace reste distant, ce pourquoi son désir apparaît moins sexuel que fétichiste. Il aime collectionner le bel objet, il ne désire pas faire l’amour avec lui. L’amoureux transi n’est qu’une image qu’il se donne : au dedans, il est machiavélique, inquiétant, psychopathe. Il n’est pas en recherche d’affection, mais de collection. Ce pourquoi Miranda est destinée à ne jamais reparaître au jour et que, si elle disparaît, une autre la remplacera. C’est ce que le spectateur soupçonne peu à peu et ce suspense fait beaucoup pour un film au fond assez statique. L’angoisse monte : que Freddie arrive à ses fins ; que Miranda parvienne à se manifester au colonel ; qu’elle réussisse à tuer son bourreau ; que celui-ci ait été trop atteint et qu’elle reste enfermée jusqu’à mourir de faim dans cette cave profonde et insonorisée. D’ailleurs il doit passer trois jours à l’hôpital et elle est seule, mouillée, sans nourriture ni chauffage…


Tiré d’un roman de John Fowles, paru en 1963, le film est plus envoûtant tant il se centre sur les deux personnages antagonistes et liés entre eux, à la manière d’une pile. La scène au sortir de la baignoire où les corps se mêlent dans la force du bourreau, le baiser langoureux qu’elle offre au dîner alors qu’elle veut le séduire, la manœuvre sous la pluie qui révèle les formes sous les habits autant que les esprits de chacun (lui vigoureux, elle fragile), restent des moments privilégiés de cette attirance-repoussoir. Freddie Clegg n’a jamais surmonté l’enfance pour accéder à l’adulte. Miranda la sensitive le lui lance carrément à la face : « Tu as eu ce rêve avec moi, (…) ce n’est pas de l’amour. C’est une sorte de rêve qu’ont les jeunes garçons lorsqu’ils atteignent la puberté, et que tu as fait devenir réalité ».


L’apprentissage de la contrainte sociale (costume chic, cravate, visage impassible, manières de gentleman) ne suffit pas à socialiser l’individu. Freddie, issu du peuple, en est ressorti guindé et complexé. A l’inverse, Miranda l’artiste, de bonne bourgeoisie, plutôt fantasque et qui est capable de sympathiser avec n’importe qui, montre que c’est le tempérament qui fait l’humanité, pas les règles. La civilité, l’amitié, l’amour, sont des sentiments venus de l’intérieur, ils ne peuvent être assurés par les seuls codes ni par l’influence des seuls milieux sociaux. Les codes engendrent des refoulements, donc des névroses, s’ils sont imposés de façon trop rigide et rituelle. Wyler dénonce ici, sans le vouloir ni peut-être le savoir, les dangers de l’éducation disciplinaire à l’anglaise, dont les public schools (privées) formatent des inadaptés en série avant l’éclatement des mœurs en 1968. La première image du film, où l’on voit un jeune homme solitaire muni d’un filet à papillon errer dans une prairie vide, résume toute son histoire.
DVD L’obsédé (The Collector), William Wyler, 1965, avec Terence Stamp, Samantha Eggar, Mona Washbourne, Maurice Dallimore, Wild Side Video – Les Incontournables 2014, 1h54, €15,09
(mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés Amazon partenaires)

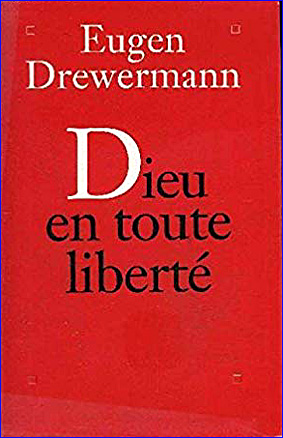


Commentaires récents