
Un écrivain mandaté par un journal pour écrire des chroniques sur son propre pays comme s’il était étranger : voilà un beau programme proposé en 1989 à Julian Barnes par le New Yorker. Surtout que le métier de journaliste n’est pas celui d’écrivain. Le correspondant de presse se doit d’être précis, concis, et « ne pas considérer même la plus évidente des assertions comme allant de soi » p.11 édition intégrale. A l’époque (hélas ! révolue), la « police du style » corrigeait impitoyablement les auteurs sur leur vocabulaire et leur grammaire. Et le « service de vérification de l’information » était actif. Pas question de fautes ni d’approximations ! C’eût été un déshonneur. De nos jours, le déshonneur on s’en flatte, ça fait popu, démago, en bref à l’aise, comme tout le monde.
L’écrivain Julian Barnes s’est tiré avec élégance durant cinq ans de cette mission délicate de parler du Royaume-Uni, sa patrie, comme s’il était un étranger. Cela donne 14 chroniques politiques et sociologiques, sur Margaret Thatcher, John Major et Tony Blair, sur la mode des labyrinthes dans les jardins de manoirs, sur Buckingham Palace et ses embouteillages, sur la presse tabloïd vulgaire, raciste, chauvine et incroyablement stupide pour couper les cheveux en quatre à propos d’une facture de 17,47 £ du chancelier de l’Échiquier concernant trois bouteilles de (mauvais) Bordeaux, sur le nouveau tour de poitrine de Britannia devant orner les timbres-poste, sur l’arnaque spéculative des Lloyds, ces réassureurs illimités qui peuvent ruiner le patrimoine de leur Names, sur le championnat d’échecs où l’Anglais Scot fut mis en échec par le russe ex-soviétique Kasparov, sur l’inauguration du tunnel sous la Manche par Tchatcher et Mitterrand (et le TGV roulant à 180 miles à l’heure côté France et à 60 seulement côté Kent), sur la fatwa des mollards iraniens condamnant à mort Salman Rushdie, et sur la pusillanimité de la réaction anglaise (à l’inverse de la réaction française, nordique et allemande).
Certes, tout cela est bien daté et la plupart des lecteurs d’aujourd’hui n’étaient peut-être même pas nés il y a trente ans. Ce pourquoi l’édition réduite en poche bilingue peut avoir une vertu : faire lire quand même Julian Barnes. Car c’est un festival d’humour anglais et d’expression incisives.
L’auteur exerce sa verve particulièrement sur Margaret Thatcher, première femme Premier ministre de Grande-Bretagne, à la longévité la plus longue (12 ans) depuis Robert Jenkinson, 2ème comte de Liverpool en 1812, faite baronne à vie (mais point héréditaire et encore moins comtesse). « Mrs. Thatcher, pendant presque tout son règne, ne montra pas en public qu’elle connaissait l’existence de l’humour. Une plaisanterie pour elle eût été un signe de faiblesse, une tentative de consensus politique, une initiative gratuite et peut-être subversive, comme une bouteille d’eau minérale de marque étrangère sur la table lors d’un banquet au 10, Downing Street » p.80. Mais l’humour n’est pas l’ironie ; le premier cherche à comprendre l’autre et à équilibrer le jugement, tandis que la seconde ne vise qu’à la pique. « L’affreuse vérité, qu’on mit des années à comprendre, c’est que Mrs. Thatcher représentait et réussissait à attirer une forme puissante et politiquement ignorée d’identité anglaise. Pour le libéral, le snob, le citadin, le cosmopolite, elle faisait montre d’esprit de clocher et d’une mentalité de petit boutiquier, puritaine et poujadiste, égocentrique et xénophobe, moitié nostalgie d’une souveraineté insulaire et moitié gestion tatillonne. Mais pour ceux qui la soutenaient, c’était une femme au parler franc, à la pensée nette et visionnaire qui incarnait le bon sens et la volonté de se débrouiller par soi-même, une patriote qui se rendait compte que nous avions vécu bien trop longtemps sur du temps et de l’argent emprunté » 233.
La pique existe aussi dans l’humour anglais, mais elle est bienveillante, sans méchanceté, comme un constat désolé. Par exemple : « Le Dr Wrede, candidat des libéraux-démocrates, est un séduisant gynécologue. Il est grand et capable de faire porter sa voix jusqu’au fond d’une salle sans l’aide d’un micro. Il était tout à fait envisageable de lui confier son utérus, mais lui confier sa voix était une toute autre affaire» p.108. Il est vrai que l’on ne peut induire de la compétence professionnelle de quelqu’un sa compétence politique. Pas plus que les « artistes » n’ont de compétences particulières sur le climat ou les frasques de la Russie. C’est trop leur demander.
Quant à observer les travers de sa propre patrie, les Anglais y excellent bien plus que nous. Comme au restaurant. «A quelques pas du Savoy, le Simpson’s-in-the-Strand (…). Il s’agit de l’un de ses vénérables restaurants anglais ou le rosbif arrive en véhicule blindé plaqué argent, et où une guinée donnée au garçon qui coupe la viande vous évite le morceau tendineux » 260. Je ne sais si la gargote existe encore, mais le conseil est bon.
Affaires comparées, comment les pays se voient peut être une expression de leur géographie. « La Grande-Bretagne n’a que la France pour voisin manifeste, tandis que celle-ci peut se distraire avec trois autres cultures majeures – L’Espagne, l’Italie et l’Allemagne. Au large des côtes sud de la France s’étend le continent africain ; au large des côtes nord de l’Angleterre, les îles Féroé, et des phoques en quantité. La France est à nos yeux la première incarnation de l’étranger ; c’est notre principale destination exotique. Il n’est donc pas surprenant que nous pensions plus aux Français qu’ils ne pensent à nous. (…) Les Anglais sont obsédés par les Français, alors que les Français ne sont qu’intrigués par les Anglais. Quand nous leur exprimons notre amour, ils l’acceptent comme un dû ; quand nous leur exprimons notre haine, ils sont perplexes, agacés, mais la considèrent avec raison comme notre problème, et pas le leur » 332. J’aime particulièrement l’allusion discrète aux phoques, animaux placides et grégaires dont les mœurs sexuelles restent sujettes à caution. Façon d’exprimer combien les Anglais ont peu d’exemples stimulants au large de leurs côtes.
Julian Barnes, Lettres de Londres (Lettres from London 1990-1995) – choix, Folio bilingue 2005, 224 pages, €9,62
Julian Barnes, Lettres de Londres – édition intégrale en français, 1996, Denoël collection Empreinte, 364 pages, occasion €3,00
(mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés Amazon partenaires)







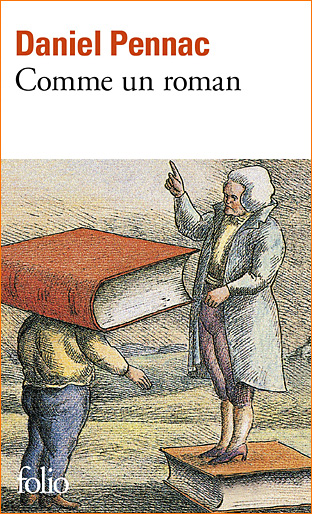

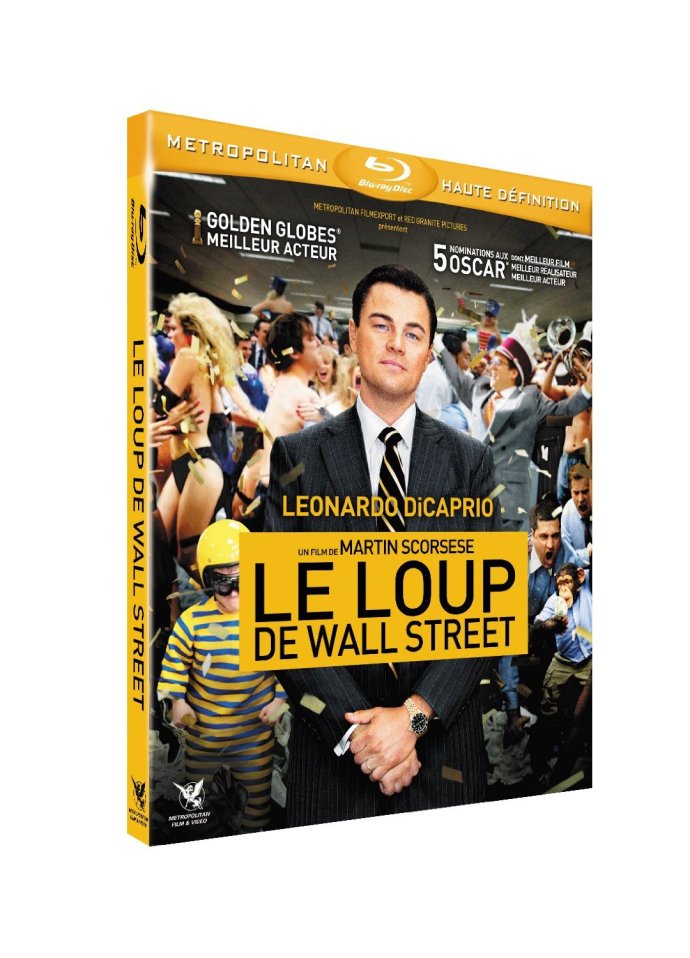
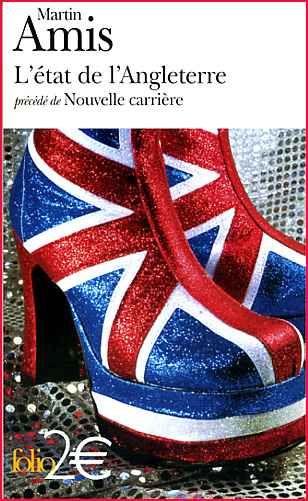
Commentaires récents