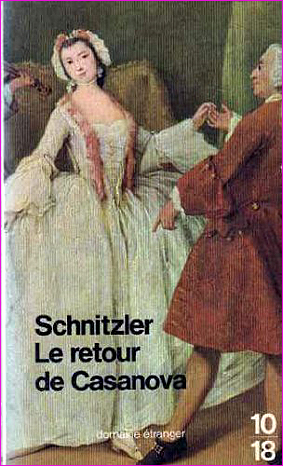
Casanova, 53 ans, a sa vie derrière lui : il est un vieil homme. Il veut rentrer à Venise, sa ville natale, mais attend pour cela l’autorisation du Grand conseil, une amnistie après son évasion des Plombs en 1756. Il a commencé un pamphlet contre Voltaire, dont il dénonce l’hypocrite façon de jouer le croyant sans l’être. Mais c’est trop tard, il a épuisé son entregent à entreprendre de baiser les femmes. « Pour une nuit sur une nouvelle couche d’amour, il avait toujours sacrifié tous les honneurs de ce monde » p.85.
Autour de son auberge de Mantoue, il rencontre son ami Olivo, désormais marié à Amalia, que Casanova a bien connue jusqu’au lit, et qui ont trois fillettes dont l’aînée, Teresina, a 13 ans. Il est invité à passer quelques jours dans leur domaine, un vieux château délabré racheté au marquis local Celsi grâce aux bénéfices agricoles des légumes et du vignoble que cultive l’industrieux Olivo. Casanova ne veut pas rester, gêné de retrouver l’épouse de son ami toujours prête à libertiner avec lui. Mais la présence d’une jeune nièce, Marcolina, lui remet le feu aux chausses. Elle est belle, intelligente, étudie les maths, froide envers lui : tout ce qui fouette le désir.
Marcolina le snobe, restant polie et joutant intellectuellement sur la foi et l’incroyance, mais sans répondre à ses avances. Casanova n’hésite pas à se défouler sur Teresina, émoustillée par la puberté et qui ne dit pas non. Jetée sur le lit, « il la couvrait de baisers passionnés » (autre nom de ce qu’on appelle aujourd’hui un viol). Mais il aura Marcolina, foi de Casanova.
Il profite des circonstances pour inventer un piège où la belle cédera, sans le savoir. Car elle n’est pas prude, Marcolina ; il a vu le jeune lieutenant Lorenzi sortir un tôt matin par sa fenêtre. Il désire prendre sa place pour une nuit. Pour cela, le jeu fournit l’occasion. Casanova perd, puis regagne ; Lorenzi gagne puis reperd, notamment contre le marquis, dont il baise officiellement la femme. Il lui doit 2000 ducats d’or et lui jure de le rembourser le lendemain, sans savoir comment, probablement par le suicide. Casanova, qui a gagné la somme, lui propose un marché entre libertins affranchis des préjugés : il prendra sa place la nuit suivante auprès de Marcolina, tandis que lui est rappelé impérativement à Milan pour la guerre ; en contrepartie, il lui donnera les 2000 ducats pour éviter que le marquis ne le salisse.
Ce qui fut fait. Casanova part pour Venise, ayant reçu la lettre qu’il attendait de Bragadino, un sénateur ami, membre du Grand conseil, lui annonçant qu’il est pardonné s’il revient à Venise espionner les milieux révolutionnaires et libertins, où l’incroyance fleurit. Il fait faire demi-tour au cocher pour revenir au château, dont Lorenzi lui a donné la clé du jardin. Il s’est mis tout nu sous le manteau du lieutenant, pour ne laisser aucune trace et ne pas se faire reconnaître. A minuit exactement, la fenêtre s’ouvre, Marcolina accueille son amant et le baise passionnément.
Après une nuit torride, dans laquelle Casanova a retrouvé une ardeur de jeune homme sous les assauts d’une amante experte et déchaînée, il s’endort et rêve. Mal lui en prend, l’aube survient et, avec elle, la vérité : il n’est pas Lorenzi au corps de jeune dieu, mais un vieillard. Marcolina, horrifiée, le méprise du regard. C’est moins le mensonge que la révélation de ce qu’il est qui la touche : un ancêtre, un débris, un homme qui a fait son temps. Casanova s’enfuit, honteux.
Mais la réalité rattrape une nouvelle fois l’illusionniste. Lorenzi l’attend au jardin. Il le provoque en duel pour venger l’honneur de sa belle ; de toute façon, la guerre va le prendre et il n’a rien à perdre. Casanova est tout nu ? La belle affaire ! Lui aussi se met nu, et ils engagent le fer. Cette fois, l’expérience permet au vieil homme de triompher du jeune et Lorenzo meurt, le sein gauche percé de l’épée. Le vieux séducteur le laisse, tel un Adonis nu endormi sur l’herbe, et rejoint son coche, qui le mène à Venise. Ni vu, ni connu.
Une fois dans sa ville, il en aperçoit la décrépitude, que sa jeunesse ne voyait pas, tout entière absorbée par le désir. Il mesure son bienfaiteur, qu’il a sauvé jadis de la mort par saignées des médecins incompétents. C’est un homme simple, conservateur, pas bien intelligent. Il prend la température de la ville, minée par les nouvelles mœurs libertines et incroyantes des Lumières en cette année 1773, et qui agit en réactionnaire, par la répression.
C’est une fin de règne, une fin de monde, bientôt la Révolution, partie de France, va enflammer l’Europe, et Venise sera prise dans le tourbillon des nouvelles mœurs, des nouvelles façons de penser, par la liberté. Lui, Casanova, est un séducteur fini ; il ne peut plus séduire les jeunes filles, sauf les très jeunes naïves, par surprise ; il ne peut plus ferrailler intellectuellement avec les philosophes, tout le monde s’en moque et l’époque est au retour de la religion ; il ne peut plus vivre de sa liberté, désormais stipendié pour espionner. Sa décrépitude est à l’image de Venise qui se meurt, à l’image aussi de l’après-Première guerre mondiale, que l’auteur vit dans la désespérance. Une certaine Europe cosmopolite, inventive, artistique, de la Belle époque a disparu avec la boucherie de 14. La dépression psychologique approche, de même que la Grande dépression économique de 1929, qui aboutira à la réaction du stalinisme, du fascisme, du nazisme, du franquisme, du salazarisme, du pétainisme… Nous revivons un peu cette époque-là, où la liberté recule, le libertinage répugne, et où la réaction ressurgit.
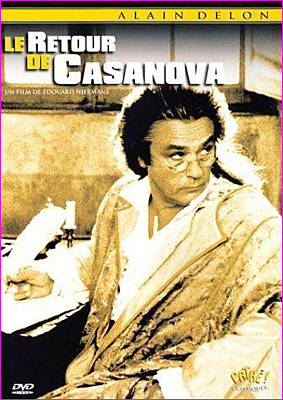
L’auteur, Arthur Schnitzler, est mort à 69 ans en 1931. Il n’aura pas connu la chape de plomb du nazisme. En tant que juif, médecin, psychanalyste émule de Freud, écrivain de théâtre, il aurait été éliminé par le nouveau régime. C’est dans les années 1980, au moment de la résistance des pays de l’Est contre la chape de plomb du brejnévisme soviétique, que Schnitzler a été traduit en France. Casanova est devenu l’emblème de la liberté de penser et des mœurs – jusqu’à en faire un film avec Alain Delon en Casanova et Elsa Lunghini en Marcolina fort dévêtue.
Arthur Schnitzler, Le retour de Casanova, 1918, 10-18 1980, 190 pages, €5,00, e-book Kindle €1,49
DVD Le retour de Casanova, Édouard Niermans, 1992, avec Alain Delon, Elsa Lunghini, Fabrice Luchini, Fox Pathé Europa 2003, 1h34, €20,89
(mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés par amazon.fr)

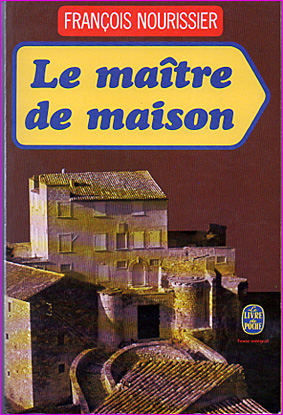



Commentaires récents