Alex (Gabe Nevins) a 16 ans, un petit frère de 13 ans tordu de stress parce les parents divorcent, et une seule passion avec ses potes : le skate. Son meilleur copain, Jared (Jake Miller) pense à niquer avant de skater, mais Alex l’inverse. Sa petite copine Jennifer (Taylor Momsen) aux grands yeux gris bleu veut se faire déflorer par lui, qui est gentil, passif, imberbe et garde une gueule d’ange. Ils « le » font mais si elle trouve ça « génial », lui reste froid, préoccupé d’autre chose.
C’est qu’un jour, Jared lui a fait miroiter le fameux Paranoid Park, le paradis des skateurs rebelles construit illégalement par les marginaux du voyage, de la fauche et de la dèche (tourné au Burnside Skatepark de Portland). C’est le top des parcs à skate, l’endroit où il faut être. Alex ne se sent pas encore techniquement prêt pour le Park mais il adore regarder évoluer les mordus sur les pistes. Un week-end où il va chez Jared, ils projettent d’aller skater avec les mauvais garçons de Paranoid le soir, mais Jared reçoit la proposition de sa copine de passer la nuit avec elle et il préfère la niquer. Ça ne se refuse pas. Alex y va donc seul.
Scratch, un loubard (Scott Patrick Green), l’aborde pour qu’il lui prête son skate puisqu’il reste au bord de la piste sans oser s’y lancer seul et, en récompense, lui permet de réaliser son fantasme : sauter dans un train de fret qui traverse la gare de Portland. Les deux gars s’accrochent et se font transporter mais un agent de sécurité privée les a vus (John Michael Burrowes) et court après le train qui ne va qu’à faible vitesse, les rattrape et les frappe de sa torche aux jambes pour les faire descendre. En se défendant, Alex le repousse avec son skate et le vieux tombe à la renverse. Manque de chance, un train passe à grande vitesse sur la voie parallèle et le coupe en deux.
Alex, sonné, tente de tout dissimuler malgré sa conscience qui lui enjoint d’appeler les flics ou d’en parler à son père. Il jette son skate, dans la Willamette depuis le pont de fer, se met nu et jette tous ses vêtements dans une benne, prend une (longue) douche. Le père divorce et a d’autres préoccupations que ses fils. Quant à sa mère… il est difficile de travailler comme de vivre avec elle. Personne ne s’intéresse à lui, son père sur le départ, sa mère en crise, son petit frère égaré, sa copine qui ne pense qu’à se faire déflorer pour le raconter en long et en large aux copines – Alex garde donc pour lui tout ce qui le préoccupe.
Au lycée, l’inspecteur Lu (Daniel Liu) interroge tous les skateurs car quelqu’un a vu un gars jeter sa planche du haut d’un pont la nuit du meurtre et elle a été récupérée ; elle est enduite d’ADN – qui devrait parler, dit-il (sans autre preuve). La vue des photos du corps coupé en deux fait remonter toute la scène à la mémoire d’Alex. La copine Macy (Lauren McKinney) qui assiste à sa rupture avec Jennifer, voudrait bien prendre la place toute chaude mais Alex lui confie qu’il a quelque chose de grave sur le cœur et ne sait comment s’en débarrasser. Elle lui conseille de tout écrire et d’envoyer la lettre à quelqu’un qu’il aime bien, hors parents et profs, ou même de la brûler s’il est seul. Il s’agit d’une catharsis.
Alex écrit donc sur un cahier, d’abord chez son oncle en bord de mer, puis chez sa mère, et finit par faire des feuilles remplies un feu de joie, telle une confession de protestant qui brûle le mal.
Le rapport des adolescents à la mort a fasciné Gus Van Sant. Ils ne semblent pas réaliser ce que c’est, ni la guerre en Irak (dont ils se foutent), ni le crime (constant à la télé), ni les conséquences mortelles d’un geste malheureux. Alex est dans le déni, ce pourquoi il ment avec aplomb, le visage candide : il s’est forgé une « belle histoire » et l’incarne comme si un autre que lui avait fait ce qui a été fait. Il ne l’a pas « voulu », donc ce n’est pas « lui » mais un double maléfique. La bande son plutôt étrange rend l’atmosphère glauque, accentuée par le climat froid et pluvieux de l’Oregon. La caméra abuse du flou et des mouvements de mal de mer pour dire l’âme chancelante des adolescents, ce qui apparaît un peu forcé, répétitif. Ce serait un procédé de résonance mémorielle selon un spécialiste.
Le skate est la métaphore de la glisse ado dans l’existence, une souplesse non impliquée, un évitement permanent, une camaraderie de potes plutôt que le sexe avec une partenaire. Ils n’ont pas de morale, tant le monde adulte apparaît amoral et hypocrite ; il n’y a ni Bien ni Mal, seulement du bon et du mauvais relatif, des choses qui font plaisir et d’autres qui suscitent le malaise. L’adolescent Alex est beau mais infantile ; il a le corps élancé mais des vêtements informes et une démarche chaloupée de babouin, accentuée par le ralenti caméra ; son visage est impassible mais garde une moue amère. Il est déconnecté, il glisse, il plane. Il n’est pas de ce monde, incapable d’exprimer ses émotions, inapte à nouer une relation, débranché de l’existence. Personne ne le capte, ne le retient.
Jusqu’au meurtre sans préméditation. La moitié du film dit le déni, l’autre moitié la redescente dans le réel. Le skate est comme un trip qui compense tout ce qui se défait pour l’ado (la famille, l’ami, la copine). La prise de conscience visuelle du corps coupé en deux de l’agent, dont le tronc bouge encore, le rend enfin acteur de sa vie. Il doit assumer, en adulte, et rompre avec ses relations superficielles (papa, Jared, Jennifer). L’apparence n’est pas l’être et l’individu atomisé pas la vraie personne. Le monde est complexe et les gens sont autres que ce qu’ils paraissent. C’est au fond ce que déclare Alex à Macy, pas belle mais peut-être plus profonde que la bimbo Jennifer. Dix ans après, à la suite de trois crises (financière, terroriste, virale), les ados ont-ils changé ?
DVD Paranoid Park, Gus Van Sant, 2007, avec Gabe Nevins, Daniel Liu, Jake Miller, Taylor Momsen, Lauren McKinney, Scott Patrick Green, John Michael Burrowes, MK2 2011, 1h20, €5.49, blu-ray €7.36
Blake Nelson, Paranoid Park (en français), Hachette littérature 2007, 220 pages, €4.50

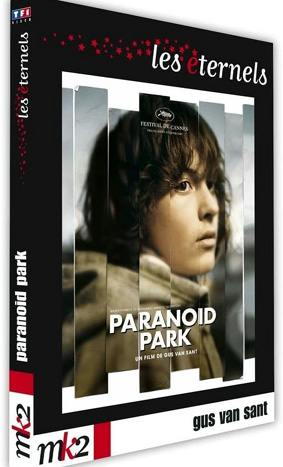










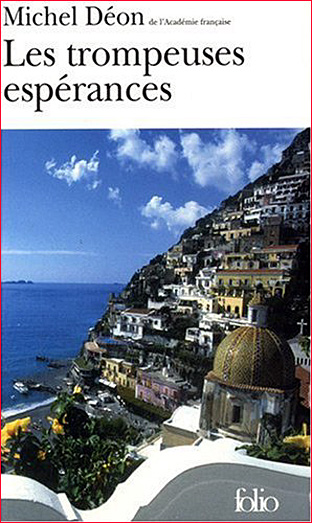
Commentaires récents