Un roman sur la vie en sanatorium qui fut oublié… jusqu’au Covid-19. Car la tuberculose, due au bacille de Koch, est restée une loterie de santé jusqu’aux antibiotiques. Les gens mouraient – ou non – selon leur robustesse, confortant la mentalité sociale-darwiniste de l’entre-deux guerres. Le conflit de 14-18 (la guerre décidément la plus con) avait « brutalisé » les âmes et raidi les comportements. Les hommes se voulaient plus mâles et les femmes se devaient d’être plus soumises, la proie des « bêtes » de proie des virils qui les « tombaient » comme un exploit. Marc Oetilé est un jeune homme de cette trempe : « Mais n’était-ce pas son métier viril, ne le faisait-il pas avec succès et élégance ? » p.306 Pléiade. Son passage en sana va le convertir à l’humanité.
Tout le monde est captif de la prison sociale. Il doit faire « comme il se doit », selon les conventions de son temps. Le guerrier revenu de quatre ans de tranchées et de gaz ne peut être cet efféminé de l’arrière qui fait des ronds de jambes et porte attention aux vapeurs des femmes. Marc, exaspéré par une mère frivole et bordélique qui l’a privé de son père très tôt par divorce, en veut à la gent femelle tout entière. Il se consume en fêtes, alcools et conquêtes sans lendemain ; il ne voue un attachement qu’aux automobiles, mécaniques logiques, fidèles et froides – efficaces. Ce n’est que lorsqu’il se trouve atteint par la maladie et qu’il fait plusieurs mois l’expérience du mouroir d’altitude au sanatorium pour gens chics, qu’il découvre l’humanité des autres et se repent. C’est une véritable conversion à la charité d’essence religieuse, même si lui ne l’est pas et que passe, en une phrase, un rabbin.
L’hôtel sanatorium du Pelvoux en Suisse est le microcosme d’un monde blessé et Marc se rend compte du factice social qu’il y a à constamment faire semblant : d’être courageux, en rémission, d’avoir les moyens, de faire la fête à Noël comme si de rien n’était. Les divertissements comme le poker ou le whisky étourdissent, comme les soirées habillées. La quête permanente d’un amour impossible révèle le manque fondamental de ces humains livrés à leur sort. C’est la misère affective, Marc refuse à Thérèse une simple tendresse pour ne pas être « attaché » : « Il parut à Marc qu’elle cherchait à obtenir de lui un engagement. Et d’engagement, si limité qu’il fut, il n’en voulait pas. Toute sa brutalité d’ailleurs se trouvait déchaînée, toute sa haine contre l’empire que les femmes tâchaient de prendre » p.308 Pléiade. Louvier joue avec Edith pourtant sa fiancée : « Dès qu’on veut me tenir – coup de frein et marche arrière » p.316. Marthe voue au très jeune Pierre un amour interdit qui les consume tous les deux, le coiffeur Portin qui a prêté son masque à gaz à un compagnon de combat et a été affaibli du poumon a attrapé la tuberculose et contaminé sa femme – qui en est morte. L’amour est « une duperie mutuelle », l’un cherchant le sexe où l’autre réclame l’affection, la conquête contre la durée, la séduction d’un soir contre la relation durable…
L’enfermement des montagnes enferme le sanatorium qui enferme les corps malades renfermés dans leurs conventions sociales. Les captifs sont aliénés physiques, moraux et spirituels. Marc est moins touché au corps et se remet ; il voit mourir les autres et cela finit par le toucher à l’âme. Notamment Michelle, cette jeune fille de 16 ans qui vient de Tunisie où ses parents tiennent une fabrique d’huile qui fait faillite. La môme aux grands yeux craint et admire l’homme fait. Marc lui fait peur et en même temps l’attache, figure paternelle pour qui a manqué d’affection. Le jeune homme trouve en elle son double inversé en son adolescence et cela le fascine et l’émeut. Il devient le « porteur » de Michelle dans la vie jusqu’à la mort – malheureusement trop proche et programmée. Porteur comme le porteur de Christ, Christophe de Lycie, réprouvé devenu saint pour avoir aidé un enfant (Jésus incognito) à traverser la rivière. Il est la force brute mise à la disposition de la faiblesse vulnérable, l’offrande du fort au faible, le rapport de force inversé en générosité, la charité humaine.
Portin qui épouse bien au-dessus de sa condition la fille Verneuil qui s’est donnée à tous pour des instants de tendresse, le docteur Albert qui veut « sauver » ses malades au détriment de sa vie familiale, sont des exemples multipliés de rémission spirituelle dans ce monde malade. Les « soignants » sont des héros, ils ne sont pas que médicaux.
Dans ce roman inspiré de sa propre expérience avec sa femme Sandi, morte de tuberculose dans un sanatorium, Kessel cherche à transfigurer sa peine et la portant à l’universel. Nous sommes dans les tranchées de la guerre, dans les camps de prisonniers en Allemagne, au goulag de Soljenitsyne ; nous sommes dans tous ces lieux d’enfermement hors du monde qui révèlent le monde tel qu’il est en faisant ressortir le meilleur et le pire en l’être humain. Huis clos : l’enfer, ce n’est pas les autres car ils peuvent ouvrir au paradis.
Joseph Kessel, Les captifs, 1926, Folio 1992, 224 pages, €6.90
Joseph Kessel, Romans et récits tome 1 – L’équipage, Mary de Cork, Makhno et sa juive, Les captifs, Belle de jour, Vent de sable, Marché d’esclaves, Fortune carrée, Une balle perdue, La passagère du Sans-Souci, L’armée des ombres, Le bataillon du ciel, Gallimard Pléiade 2020, 1968 pages, €68.00

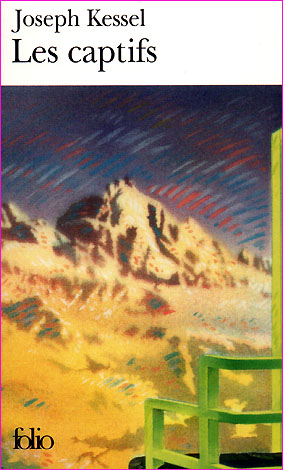

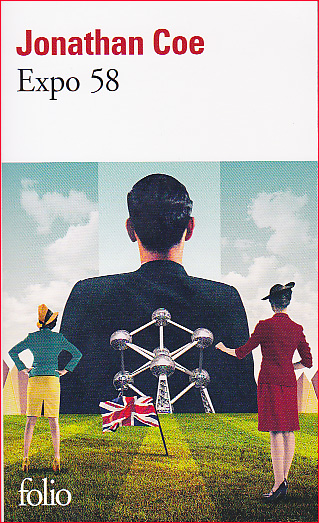




Commentaires récents