Carla, une femme de trente ans (Barbara Hershey), rentre chez elle dans sa maison de Los Angeles. Elle apprend la dactylo en cours du soir pour avoir une meilleure situation et est mère de trois enfants d’hommes différents, qu’elle élève seule avec volonté et affection. Comme d’habitude, son fils aîné Billy, 16 ans (David Labiosa, 20 ans au tournage), n’a pas débarrassé la table où il a dîné avec ses demi-sœurs Julie, 10 ans (Natasha Ryan) et Kim, 6 ans (Melanie Gaffin). Il est occupé à bricoler dans le garage, la musique rock à fond ou presque. Carla a eu Billy lorsqu’elle avait 16 ans et il ressemble fort à son père, à peine plus âgé à l’époque, qui s’est tué en moto peu après.
Les filles dorment dans leur chambre et Carla se prépare pour la nuit, épuisée de sa journée. C’est alors qu’elle est poussée sur le lit, à demi étouffée par un oreiller, et qu’elle subit des coups de boutoir au bas ventre au rythme de batterie. Lorsque l’emprise se lâche, elle hurle : elle a été violée. Mais Billy qui accourt aussitôt de sa chambre voisine constate que personne n’est dans la maison et que toutes les fenêtres et la porte sont verrouillées…
C’est le début d’une panique, le phénomène se reproduisant plusieurs fois dans l’émotion outrée et un érotisme torride. Tremblement des objets, explosions de fenêtres, étincelles électriques, voiture devenue folle et ne répondant pas au frein (une antique Chevrolet bas de gamme), caresses sur les seins dans un demi sommeil, viols répétés dans la chambre, la salle de bain, sur le canapé du salon (caméra bloquée au-dessus de la ceinture) devant les trois enfants – qui ne voient personne. Billy, vigoureux jeune homme, tente de relever sa mère mais est immobilisé par une force inconnue qui le traverse d’arcs électriques puis le projette à terre où il se casse le poignet (l’acteur s’est cassé le bras sur une cheminée, ce qui n’était pas prévu, d’où la scène).
Fuyant la maison la première fois, Carla se réfugie chez une amie dont le mari ronchon voit cela d’un sale œil. Cette amie lui conseille d’appeler la police, mais aucune preuve d’individu quelconque ni d’effraction. Serait-ce une simple illusion ? Elle lui conseille d’aller consulter un psychanalyste. C’est cher ? Pas si l’on consulte à l’Université de Californie où des docteurs font des recherches ; son cas peut les intéresser. Le docteur Sneiderman (Ron Silver) au nom inévitablement juif – image de marque des psys aux Etats-Unis – lui fait raconter les événements puis évoquer son enfance.
Carla se dit fille de pasteur et que son père venait l’embrasser le soir, mais pas comme un père embrasse son enfant… Elle a subi une éducation rigide où le péché suprême était le sexe et a fui la maison dès 16 ans avec un garçon avec qui elle a eu de suite un enfant. Après sa mort, elle a connu un autre homme qui lui a fait deux filles ; elle était bien avec lui, elle aimait le sexe, mais lui ne tenait pas en place et il est parti. Elle vit désormais en chef de famille bien qu’elle ait un compagnon rassurant, Dennis, qu’elle voit lorsque les « voyages » qu’il doit faire pour son travail lui en laissent le temps. Il a l’intention de l’épouser mais attend pour cela un poste à los Angeles. Cela fait un mois qu’elle ne l’a pas vu.
Le psychanalyste diagnostique assez naturellement une « hystérie » à base sexuelle, selon le freudisme dogmatique ambiant. Des événements marquants de l’enfance ressurgissent de l’inconscient de façon brutale et engendrent des hallucinations émotives violentes allant jusqu’aux marques physiques (la somatisation). Pourtant, certaines marques peuvent difficilement avoir été faites par Carla elle-même dans sa transe. Elle décrit deux mains qui la plaquent (dont elle a l’empreinte aux épaules), un genou qui l’écarte (dont elle a les bleus sur chaque face interne de cuisse) et deux autres mains « plus petites » qui lui immobilisent les chevilles (marquées elles aussi). Un homme fort et deux aides plus réduits, bon sang mais c’est bien sûr ! C’est un fantasme incestueux sur Billy, jeune homme musclé qui ressemble tant à son père, à l’aide de ses deux petites sœurs !
Cette allusion déplaisante conduit Carla à en briser là. Le psy ne peut rien pour elle, ne l’aide pas. Elle est consciente de ses désirs et de son appétit sexuel insatisfait, mais elle doute de la raison trop logique. Elle aimerait bien que ces phénomènes brutaux s’arrêtent mais elle ne croit pas en être responsable au fond d’elle-même, et surtout pas en fantasmant sur son jeune mâle attirant de fils. Ce dernier se montre d’ailleurs affectueux mais physiquement distant, ne s’exhibant jamais torse nu par exemple, alors que l’époque de l’histoire, 1976, surtout en Californie hippie où le climat est très clément, incitait les garçons à ôter volontiers leur tee-shirt. Il préfère encore, à son âge, bricoler la mécanique que les filles.
Un autre département de l’université s’intéresse à elle : le parapsychologique. Elle a rencontré deux chercheurs à la librairie où elle prospecte les livres de paranormal pour tenter de comprendre. Ils croient tenir avec elle « un cas » d’expérience utile à leurs recherches, un vrai témoin non frappé de folie sur le poltergeist et autres déplacements d’objets. Sous la direction du docteur Cooley (Jacqueline Brookes), ils envahissent alors la maison de préfabriqué où même la tuyauterie grince de façon maléfique sous le plancher, et la bardent d’appareils de mesure et de photo.
L’Entité (titre du film américain) se manifeste sans vergogne et l’un des assistants réussit à photographier des éclairs électriques qui dessinent une vague silhouette humaine. Mais les « preuves » sont minces. Ne peut-il s’agir d’hallucination collective ? Tiré du roman de Frank De Felitta, The Entity, paru en 1978 et sorti d’un fait « vrai » qui a eu lieu en 1976 en Californie selon le bandeau final, le film joue de l’ambiguïté entre science et conscience. L’esprit est-il mesurable ? La conscience de soi ne peut-elle créer des « forces » extérieures analogues aux Toulkous évoqués par Alexandra David-Neel au Tibet ? Mais aussi : les chercheurs sont-ils humains ? Tout réduire à l’analyse mesurable, tout mathématiser, est-ce la bonne méthode pour saisir un cas humain qui ne peut être que global ? Ne cherchent-ils pas avant tout « le cas d’expérience » pour accéder à la notoriété plutôt qu’aider leur prochain ?
Après un viol particulièrement brutal, plaquée entièrement nue sur son lit tandis que des forces pelotent ses seins et son ventre (gros plans érotiques) et qu’un bélier lui défonce l’entrecuisse sur un rythme disco tonitruant, les parapsys tentent avec son accord une expérience entièrement contrôlée. Carla n’en peut plus et est prête à tout tenter pour faire cesser ces cauchemars. D’autant que son dernier viol a eu lieu sous les yeux horrifiés de son copain Dennis, revenu à Los Angeles définitivement et qui est prêt à l’épouser. Elle lui crie « help me ! » – aide-moi – mais elle jouit sous ses yeux. Il tente de la saisir, comme naguère Billy, et est repoussé avec violence comme lui. Il attrape alors une chaise pour fracasser le crâne du démon qui se cache sous la femme, mais le brave Billy se jette sur lui et l’en empêche in extremis. Carla accepte donc l’expérience ultime qui va consister à reconstituer sa maison dans un hangar de l’université, de placer des caméras partout et de commander des jets d’hélium liquide pour « emprisonner » l’Entité dans le froid intégral – et la tuer.
Mais rien ne se passe comme prévu et le docteur Sneiderman, qui s’est attaché à sa patiente (ce qui est curieux, en général c’est l’inverse, connu sous le nom de « transfert »…) intervient. La force est emprisonnée sous la glace mais la fait exploser. Ne reste plus alors qu’à déménager, très loin, au Texas. Il est dit en bandeau final que la famille a retrouvé la paix, les mêmes faits s’étant reproduits mais atténués. Le grand guignol du réalisateur est alors d’avoir introduit une scène finale inepte, où une voix profonde déclare, après avoir claqué la porte du logement vide où Carla explore une dernière fois les pièces, « content de te voir de retour à la maison, salope ! » Cette bouffonnerie non seulement n’était pas nécessaire mais elle gâche l’ambiance du film, fondée sur le non-dit et le non-vu. Une Entité qui parle comme le vulgaire, est-ce bien raisonnable ?
Prix d’interprétation féminine Festival d’Avoriaz 1983
DVD L’emprise (The Entity), Sidney J. Furie, 1981, avec Barbara Hershey, Ron Silver, David Labiosa, BQHL éditions 2019, 2h 04, €19.99











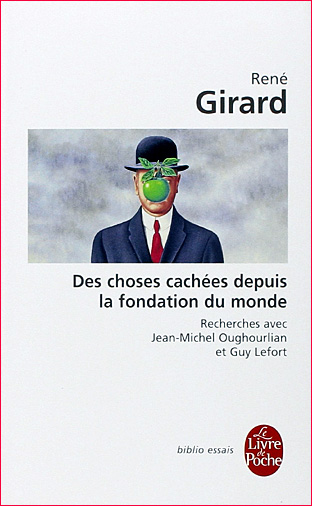

Commentaires récents