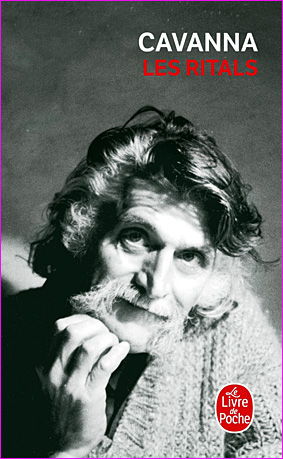
François Cavanna, décédé à 90 ans en 2014, fondateur de Charlie hebdo après Hara-kiri, journaux satiriques nés après 1968 dans l’anarchisme libertaire (de gauche), n’est qu’un demi Rital. Sa mère est en effet Nivernaise et le gamin, bien qu’élevé dans le nid de l’immigration italienne des années 1920 à Nogent, non pas le gros trou mais Nogent-sur-Marne proche de Paris, se trouve plus grand que les autres, moins brun et moins frisé.
Dans ce récit romancé de son enfance, il raconte sa vie et son milieu de l’âge de 4 ou 5 ans, lorsque débutent ses souvenirs, jusqu’à 16 ans en 1939, alors qu’il vient de passer le brevet et que la guerre se déclenche. Il prend volontairement un style rabelaisien, gouailleur, forçant le trait. Il utilise notamment le sabir italianisant de son père pour émailler ses chapitres de phrases baragouinées qui font « vrai ». « Diou te stramaledissa ! » est par exemple l’expression de colère favorite de papa : « que Dieu te supermaudisse ». C’est intéressant, parfois plaisant, parfois pénible à lire, comme ce chapitre entier sur une histoire de curé qu’il faut déchiffrer syllabe après syllabe pour comprendre qu’elle n’a en fait pas de sens.
L’existence immigrée de ces années d’entre-deux-guerres est peinte comme une sorte de paradis joyeux ou les bandes de gosses, innombrables dans les rues, mêlant tous les âges, se baignent à poil dans la Marne, pataugent pieds nus dans le caniveau, sans les jouets que les bourgeois croient indispensables. Ils se connaissent et s’amusent de mille façons car ce sont les relations qui comptent, et l’affection des uns pour les autres, celle des parents, celle de la famille, mais surtout celle des pairs. On se peigne en jouant à l’assaut du fort, on protège les petits, on étrille les filles en les poursuivant en bande dans les rues, on baisse les petites culottes pour toucher et sentir (ce qui ne plaira pas à notre époque plus prude qu’en ces années-là), mais tout reste bon enfant et les blessures ne sont que superficielles.
Le jeune Fransva, comme prononce son père, est un boulimique de lecture. Les mots l’attirent et il les absorbe comme des bonbons, y compris les étiquettes des boîtes de conserve et même le nom et l’adresse de l’imprimeur à la fin des livres. Il emprunte le maximum de ce qu’il peut à la bibliothèque municipale de Nogent, ayant inscrit son père qui ne sait pas lire et sa mère qui n’a pas le temps, en plus de lui-même, pour cumuler le plus de prêts possibles à la semaine. Il lit tout. Même les feuilles de journal pour s’essuyer aux chiottes et les bandes dessinées de l’époque comme Bibi Fricotin ou Pierrot. Il dessine aussi, parce qu’il s’ennuie en cours et qu’il est en avance, ou pour amuser les copains. Il crée ainsi le mouvement avec deux feuilles de papier roulées sur lesquels les dessins se superposent avec chacun un mouvement juste différent ce qui donne, en l’actionnant avec le manche d’un crayon, l’illusion de voir un boxeur boxer ou un jeune homme niquer.
Le sexe est d’ailleurs le sujet de toutes les conversations, les Ritals (on ne dit pas les Ritaux) étant catholiques mais paysans, donc peu portés aux pruderies petite-bourgeoises des curés effarouchés. Même le parmesan a « une odeur femelle » ! Cavanna ira au bordel avant ses 16 ans, probablement vers 14 puisqu’il a déjà une taille adulte, tout comme son ami de 13 ans qui en fait 20 et Pierine de 13 ans qui en fait 11… À l’époque, les filles comme les maquerelles aimaient bien l’extrême jeunesse et s’efforçaient d’initier les garçons pubères au sexe hétéro sans heurts ni dommages.
À 14 ans, ayant passé le certificat d’études depuis deux ans et ayant assez de l’école supérieure qui prépare au brevet mais qu’il ne peut passer avant 16 ans, il fugue avec son copain Jojo. Ils partent en vélo un matin avant l’aube et passent dix jours à pédaler dans la campagne vers le sud, prenant la pluie, dormant sur la paille et épuisant leurs économies. Ils avaient le rêve d’aller à Marseille s’engager comme mousses mais renoncent au bout de quelques jours, ayant déjà la nostalgie de leur famille et de leurs quartiers. Mais ce fut une belle expérience, du genre qu’il faut laisser faire aux adolescents.
Mine de rien, le récit de l’enfance donne des leçons aux lecteurs. C’est le cas par exemple du racisme, fort développé dans les années 1930 en France par la presse d’extrême-droite et dans le délitement de la démocratie parlementaire, tandis que fascisme et nazisme prenait leur essor viril et glorieux. Si le jeune François admirait fort Tarzan, il n’a jamais aimé être embrigadé et les jeunesses italiennes ou allemandes en uniforme ne l’ont jamais tenté. Il décrit le racisme comme une réaction de crainte et d’ignorance des populations fermées sur elles-mêmes. Ainsi le petit-bourgeois français méprise-t-il l’ouvrier immigré italien, tandis que l’ouvrier italien du Nord méprise le manœuvre italien du Sud, lequel méprise le Marocain, qui se sent supérieur aux « négros ». Ainsi va la hiérarchie. Il est à noter que l’Allemand méprise le Français, pour lui bougnoulisé, tandis que l’Américain méprise l’Européen qui lui paraît archaïque, latino et somme toute un peu négro. De fil en aiguille, le baratineur nous emmène où il veut : que le racisme est au fond imbécile et fondé sur rien.
Né en 1923 – en France – François Cavanna a bien vécu son enfance, ce qui l’a préparé sans aucun doute aux turbulences qu’il allait connaître dans sa jeunesse et sa vie d’adulte. Il a eu 10 ans à l’arrivée d’Hitler au pouvoir et 16 ans à la déclaration de guerre. Il n’a pas été mobilisé parce que trop jeune, mais ne coupera pas au STO, ce qui fera l’objet d’un récit romancé ultérieur.
Cette vie de Rital mérite d’être lue pour sa gouaille et son humanité.
François Cavanna, Les Ritals, 1978, Livre de poche 2000, 287 pages, €8.20







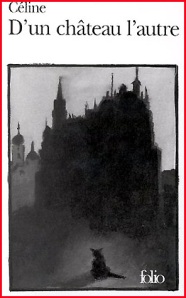


Commentaires récents