Le fascisme n’existait pas encore à l’époque de Nietzsche (mort en 1900) mais il était en germe dans les nationalismes qui bouillonnaient depuis les révolutions du XVIIIe siècle. Le pangermanisme de la Grossdeutschland, le patriotisme italien 1830 de Mazzini (qui deviendra fascisme après la Première guerre mondiale avec Mussolini) s’agitaient du temps de Nietzsche. Le calviniste strict Thomas Carlyle, chantre du héros qui « doit se faire le trait d’union entre (les hommes) et le monde invisible et sacré » publie en 1841 On Heroes, Hero-Worship and the Heroic in History (Les Héros, le culte des héros et l’héroïque dans l’Histoire). Nietzsche pourfend toute cette pose « sublime ».
« J’ai vu aujourd’hui un homme sublime, un homme solennel, un pénitent de l’esprit. Oh ! comme mon âme a ri de sa laideur ! » Car, pour Nietzsche, le sublime n’est pas la grandeur, ni le héros un maître qui s’est maîtrisé. « Il n’a encore appris ni le rire ni la beauté, l’air sombre ce chasseur est revenu de la forêt de la connaissance. Il est rentré de la lutte avec des bêtes sauvages : mais sa gravité reflète encore une bête sauvage – une bête insurmontée ! Il demeure là, comme un tigre qui va bondir, mais je n’aime pas les âmes tendues comme la sienne. » L’habit ne fait pas le moine, l’attitude ne fait pas le grand homme. Le théâtre du sublime, pose romantique par excellence tellement mise en scène par un Victor Hugo, n’est qu’une pose, pas le fond de l’être.
L’attitude doit être surmontée pour devenir naturelle. C’est alors que le sublime devient grand. Pas avant. « S’il se fatiguait de sa sublimité, cet homme sublime, c’est alors seulement que commencerait sa beauté – et c’est alors seulement que je voudrais le goûter et lui trouver de la saveur. Ce n’est que lorsqu’il se détournera de lui-même, qu’il franchira son ombre, et, en vérité, ce sera pour sauter dans son soleil. » Il deviendra lui-même lorsqu’il incarnera ce qui n’est alors que son image, son ombre, ce qu’il voudrait être sans pouvoir l’accomplir.
Car l’homme grand est celui qui se surmonte, pas celui qui prend une pose avantageuse à la télé ou dans les meetings. Au contraire, l’histrion politique n’est pas un grand homme mais un acteur de sa propre image. « Sa connaissance n’a pas encore appris à sourire et à être sans jalousie. Son flot de passion ne s’est pas encore apaisé dans la beauté. (…) La grâce fait partie de la générosité des grands esprits. » Mais c’est ce qu’il y a de plus dur, de quitter son image pour devenir soi ; de ne plus être un personnage mais un être réel. « C’est précisément pour le héros que la beauté est de toute chose la plus difficile. La beauté est insaisissable pour toute volonté violente. (…) Rester les muscles inactifs et la volonté dételée : c’est ce qu’il y a de plus difficile pour vous autres, hommes sublimes. »
Laisser être… tel est le secret de la sagesse – et de la volonté. Le désir vers la puissance est le principe de la vie mais il doit s’accomplir naturellement, pas le ventre noué, le cœur en chamade et l’esprit focalisé au point de ne plus rien voir d’autre que le pouvoir. La générosité, la bienveillance, sont un débordement de la force, pas un effort qu’il faut faire. « Quand la puissance se fait clémente et descend dans le visible : j’appelle beauté une telle condescendance. Je n’exige la beauté de personne autant que de toi, de toi qui est puissant, que ta bonté soit ta dernière victoire sur toi-même. » Car ce ne sont pas les débiles qui sont bons, faute de pouvoir être méchants : les bons sont ceux qui peuvent être bons parce qu’il en ont la force surnuméraire.

Comment ne pas penser à Mussolini et à ses poses avantageuses, « la poitrine bombée, dit Nietzsche de l’homme sublime, semblable à ceux qui aspirent de l’air » ? Comment ne pas songer à ces socialistes, sourcils froncés, à ces écolos « en urgence » permanente, qui se croient toujours les messagers de l’avenir ? Ou à ces prophètes de droite extrême qui se croient mandatés par « le peuple » et dont « l’action elle-même est encore une ombre projetée » sur eux. « Je goûte beaucoup chez lui, la nuque de taureau, dit encore Nietzsche de l’homme sublime, mais maintenant j’aimerais voir encore le regard de l’ange. Il faut aussi qu’il désapprenne sa volonté d’héroïsme, je veux qu’il soit un homme élevé et non pas seulement un homme sublime. »
Où l’on mesure combien Nietzsche était loin de ce qui deviendra le fascisme et le nazisme. Il voyait en la recherche de puissance le principe de la vie, mais une vie qui déborde en générosité, pas en contraintes de toutes sortes.
(J’utilise la traduction 1947 de Maurice Betz au Livre de poche qui est fluide et agréable ; elle est aujourd’hui introuvable.)
Friedrich Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra, 1884, traduction Geneviève Bianquis, Garnier Flammarion 2006, 480 pages, €4,80 e-book €4,49
Nietzsche déjà chroniqué sur ce blog


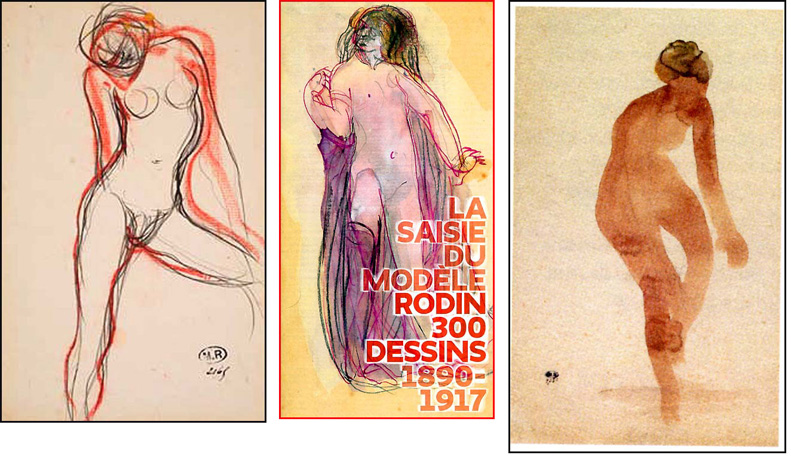
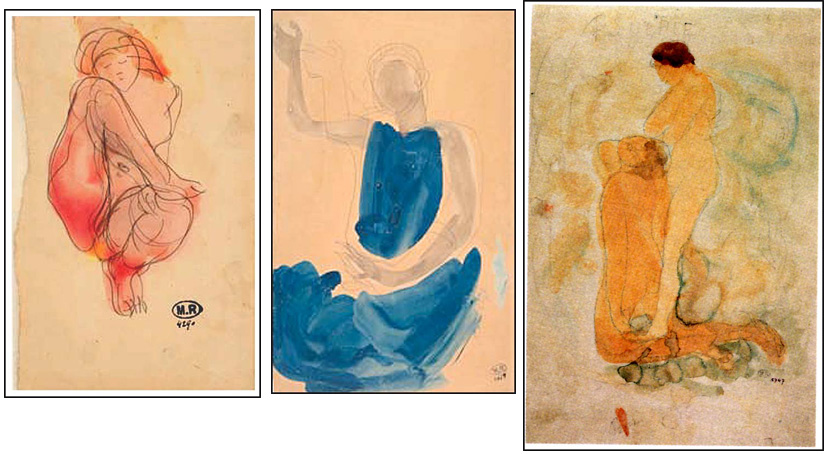
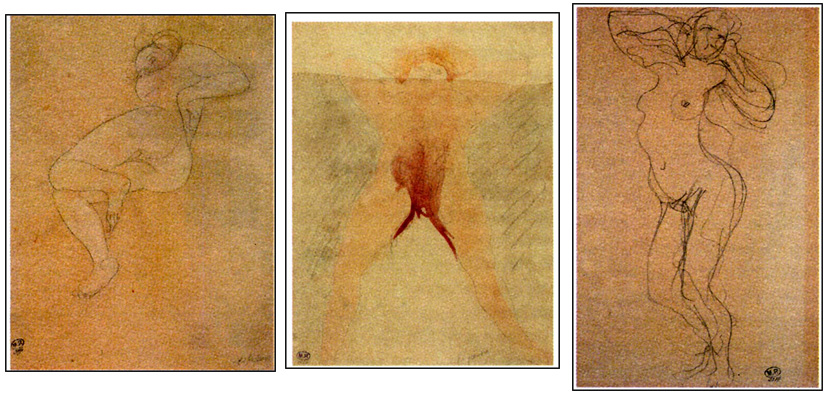
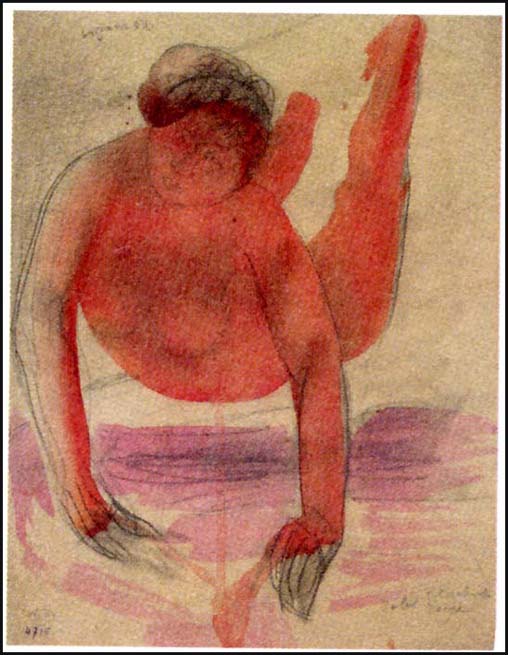

Commentaires récents