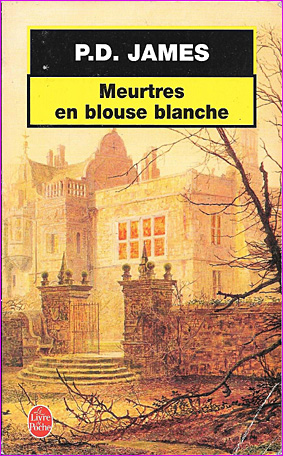
Un hôpital dans la campagne proche de Londres ; une école d’infirmière attenante, dans laquelle une inspectrice de la DASS anglaise s’apprête à observer une séance pratique où le patient doit être nourri par sonde gastrique. Une élève infirmière, Heather Pearce, joue le rôle du patient. Toute la salle est attentive. On procède selon les rites, la sonde est introduite, le lait réchauffé à la température du corps est versé par l’entonnoir… Et là, catastrophe ! Un hurlement sauvage, la victime qui se tord de douleur et qui finit par décéder malgré tous les soins apportés par le médecin chirurgien présent.
Ce n’est pas un accident, c’est un assassinat et le Yard est prévenu. Le commissaire Adam Dalgliesh et son inspecteur Masterton (alors 28 ans), se chargent d’interroger tous les présents. La médecine légale montre que le « lait » a été remplacé par un détergent, dont justement la bouteille des toilettes a disparu. Ce n’est pas la première fois que l’on confond ce détergent avec du lait, on se demande pourquoi le fabricant n’a pas l’injonction de le colorer. Mais nous sommes en 1970, et les soucis environnementaux ou de santé publique sont de faible importance.
Est-ce une blague qui a mal tourné, ou en voulait-on vraiment à Heather Pearce, fille guère aimée dans ce milieu clos des filles entre elles ? Suit presque aussitôt la mort de Joséphine Fallon, autre élève infirmière, studieuse mais peu liante, découverte au matin dans son lit. Empoisonnement ? Se serait-elle suicidée, avouant ainsi son crime ? Ou l’a-t-on fait taire pour d’obscures raisons ? Il s’avère que, là encore, l’assassin a pris ce qu’il avait sous la main, en l’espèce de la nicotine pure qui servait à désinsectiser les roses de la serre. Qui avait accès à cette serre ? Qui connaissait ce poison ? Pas de hasard, les infirmières apprennent les poisons et l’acte a été accompli sciemment. Il y a donc nouveau crime. Les deux sont-ils liés ?
Dalgliesh et Masterton vont sonder les âmes, de façon un peu plus physique pour le jeune Masterton qui n’hésite pas à payer de sa personne auprès d’une jeune fille et d’une femme mûre pour extirper des renseignements. Mais chacun craint pour sa position, son pouvoir, la respectabilité de l’établissement. Les infirmières, fortes de leur savoir reconnu, se méfient des hommes, qu’elles trouvent portés à l’égoïsme. Peu à peu, le puzzle se met en place. Dans ce huis-clos où tout se sait, tout le monde se connaît, tout fermente, le passé ressurgit et conduit au chantage. Les caractères névrosés se révèlent.
Phyllis Dorothy, qui connaît bien le milieu médical pour y avoir travaillé, fouille les personnalités de ces filles qui veulent exercer un métier de soins. Parfois empotées et banales dans le civil, certaines se révèlent empathiques et à l’écoute de leurs patients ; d’autres se vengent de leur enfance malheureuse sur leurs pairs. La directrice Mary Taylor gère ces egos tandis que le grand patron, le docteur Courtney-Briggs, content de lui et compétent, avoue avoir eu une liaison avec l’une des victimes. Le commissaire Dalgliesh va tirer de tout ce fatras humain et psychologique un fil conducteur – et parvenir à la vérité. Qui rebondit au dernier moment, faisant de ce roman du grand art – et qui a assuré alors le succès de l’auteur.
Phyllis Dorothy James, Meurtres en blouse blanche (Schroud for a Nightingale), 1971, Livre de poche1991 , 351 pages, €3,50, e-book Kindle €6,99
(mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés par amazon.fr)
Les romans policiers de PD James déjà chroniqués sur ce blog

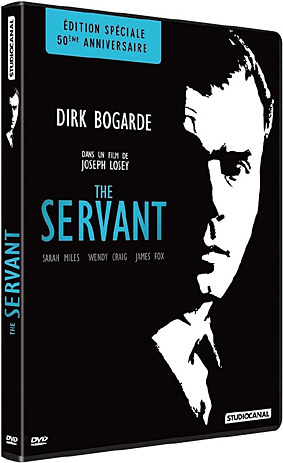

























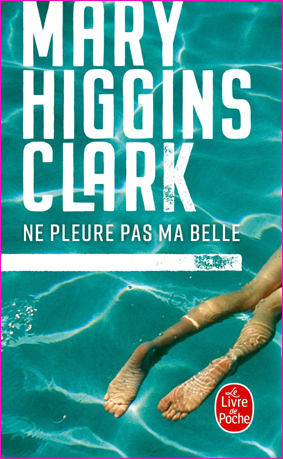











Commentaires récents