Aujourd’hui, les cheminots de la société nationale des chemins de fer français adorent emmerder les gens. Ils choisissent toujours les week-ends de grands départs, ou les veilles de vacances, ou encore les épreuves du bac, pour déclencher leur grève. Soi-disant parce que « l’Etat-patron » les opprime, ne les paye pas assez, les soumet à des horaires de chiourme. En 1909, du temps où le philosophe Alain écrivait ses Propos, c’était la Poste. Le courrier était vital, surtout dans les campagnes, où il reliait les gens et les familles. C’est moins vrai aujourd’hui avec le smartphone, la visioconférence, les mél – même si les drogués du « toujours plus » adorent consommer encore et toujours en commandant via le net pour se faire livrer dans la journée. Mais ce n’est que caprice qui peut être ignoré. Le voyage, en revanche, surtout si l’on a prévu et « réservé », est beaucoup moins accommodant.
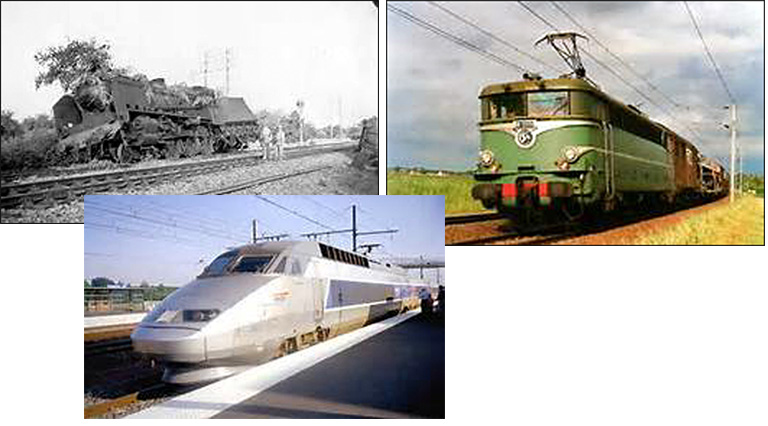
Les grévistes en profitent, croyant (assez bêtement à mon avis, et au vu de l’histoire depuis cinquante ans) que l’exaspération des gens finira par peser sur la Direction de la SNCF, via « le gouvernement » (que fait le gouvernement ?). Ce n’est pas la vérité. Le citoyen paye des impôts (même ceux qui n’en payent pas « sur le revenu » faute d’en avoir un suffisant), et ces impôts renflouent sans cesse et toujours l’extravagant « déficit » de la SNCF, les travaux à faire, les infrastructures qui s’usent. Les cheminots ont beau dire que la SNCF « fait des bénéfices », ce n’est que la partie commerciale, pas le Réseau. Il a été détaché dans une entité séparée pour cause de Directive Concurrence européenne, mais sa dette reste abyssale. Le train n’est pas une activité commerciale rentable, on l’a vu au Royaume-Uni, où les dénationalisations ont accouché de compagnies privées qui ne sont pas profitables, même si elles réduisent les travaux au minimum.
Donc les syndicats ont tort, qui croient gouverner à la place des gouvernants, qui croient user de « bon sens » en réclamant une part des « bénéfices » affichés comptablement (mais pas consolidés avec le Réseau). Ils agissent non pour l’intérêt général, mais pour leur intérêt particulier corporatiste. Leur grève n’est jamais vraiment légitime, même si réclamer de meilleurs salaires peut l’être.
Mais sont-ils si « mal payés », ces conducteurs ? Selon Capital, avec un niveau minimum BEP ou BEPC (ce qui n’est pas grand-chose, et « à l’issue de la formation initiale, le conducteur junior touche un salaire au Smic (1 801,80 euros brut, soit environ 1 426 euros net) hors primes. Un conducteur de manœuvre et lignes locales gagne ensuite jusqu’à 2 000 euros bruts par mois, et un conducteur de ligne touche entre 2 500 et 4 000 euros bruts mensuels. Le conducteur de TGV est le grand gagnant, avec un salaire autour de 4 800 euros bruts, primes comprises. » Ce n’est pas le bagne, comparé aux policiers, aux profs, aux employés de banque, et ainsi de suite… Sans même évoquer « de nombreux avantages et primes qui comptent pour beaucoup dans le montant total de la rémunération : une aide au logement, une prime de fin d’année, mais surtout des voyages à des prix avantageux. »
« Nous allons vers l’esclavage universel », en conclut il y a déjà un siècle le citadin chez Alain. « Nous en viendrons à dépendre tellement les uns des autres qu’il n’y aura plus ni liberté ni amitié parmi les hommes. Chacun de nos besoins sera l’esclave d’un système distributeur ou nettoyeur, comme sont déjà les postes, la lumière et le tout-à-l’égout. Nous serons nourris par compagnie ou syndicat, comme nous sommes maintenant transportés. Une menace de grève sera une menace de mort. » Certes, Lénine voyait dans « le communisme » la poste plus l’électricité ; le système hiérarchisé, organisé, robotisé, convenait à sa façon de faire une société. Mais ni la Poste, ni la SNCF ne sont des tyrannies – même si certains « contrôleurs » prennent leur rôle de petits-chefs un peu trop à la lettre, et se croient tout-puissants, selon la revue indépendante Que Choisir.
Non, dit Alain « on ne vit pas longtemps dans la terreur et l’esclavage. On s’arrange. » Hum ! Il n’avait pas encore connu le communisme de Lénine et Staline, réactivé par Poutine… Mais il est vrai que les gens s’y adaptent, faisant profil bas, dans l’indifférence de ce qu’ils ne peuvent changer. « Les Français sont des veaux », disait de Gaulle (avant mai 68). Les Russes aussi aujourd’hui. Et les « usagers » de la SNCF aussi, même si l’image de l’entreprise se dégrade. Les sondages le montrent.
Ce que veut dire Alain, et il l’explique plus avant dans son Propos d’avril 1909, est que l’homme n’est pas un loup pour l’homme, sinon ce serait l’anarchie et l’éradication de l’espèce sur la terre. Chacun vit en paix avec son voisin, en général. « Je compte sur votre bon sens, sur leur bon sens », dit-il. Il est en cela rationnel, raisonnable, modéré, Alain. A écouter les éructations trotskistes de certains députés « insoumis » à l’Assemblée, ce n’est pas le cas de tous, aujourd’hui. Mais c’est le cas dans la société, globalement. « J’avoue que je compte sur l’Humanité. Que les hommes qui travaillent prétendent élever les salaires, et s’unir pour cela, je ne m’en effraie point, je ne m’en étonne point. C‘est la Raison qui pousse, comme poussent les seigles et les blés. » De là à supposer que la plupart des hommes vont se concerter afin de rendre la vie impossible aux autres et à eux mêmes, et être déraisonnables (sauf à l’Assemblée nationale où il s’agit d’une stratégie politicienne), c’est excessif.
Donc les grèves sont des manifestations de mauvaise humeur acceptable. En revanche, trop de grèves exprès dans les périodes cruciales pour les gens (comme les examens, les week-ends familiaux ou les vacances) sont inacceptables, c’est aller trop loin. Alain prêche la modération et la raison, le balancier qui ramène à la moyenne les exaspérations. Intellectuellement, c’est une façon de voir séduisante ; sur le terrain, c’est moins sûr.
Alain, Propos tome 1, Gallimard Pléiade 1956, 1370 pages, €70,50
(mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés par amazon.fr)
Alain le philosophe, déjà chroniqué sur ce blog

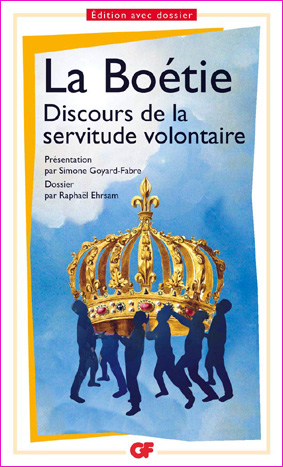



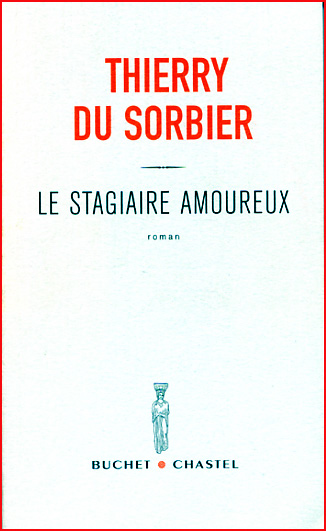
Commentaires récents