 Discours du Pape à Noël, « tous frères », « haine absurde » et blabla. C’est gentillet et complètement hors du temps. Que se passe-t-il vraiment entre religions du même Livre ? L’exclusion réciproque, le chacun chez soi, le Dieu avec moi tout seul. Pour ne pas être dupe du baratin idéaliste, lisez le voyage en pays réel d’un intello français honnête – il en reste.
Discours du Pape à Noël, « tous frères », « haine absurde » et blabla. C’est gentillet et complètement hors du temps. Que se passe-t-il vraiment entre religions du même Livre ? L’exclusion réciproque, le chacun chez soi, le Dieu avec moi tout seul. Pour ne pas être dupe du baratin idéaliste, lisez le voyage en pays réel d’un intello français honnête – il en reste.
Cet essai, dédié à Jacques Chirac et à François Maspero, est issu d’une rencontre intellectuelle avec le second et d’une mission confiée par le premier sur les coexistences ethno-religieuses au Proche-Orient. Régis Debray part nez au vent, le mettre dans cet orient « compliqué », sans même des idées simples. Son itinéraire est celui du Christ, s’il est possible. Après tout, la Bible, les Évangiles et le Coran, par ordre d’apparition à l’image, restent aujourd’hui la carte des territoires et des revendications des peuples du lieu. Sauf qu’il faut désormais passeport et visas sans nombre, tant le monothéisme a généré de petites chapelles étroitement nationalistes. Debray n’est jamais meilleur que dans le reportage, loin des exégèses de bibliothèque qu’il affectionne trop souvent.
Qu’a-t-il « vu » en Terre sainte des trois monothéismes ? « Toutes les parties trouvent intérêt au maintien des faux-semblants et trompe-l’œil internationaux : les Israéliens, parce que l’histoire avance masquée. Les Palestiniens, parce qu’on ne pense pas dire la vérité à un peuple occupé, et qui espère, sans l’inciter à s’autodétruire ; et que notables, élus, fonctionnaires, tirent de ce qu’il est devenu un vœu pieux gagne-pain, titulature, dignité et raison d’être. Les Européens, parce qu’ils ont choisi de s’acheter une conduite moyennant une aide financière et humanitaire importante, qui les exonère de leur passivité politique et de leur cécité volontaire. Et les Américains, moralement plus redevables à l’Ancien Testament qu’au Nouveau, parce que leur lien existentiel avec Israël est de type filial et donc acritique. L’illusion autoprotectrice et partagée résulte ainsi d’intérêts opposés – là est l’ironie de l’histoire » p.368.
 Est-ce tenable sur le long terme ? « Il est permis d’en douter ». L’obsession sécuritaire secrète son insécurité même, dans les tendances lourdes de la région, notamment démographiques et morales. Régis Debray rappelle finement ce qu’est l’Ancien Testament (le Talmud des Juifs) : « avec ses carnages, son érotisme, ses monstres sacrés, ses rois truculents, ses prophètes déjantés, son Iahvé interventionniste, incorrect en diable (et qui passerait aujourd’hui en correctionnelle pour incitation à la haine raciale et apologie de crimes de guerre) » p.28. Fonder une politique là-dessus au XXe siècle est probablement se condamner à l’échec.
Est-ce tenable sur le long terme ? « Il est permis d’en douter ». L’obsession sécuritaire secrète son insécurité même, dans les tendances lourdes de la région, notamment démographiques et morales. Régis Debray rappelle finement ce qu’est l’Ancien Testament (le Talmud des Juifs) : « avec ses carnages, son érotisme, ses monstres sacrés, ses rois truculents, ses prophètes déjantés, son Iahvé interventionniste, incorrect en diable (et qui passerait aujourd’hui en correctionnelle pour incitation à la haine raciale et apologie de crimes de guerre) » p.28. Fonder une politique là-dessus au XXe siècle est probablement se condamner à l’échec.
 D’où les accommodements avec le siècle. L’auteur évoque le père Émile Choufani, formé en France, qui dirige l’école secondaire privée Saint-Joseph à Nazareth : « Je suis arabe, de culture musulmane, de religion chrétienne, de mémoire byzantine, et dans un milieu juif. Je suis tout cela à la fois. Je suis l’histoire de cette région depuis trois mille ans. Je n’aime pas les identités. Je n’ai que des appartenances. Est-ce que j’ai l’air d’un homme déchiré ? » p.46. Comment donc « comprendre » d’Europe ce genre de personnage, très courant au Proche-Orient ? Comment avoir des idées simples dans ces complications ? Côté palestinien, culture de l’assistance côtoie culture de la violence. A Gaza, « les crimes d’honneur ont repris de plus belle. Les femmes sont à la merci du clan et dans le clan, tout est permis, viol, meurtre, kidnapping. L’ultime fédérateur de ce puzzle éclaté, c’est le Coran » p.76. Ailleurs, les fouilles archéologiques sont mal vues. « La curiosité envers l’autre et envers le passé – ce double exotisme propre à notre culture – constitue presque un trouble de la personnalité pour un musulman pieux. Fort d’une révélation qui clôt l’histoire et arrête par avance le canevas du futur, l’islam sunnite (plus fermé que le chiite) a tout loisir de camper dans un perpétuel et tranquille présent » p.91. D’où la stupidité de tenter d’appliquer nos schémas bobos naïfs à cette configuration inédite.
D’où les accommodements avec le siècle. L’auteur évoque le père Émile Choufani, formé en France, qui dirige l’école secondaire privée Saint-Joseph à Nazareth : « Je suis arabe, de culture musulmane, de religion chrétienne, de mémoire byzantine, et dans un milieu juif. Je suis tout cela à la fois. Je suis l’histoire de cette région depuis trois mille ans. Je n’aime pas les identités. Je n’ai que des appartenances. Est-ce que j’ai l’air d’un homme déchiré ? » p.46. Comment donc « comprendre » d’Europe ce genre de personnage, très courant au Proche-Orient ? Comment avoir des idées simples dans ces complications ? Côté palestinien, culture de l’assistance côtoie culture de la violence. A Gaza, « les crimes d’honneur ont repris de plus belle. Les femmes sont à la merci du clan et dans le clan, tout est permis, viol, meurtre, kidnapping. L’ultime fédérateur de ce puzzle éclaté, c’est le Coran » p.76. Ailleurs, les fouilles archéologiques sont mal vues. « La curiosité envers l’autre et envers le passé – ce double exotisme propre à notre culture – constitue presque un trouble de la personnalité pour un musulman pieux. Fort d’une révélation qui clôt l’histoire et arrête par avance le canevas du futur, l’islam sunnite (plus fermé que le chiite) a tout loisir de camper dans un perpétuel et tranquille présent » p.91. D’où la stupidité de tenter d’appliquer nos schémas bobos naïfs à cette configuration inédite.
La concurrence entre religions ressort plus du bac à sable que des savants exégètes : « L’islam a trois lieux saints, comme le Dieu chrétien a trois personnes. Les cinq prières quotidiennes dont l’horaire est affiché en fluo rouge sur un tableau électronique à l’entrée de la mosquée reprennent les cinq offices monastiques (…) L’émulation peut aussi jouer en contre : l’interdit sur le vin, simple hadith, qui n’est pas dans le Coran, n’était-il pas destiné à rendre impossible la célébration de l’eucharistie ? » p.152. Islam « modéré », qu’est-ce que cela veut dire ? « Ces islamistes, je m’en aperçois vite, ne font pas la conversation. Ils admonestent. (…) Vous vous dites démocrates, et vous soutenez au Pakistan un dictateur arrivé au pouvoir sur un char pendant que vous mettez en quarantaine nos amis du Hamas, élus au suffrage universel. (…) Israël s’est créé sur une base religieuse, qui le lui reproche ? Un État juif vous semble normal, mais pas un État islamique » p.201. Pas faux. Les moralistes occidentaux feraient bien de regarder la poutre dans leur œil que la paille dans celui du voisin… Est-ce que le Net demain, comme l’imprimerie jadis, cassera le monopole du clergé en incitant chacun à lire par lui-même et à se faire son idée du sacré ? Debray y croit ; nous sommes plus sceptiques – le Net est un formidable outil pour libérer, mais aussi reconstituer des sectes, par-delà frontières et distances.
 Nos petites cases rationnelles servent-elles à quelque chose au Proche-Orient ? Pas vraiment, exemple le Hezbollah : « congrégation pieuse, parti politique, ONG (le parti a ses hôpitaux et ses écoles ouverts à tous), groupe de communication (télé, journaux, radios, éditions), fraction parlementaire, armée populaire, centre d’études sociopolitiques, entreprise de travaux publics, mutuelle d’assurance, société secrète » p.241. Ce parti attrape-tout ressemble fort à ce que fut le fascisme, le communisme et le nazisme hier : totalitaire. Qui le pense comme tel ? Qui en voit le danger ou la force nationale, en Occident ? Car tout se recoupe : « l’âge d’or, le complot et l’honneur. La trilogie de toujours, où tout se tient. La première fabule sur une Cité idéale perdue – la Médine du prophète – et se défoule dans l’exaltation d’un passé improbable. (…) Si tout est complot, il suffit de gémir en éternelles victimes des méchants Occidentaux (…) La troisième maladie chronique, l’honneur du groupe, par nature attaqué – on est toujours offensé chez les tiens – interdit de parler à la première personne, de se penser soi-même comme un sujet, autonome et distinct de sa tribu, évidemment bafouée » p.271.
Nos petites cases rationnelles servent-elles à quelque chose au Proche-Orient ? Pas vraiment, exemple le Hezbollah : « congrégation pieuse, parti politique, ONG (le parti a ses hôpitaux et ses écoles ouverts à tous), groupe de communication (télé, journaux, radios, éditions), fraction parlementaire, armée populaire, centre d’études sociopolitiques, entreprise de travaux publics, mutuelle d’assurance, société secrète » p.241. Ce parti attrape-tout ressemble fort à ce que fut le fascisme, le communisme et le nazisme hier : totalitaire. Qui le pense comme tel ? Qui en voit le danger ou la force nationale, en Occident ? Car tout se recoupe : « l’âge d’or, le complot et l’honneur. La trilogie de toujours, où tout se tient. La première fabule sur une Cité idéale perdue – la Médine du prophète – et se défoule dans l’exaltation d’un passé improbable. (…) Si tout est complot, il suffit de gémir en éternelles victimes des méchants Occidentaux (…) La troisième maladie chronique, l’honneur du groupe, par nature attaqué – on est toujours offensé chez les tiens – interdit de parler à la première personne, de se penser soi-même comme un sujet, autonome et distinct de sa tribu, évidemment bafouée » p.271.
 Israël fait l’objet d’un panégyrique admiratif et critique à la fois, pages 301 à 306. « La plus dense concentration d’individualités attachantes au kilomètre carré », « un taux incomparable de Justes par milliers d’habitants », « une proportion plus élevée qu’ailleurs de caractères (choses plus rares et plus intéressantes que les intelligences) », « la lecture encore à l’honneur », « le beau sexe dans le champ, malgré l’esthétique ambiante de la force ». Mais un milieu arabo-juif irrémédiablement gâché par de vieux Livres : « Morgue, arrogance, brutalité, mépris d’un côté. Insensibilité, fermeture, tricherie, brutalité de l’autre, où l’on fait la manche en permanence. Deux ennemis qui s’entretuent depuis trop longtemps finissent par se ressembler : mêmes mots, mêmes rites » p.326.
Israël fait l’objet d’un panégyrique admiratif et critique à la fois, pages 301 à 306. « La plus dense concentration d’individualités attachantes au kilomètre carré », « un taux incomparable de Justes par milliers d’habitants », « une proportion plus élevée qu’ailleurs de caractères (choses plus rares et plus intéressantes que les intelligences) », « la lecture encore à l’honneur », « le beau sexe dans le champ, malgré l’esthétique ambiante de la force ». Mais un milieu arabo-juif irrémédiablement gâché par de vieux Livres : « Morgue, arrogance, brutalité, mépris d’un côté. Insensibilité, fermeture, tricherie, brutalité de l’autre, où l’on fait la manche en permanence. Deux ennemis qui s’entretuent depuis trop longtemps finissent par se ressembler : mêmes mots, mêmes rites » p.326.
Nous avons bien compris, au terme de cet essai tout en nuances : Israël-Palestine – laissons-les se dépatouiller de leurs éternelles querelles. « Nous » ne pouvons rien faire que couper les vivres aux Palestiniens ou forcer les Américains à couper leur aide à Israël. Est-ce possible ? Non ? Alors il n’y a rien que nous puissions faire. « Chaque communauté, chaque secte, chaque sous-faction a son trousseau à la ceinture qu’elle ne partagera pour rien au monde avec sa voisine. Le Dieu unique n’est pas un passe-partout » p.389. Laissons Dieu défaire ce qu’il a pris un malin plaisir à faire, là où il y a un élu, il y a un exclu. Que pouvons-nous, pauvres humains ?
Avec érudition, non sans humour, Régis Debray décline sa pérégrination. Chaque phrase est ciselée comme un aphorisme, martelée comme définitive. Ce style particulier est marque d’auteur. Il faut un certain temps pour s’y habituer mais l’esprit en ressort avec des formules en tête. A lire donc avant de proférer n’importe quoi sur le conflit israélo-palestinien.
Régis Debray, Un candide en Terre sainte, 2008, Gallimard, folio 2009, 446 pages, €8.45

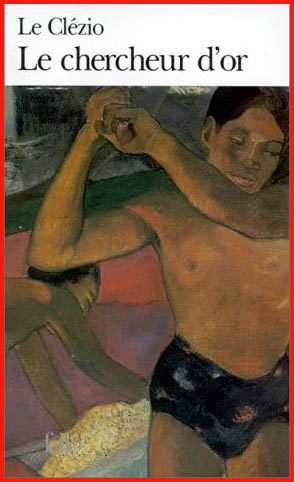


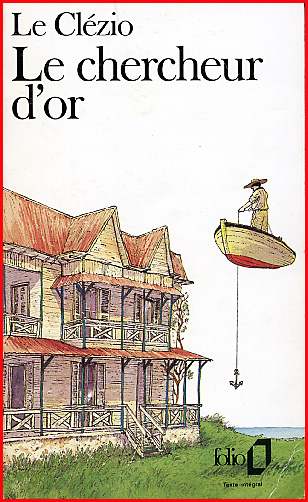
Commentaires récents