
Un roman écrit « sept fois » , coupé en deux, et dont la première partie L’Arc-en-ciel a été censurée lors d’un procès pour indécence de la part de l’évêque de Londres, en vertu d’une loi de 1857. L’auteur de moins de 30 ans décrit l’activité sexuelle à une époque où le conflit mondial pousse la moralité publique à se rigidifier. Il faudra encore quatre ans pour que la seconde partie, qui deviendra Femmes amoureuses, puisse enfin être éditée, après moult corrections et révisions, et d’abord aux États-Unis, à 1250 exemplaires seulement, avant le succès. L’édition anglaise de 1500 exemplaires, ne suivra que précautionneusement, l’année suivante, la critique trouvant le roman « absurde », voire « une abomination ». C’est que la religion, la bourgeoisie et le qu’en-dira-t-on ne badinent pas avec les convenances victoriennes. Et ce n’est qu’en 1960 qu’un nouveau procès à propos d’une œuvre ultérieure de l’auteur, L’amant de Lady Chatterley, balayera – enfin ! – ces réactions d’un autre âge.
« Ce roman ne prétend être qu’un témoignage sur les désirs, les aspirations et les luttes de son auteur : en un mot, un récit des plus profondes expériences du moi. Rien de ce qui vient de l’âme profonde et passionnée n’est mauvais, ni ne peut être mauvais. Il n’y a donc aucune excuse à présenter, sauf à l’âme elle-même, si l’on a donné d’elle une image mensongère. » C’est ainsi que l’auteur tente de se justifier dans un Projet de préface en 1919. Il est vrai que le roman parle du désir, de « l’amour », de ce qu’il est et de ce qu’il devrait être, l’ensemble de l’histoire baignant constamment dans une atmosphère érotique.
Deux jeunes femmes de 30 ans, déjà présentes dans L’arc-en-ciel, Ursula et Gudrun, songent à « s’établir » en société. Ce qui signifie, outre le métier, qu’elles exercent, plus ou moins le mariage. Pas d’autre fin dans la société chrétienne bourgeoise anglaise pour les filles. C’est qu’en l’absence d’avortement autorisé et de pilule pas encore inventée, tout « écart » peut engendrer un bébé, donc dévaluer la personne et la mettre au ban de la « bonne » société respectable. Sauf que l’émancipation est venue aux filles avec le siècle, Ursula enseigne en primaire tandis que Gudrun sculpte et dessine, artiste à peu près reconnue dans les milieux londoniens. Pas question, donc, de devenir des bobonnes assignées aux mômes, à la cuisine et à l’église. Toutes deux portent des prénoms wagnériens et sont adeptes de la volonté nietzschéenne, que l’auteur prisait fort.
Elles vont jeter leur dévolu, dans leur province minière aux alentours de Nottingham, sur deux hommes à peu près de leur âge, Rupert Birkin, inspecteur des écoles, qu’Ursula côtoie professionnellement, et Gerald Crich, fils aîné du patron des houillères locales, que Gudrun attire physiquement. Les deux jeunes hommes sont amis, et même « amoureux » l’un de l’autre, dépassant le magnétisme du corps pour viser la fusion des âmes.
Le corps, l’esprit, ne sont que des concepts ; dans la réalité des êtres, ils ne peuvent être dissociés. « Et elle sut, avec la clarté du savoir suprême, que le corps n’est que l’une des manifestations de l’esprit, la transmutation de l’esprit intégral inclut aussi la transmutation du corps physique » p.204. Conception très nietzschéenne, que l’auteur fait sienne, et qu’il décline chez les deux sexes. « Oh, la beauté de ses reins soumis, blancs et faiblement lumineux lorsqu’il grimpa sur le côté de la barque, cette beauté inspira à Gudrun une envie de mourir, mourir. La beauté de ses reins pâles et lumineux lorsqu’il grimpa dans la barque, son dos arrondi et doux… Ah, c‘en était trop pour elle, c’était une vision trop définitive. Elle le savait, c’était fatal. Le terrible désespoir du destin, et de la beauté, d’une telle beauté ! Pour elle, il n’était pas comme un homme, il était une incarnation, une grande phase de la vie » p. 192 Pléiade. Le corps a une aura qui attire, et le désir sexuel qu’il suscite est une étape vers le désir d’amour qui va plus loin. « Gerald s’approcha du lit et contempla Birkin dont la gorge était dévoilée, dont les cheveux en bataille retombaient de façon charmante sur son front chaud, au-dessus d’yeux si incontestés et si calmes dans ce visage satirique. Gerald, aux membres pleins et gonflés d’énergie, répugnait à s’en aller, il était retenu par la présence de l’autre homme. Il n’avait pas le pouvoir de partir » p.223. Gerald est un tombeur, sa beauté nordique, sa prestance musculaire, son aisance sociale font tourner les têtes des filles. « Gerald, qui maîtrisait à présent parfaitement la danse, avait à nouveau pour partenaire la cadette des filles du professeur, qui se mourait presque d’enthousiasme virginal, parce qu’elle trouvait son cavalier si beau, si superbe. Il la tenait en son pouvoir, comme si elle était un oiseau palpitant, une créature qui voletait, rougissante, aux abois » p.443.
Pour lui, la sexualité est une limite qui empêche d’aller au-delà du corps, vers l’âme. C’est un obstacle, la plupart du temps désagréable. « C’était le sexe qui transformait l’homme en moitié brisée d’un couple, la femme en autre moitié brisée. Et il voulait être une unité à lui seul, comme la femme serait une unité à elle seule. Il voulait que le sexe retournât au niveau des autres appétits, considéré comme un processus fonctionnel et non comme un épanouissement. Il croyait en un mariage sexuel. Mais par-delà, il voulait une union plus complète, où l’homme avait un être et la femme avait le sien, deux êtres purs, chacun constituant la liberté de l’autre, chacun équilibrant l’autre comme les deux pôles d’une même force, comme deux anges, ou deux démons. Il aspirait tant à être libre, et non sous la compulsion d’un besoin d’unification, et non torturé par le désir insatisfait » p.212. Pour elle, c’est au contraire l’amour qui est tout. « Elle croyait que l’amour surpassait de loin l’individu. Il disait que l’individu était supérieur à l’amour, ou à toute relation. Pour lui, l’âme brillante, isolée, acceptait l’amour comme une de ses situations, une condition de son propre équilibre. Elle croyait que l’amour était tout. L’homme devait se soumettre à elle, pour qu’elle pût le boire jusqu’à la lie. Qu’il fût entièrement son homme, et elle en retour serait son humble esclave, qu’il le voulût ou non » p.285. C’est cela qui est inacceptable pour Birkin, qui a quitté Hermione, trop dominatrice ; c’est aussi inacceptable pour Gerald, qui finira par presque tuer Gudrun pour échapper à son pouvoir, et fuira hors d’atteinte de ses rets. Laquelle Gudrun se pense comme Cléopâtre, la couguar dévoreuse d’hommes, à commencer par ses frères-maris dès 13 ans, les Ptolémée. « Cléopâtre avait dû être une artiste ; elle prélevait l’essentiel d’un homme, elle récoltait la sensation suprême, et jetait l’enveloppe » p.484.
Vampirisme féminin ou brutalité phallique, l’amour est une guerre des sexes, tandis que le mariage est une guerre des classes, et l’entreprise une guerre de domination sur la matière et sur les hommes. Tout est conflit, chez Lawrence. Il interprète la « volonté de puissance » de Nietzsche comme on le faisait en son temps pré-nazi, comme une volonté de domination. Alors que ce n’est pas cela, nous le savons aujourd’hui. De même, les amis s’affrontent, ils doivent être « les meilleurs ennemis » dit Nietzsche. C’est lorsqu’un troisième personnage intervient, comme un trublion, que la violence éclate. Ainsi Hermione avec Birkin, ou Loerke avec Gerald.
Ce que nous appelons « l’amour » est un combat, une lutte continuelle, où le désir physique de domination est roi, de l’aura magnétique des corps à la possession des étreintes et à l’imposition de sa volonté à l’autre. Homme comme femme. Gerald tente ainsi de posséder Birkin par la lutte japonaise. Les deux amis s’entraînent « nus » sur le tapis dans le salon, où ils ont poussé les meubles, porte verrouillée à cause des domestiques. « C’était comme si toute l’intelligence physique de Birkin et le corps de Gerald s’interpénétraient, comme si son énergie fine et sublimée entrait dans la chair de l’homme plus robuste, comme une puissance, ses muscles enfermant dans un filet étroit, dans une prison les profondeurs mêmes de l’être physique de Gerald » p.290. Fusion des corps comme amour des âmes. Gudrun est excitée par Gerald, fantasmant une absence complète de retenue licencieuse. « Elle se rappela les abandons de la décadence romaine, et son cœur s’embrasa. Elle savait qu’elle aspirait elle-même à cela aussi, ou à autre chose, à quelque chose d’équivalent. Ah, si se libérait ce qu’il y avait en elle d’inconnu et de refoulé, quel événement orgiastique et satisfaisant ce serait. Et elle le voulait, elle tremblait légèrement du fait de la proximité de l’homme qui se tenait derrière elle, suggérant la même noirceur licencieuse qui se dressait en elle. Elle la voulait avec lui, cette frénésie inavouée » p.308.
N’avoir que des relations entre sexes rend incomplet, inachevé, pense Birkin ; pas Gerald. « En fait, poursuivit Birkin, parce qu’on fait de la relation homme-femme la relation suprême et exclusive, c’est là qu’intervient toute la contrainte, la mesquinerie et l’insuffisance. (…) Il nous faut quelque chose de plus large. Je crois en une relation additionnelle parfaite entre hommes, additionnelle au mariage. (…) Gerald eut un mouvement de malaise. Tu sais, je ne sens pas cela. Il ne saurait y avoir entre deux hommes quelque chose d’aussi fort que l’amour sexuel entre un homme et une femme. La nature n’y fournit aucune base. – Eh bien, moi, je pense le contraire, évidemment. Et je crois que nous ne pourrons pas être heureux tant que nous ne nous serons pas établis sur cette base. Il faut se débarrasser de l’exclusivité de l’amour conjugal. Et il faut accepter entre deux hommes cet amour refusé. Cela offre plus de liberté pour tous, un plus grand potentiel d’individualité chez les hommes comme chez les femmes » p.380. Mais c’est Birkin qui va se marier, pas Gerald…
Un roman qui reflète le chaos de Lawrence, reflet du chaos de son monde, ce début du XXe siècle qui allait bouleverser les consciences, les mœurs, l’économie avec ses guerres mondiales, la perte des empires, l’émancipation de la religion – et la montée des individus.
En 1969, Ken Russell réalise Women In Love, un film tiré du roman.
David Herbert Lawrence, Femmes amoureuses (Women in Love), 1920, Folio 1988, 704 pages, €5,00
D.H. Lawrence, L’Amant de Lady Chatterley et autres romans, Gallimard Pléiade 2024, 1281 pages, €69,00
(mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés par amazon.fr)
Les romans de D.H. Lawrence déjà chroniqués sur ce blog

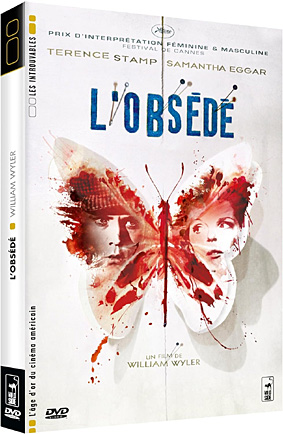





















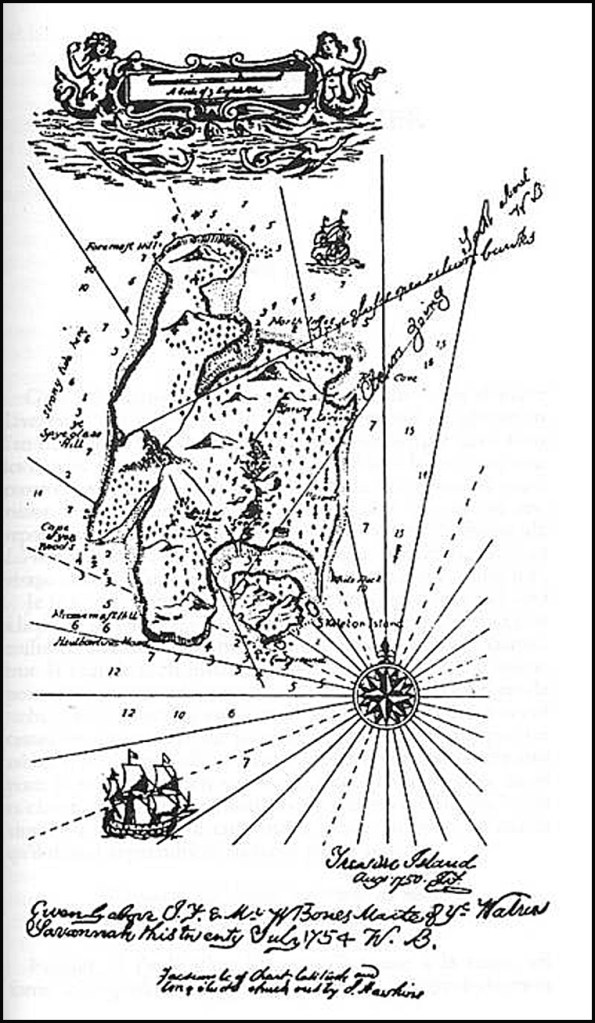

Commentaires récents