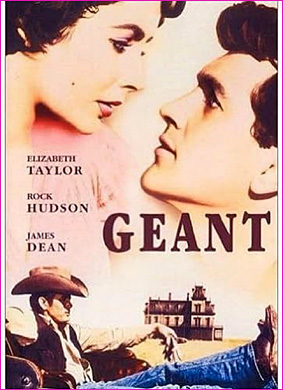
Sept jours avant sa mort dans sa Porsche 550 Spyder, James Dean tournait encore ce film. Il jouait le p’tit con devenu tycoon, le petit-blanc orphelin laissé pour compte par les seigneurs éleveurs texans, et devenu roi du pétrole. Tourné en 1955 à la gloire (critique) du Texas, cet État dans l’État, le deuxième plus grand et le deuxième plus peuplé des États-Unis, le film est composé à partir d’un roman d’Edna Ferber, décédée en 1968.
Jordan Benedict, un grand jeune homme (Rock Hudson) héritier de ses père et grand-père du domaine de 258 000 hectares et de 500 000 vaches situé au milieu d’une plaine poussiéreuse, vient prendre poulain reproducteur et femme reproductrice, Leslie (Elisabeth Taylor) au Maryland, pays verdoyant nommé en l’honneur d’Henriette-Marie de France, épouse du roi d’Angleterre Charles Ier Stuart, qui rappelle l’Europe. Texas, Maryland : deux États des mêmes États-Unis, deux cultures différentes. Au Maryland est née la liberté de religion, au Texas la prédation des grands propriétaires et le mythe du cow-boy.



Machisme patriarcal affirmé et brutalité d’un côté, tolérance et droit des femmes de l’autre, cela ne pouvait que faire des étincelles. Autant le premier est conservateur, autocrate et raciste (Républicain à la Trompe), autant la seconde est pour le progrès, la considération pour les autres et attentive aux pauvres (Démocrate à la Clinton). Les Mexicains du domaine de Reata, anciens propriétaires des terres spoliés à la fin du XIXe par les grand-pères blancs, sont considérés comme des sous-hommes et parqués dans des villages insalubres, laissés à l’abandon. Le premier geste de Leslie, une fois mariée et rapportée au manoir comme une proie, est d’aller voir une femme d’employé et son bébé malade au village mexicain, pour les faire soigner. Angel Obregon, c’est le nom du bébé, deviendra un beau jeune homme (Sal Mineo) qui donnera sa vie au pays comme soldat après Pearl Harbor.
L’intermédiaire entre blanc propriétaire dominateur et latinos salariés dominés est Jett Rink (James Dean), pôv blanc en pleine jeunesse (l’acteur a 24 ans), méprisé de Jordan mais bien aimé par la sœur de Jordan, Luz Benedict (Mercedes McCambridge), qui régit le domaine en quasi mâle. Pourquoi ? Parce que le jeune homme serait un bâtard du père ? Parce qu’elle avait une inclination impossible pour lui ? On n’en saura pas plus. Toujours est-il que, lorsque le cheval de Leslie tue Luz qui voulait à toute force le monter et le dompter – comme elle voulait dompter l’épouse de son frère – elle lègue par testament une petite parcelle de terrain à Jett. Jordan propose aussitôt, avec l’aide de son notaire et de ses voisins propriétaires, une compensation en dollars au jeune homme pour lui racheter les terres, mais celui-ci refuse. Il veut être l’égal des autres, propriétaire blanc lui aussi. Il clôt son petit domaine et le nomme même Little Reata. Grâce à la chaussure de Leslie qui s’enfonce dans la boue lors d’une visite qu’elle lui fait, il découvre du pétrole. C’est le pactole. Il gagné désormais plus en un mois que Jordan en un an avec ses vaches.



Jordan et Leslie ont des enfants, des faux jumeaux aînés, Jordan III et Judy, puis une fille, Luz II. Le conflit entre les parents s’étend à l’éducation des petits. Jordan, en macho implacable, veut entraîner son fils « héritier » Jordy III à monter à cheval dès 4 ans, ce qui fait peur au gamin et engendre sa répulsion pour l’élevage du bétail : il veut être médecin et ira contre la volonté de son père. Adulte (Dennis Hopper), il ira même jusqu’à épouser une mexicaine, doctoresse collègue du docteur de l’hôpital du coin. Sa jumelle Luz II (Carroll Baker) sera, une fois grande, favorable à la terre et à l’élevage, mais elle et son mari Bob (Earl Holliman), un peu bête et à la démarche lourdaude de péquenot, veulent leur propre ferme bien à eux, et ne pas dépendre. Jordan s’aperçoit alors que le monde a changé. Lui qui avait refusé, par traditions figées et conservatisme borné, d’autoriser le forage de puits sur ses terres, se convertit au pétrole. Exit les vaches qui nourrissent les hommes, bienvenue à la nouvelle alimentation du carburant pour le progrès.



Quant à Jett, l’argent lui est monté à la tête, lui l’inculte qui vivait dépoitraillé au domaine, désormais en costume, il se croit tout permis. Il organise un grand raout à Austin dans le grand hôtel Emperador (empereur) qui lui appartient, « réservé aux Blancs ». Il invite tous les Benedict, ainsi que le sénateur, le gouverneur et des personnalités du Texas pour célébrer le pétrole et sa gloire. Il drague Luz II et voudrait l’épouser pour intégrer la tradition, mais la différence d’âge est trop grande et, si Luz II a été « reine de la fête », elle éconduit gentiment le milliardaire. Lui se saoule, déjà porté sur l’alcool depuis de longues années pour oublier sa condition. Il ne peut délivrer « son » discours (écrit par un autre) et s’écroule sur la table du banquet, montrant à tous ses limites. L’accès au salon de coiffure a été refusé à l’épouse de Jordy, car mexicaine, ce qui a conduit le jeune homme à provoquer Jett en public, et son père à aller lui casser la gueule – mais surtout sa collection d’alcools dans une arrière-salle, Jett étant trop bourré pour se battre.



Géant est un film d’excès : plus de trois heures en deux DVD, un machisme XXL d’un Rock Hudson d’ailleurs homo mais mesurant 1m96, la démesure du Texas avec ses centaines de milliers de vaches puis son pétrole à gogo. De quoi prédisposer à la mentalité autoritaire de seigneur d’Ancien régime, de voleur de bétail et de prédateur de terres, à la prévalence de la force sur le droit, à la vanité de nantis. Le film a inspiré la série Dallas, ses petits forfaits en famille et son « dirty business » – c’est dire ! « J.R. », les initiales de John Ross Ewing dans la série, sont d’ailleurs les mêmes que celles de Jett Rink, apposées sur les portes de son grand hôtel. Trump et ses affidés reprennent désormais la brutalité et les traditions texanes – un film qui revient à la mode !
Oscars 1957 du meilleur réalisateur pour George Stevens, meilleur acteur pour James Dean et pour Rock Hudson
DVD Géant (Giant), George Stevens, 1956, avec James Dean, Elizabeth Taylor, Rock Hudson, Carroll Baker, Jane Withers, Warner Bros Entertainment France 2005, doublé français, anglais, italien, 3h13 + bonus 45 mn, €4,68, Blu-ray €38,99
(mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés par amazon.fr)


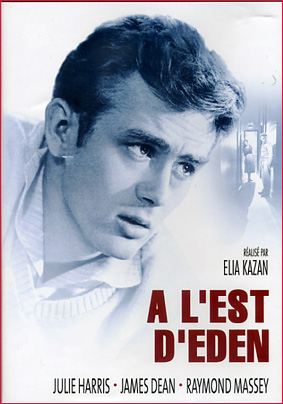










Commentaires récents