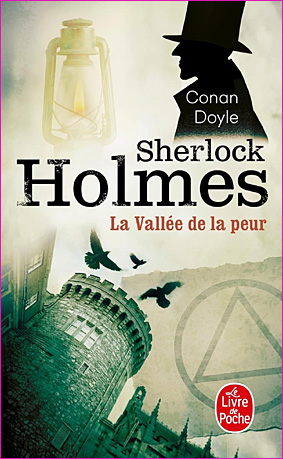
Sherlock Holmes lit confortablement une énigme apportée par son gamin des rues Billy, et l’inspecteur MacDonald, de Scotland Yard sonne à la porte. Il vient annoncer un meurtre…
La lettre, écrite par un certain Porlock – un nom de plume qui cache un collabo pris de remord du redoutable professeur Moriarty – est une suite de chiffres, séparés par des espaces, avec seulement trois noms en clair. Holmes n’a pas le code, évidemment pas fourni avec le message (sinon, quel intérêt de le coder ?). Billy « le saute-ruisseau » apporte une seconde lettre, mais non seulement ledit Porlock ne fournit aucun code, mais se défile en plus, craignant d’être surveillé par le redoutable Moriarty. « J’ai vu le soupçon dans ses yeux. Brûlez le message codé, je vous prie. » Holmes n’en fait rien, mais Watson doit le provoquer pour qu’il se mette à agiter ses petites cellules grises : il le met au défi de le décoder.
Et il le décode… C’est tout simple, enfin pour un cerveau connecté comme le sien. Le code doit être un livre, et le premier chiffre fait référence à la page. Comme il s’agit du 534, ce doit être un « gros » livre. Pas la Bible, les traductions sont diverses ; pas le bottin, il n’y a pas assez de diversité de mots ; pas le dictionnaire, trop sec. Donc quoi ? « Un almanach ! » Le Whitaker’s annuel est dans toutes les maisons et il comprend deux colonnes, comme le C2 indiqué juste après 534. Manque de chance, ça ne colle pas. Mais si ! Il suffit de prendre non pas le tout nouveau, mais l’usuel de l’année qui vient de s’écouler, et le tour est joué. Le message fait état d’un danger qui pourrait survenir très bientôt à un certain Douglas, riche, à la campagne, à Birlstone House.
Surgit MacDonald. Mr Douglas, de Birlstone Manor House, vient d’être sauvagement assassiné dans la nuit. Sherlock Holmes avoue être « intéressé, mais pas surpris ». L’horreur ressentie par Watson est une émotion négative qui submerge la raison, et Holmes sait la dompter afin de n’en pas être affecté. L’officier de police local White Mason a fait appel à Scotland Yard car l’affaire le dépasse : un meurtre sans témoins dans un manoir fermé entouré de douves. Les voilà donc partis pour la campagne et pour enquêter avec la minutie habituelle.
La bâtisse date de la première croisade et a été rebâtie au XVIe siècle après un incendie. John Douglas l’a rachetée il y a quelques années pour la faire retaper et s’y reclure, sortant peu avec sa femme. Seul son ami Cecil James Barker vient assidûment le voir. Il a rencontré Douglas en Amérique, où ils ont fait fortune comme associés dans les mines. Le seigneur des lieux, descendu la veille au soir en robe de chambre pour vérifier les fenêtres, gît mort d’une décharge de fusil à canon scié provenant d’une armurerie américaine. Une carte de visite avec les lettres V.V. et le chiffre 341 à côté de lui. Une trace sur une fenêtre ouverte laisse penser que l’agresseur a fui par les douves, peu profondes, alors que le pont-levis restait relevé. Mais les haltères dans la salle ne sont plus qu’à un unique exemplaire. Cet insignifiant détail turlupine le cerveau du détective.
L’énigme sera relativement simple à résoudre, malgré les fausses pistes. Holmes s’y emploiera avec sa finesse habituelle, non sans coup de théâtre à la fin. Mais ce n’est que la première partie.
Comme dans Étude en rouge, le roman est divisé en deux : une enquête contemporaine anglaise – et un contexte historique et personnel américain. C’est cette fois le nord américain industriel, dans la région de Chicago, qui explique l’assassinat du manoir anglais. Un certain John MacMurdo s’est fait passer pour comptable des mines pour se faire engager et infiltrer un « syndicat » chargé de protéger les ouvriers de l’exploitation brutale des gros capitalistes. La loge de Chicago était humaniste et d’entraide ; celle de Vermissa, dans la Vallée de la mort, s’est tournée vers le crime et l’extorsion. La police est impuissante et la magistrature achetée. Ici règne la force et le principe du plus fort. Le droit et la loi ne valent rien contre les tueurs impitoyables qui viennent tabasser et racketter en bande. Les membres de la loge doivent jurer obéissance au chef (comme aujourd’hui à Trump) et sont autorisés à user de tous les moyens pour affirmer le droit du chef (comme aujourd’hui les affidés de Trump). Les journalistes sont intimidés physiquement, les contremaîtres voient leur maison explosée avec leur famille dedans, l’ingénieur de la mine est tué d’une balle, le grand patron traqué. Sauf à payer…
MacMurdo est un inspecteur de l’agence privée de détectives Pinkerton, engagée par les gros capitalistes de New York qui voient d’un mauvais œil cette loi de la jungle. L’état d’esprit libertarien – celui des pionniers – n’est plus de mise dans un État moderne où la bonne marche de l’économie dépend des échanges donc de la loi et de la confiance entre les acteurs. Le même dilemme se pose aujourd’hui : les grands patrons de la tech veulent moins de réglementation pour leurs affaires, mais pas une dictature du bon plaisir qui boute l’anarchie sur les marchés et à l’international. Nul doute que l’antagonisme Trump-Musk, qui vient à peine de se révéler, ne va faire que s’accentuer. Comme c’était le cas à la fin du XIXe entre les mafieux des loges et les patrons des mines.
MacMurdo fait donc arrêter les malfrats, dont la plupart sont pendus après procès en bonne et due forme pour l’édification du public et le retour de la confiance économique. Mais les survivants qui se cachent ont juré sa perte. Il doit donc s’exiler, prendre un faux nom, changer souvent de résidence et de métier. Jusqu’à cette Angleterre paisible de la campagne des Downs où son passé le rattrape. Le potentat du crime Moriarty a pris l’affaire en main et a plaisir à la résoudre selon ses méthodes : tuer. Holmes ne va que retarder l’échéance ; il le sait, la seule façon d’arrêter Moriarty est qu’il disparaisse de la surface de la terre. Ce ne sera pas encore dans ce roman.
Sir Arthur Conan Doyle, La vallée de la peur (The Valley of Fear), 1914, Livre de poche 1975, 240 pages, €5,20, e-book Kindle €0,99
Sir Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes, tome 2, Gallimard Pléiade 2025, 1152 pages, €62,00
(mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés par amazon.fr)

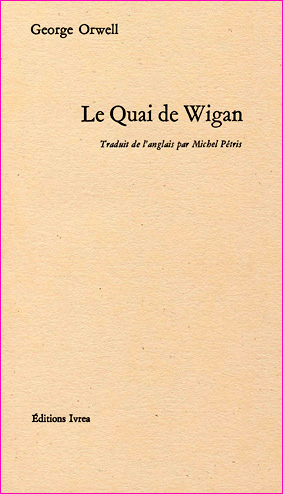
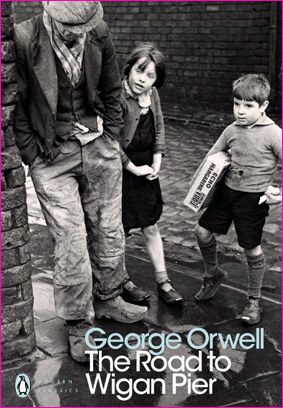
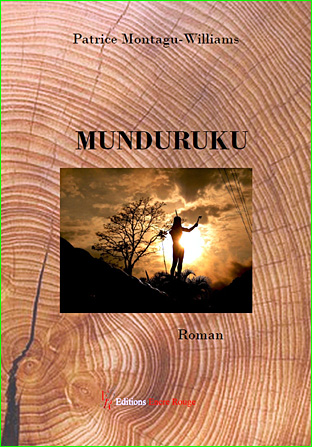











Commentaires récents