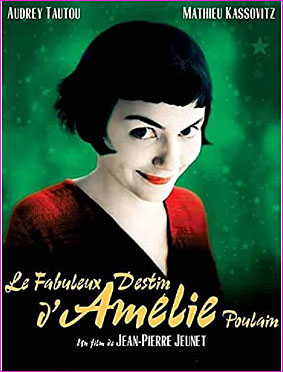
Le second plus gros succès international d’un film français en langue française, 32 millions d’entrées dans le monde, 59 récompenses… Que reste-t-il, 25 ans après, de la fusée Amélie Poulain ? J’ai revu le film, dont je n’avais pas été vraiment sensible au charme la première fois. Je ne le suis pas plus cette fois-ci. Certes, le thème est original, les scènes rapides, les potacheries et les paradoxes sans nombre. Mais les aventures improbables d’une sociopathe élevée par deux névrosés ne peuvent qu’être une idéalisation sans lendemain.
Le genre « ça fait du bien » marque le déni de réalité de la société française, pourtant bien dans ses baskets (rouges) sous Chirac président et Jospin premier ministre. Juste avant le 11-Septembre et la chute brutale dans la paranoïa américaine, dont les conséquences se font jour avec le Caligula Tromp Deux et son équipe de ploucs désaxés, néo-fascistes par ressentiment profond. L’abus du filtre jaune par le directeur de la photo dans le film fait de Paris une ville au coucher de soleil permanent (alors qu’il y pleut souvent), tandis que le métro baigne dans une atmosphère verdâtre où évoluent de rares passagers tels des bébés nageurs (alors qu’il est bondé souvent). Nous sommes dans la BD, pas dans le réel.


Amélie mêle-tout (Audrey Tautou) a du mal avec les relations humaines, mais elle adore se mêler de celles des autres. Jusqu’à leur faire du « bien » malgré eux, car elle se croit responsable du malheur du monde. Un adulte taré lui a dit à 6 ans que des accidents se produisaient à chaque fois qu’elle était là, comme la mort de sa mère. Elle a pris dès lors une propension « progressiste » du politicien théoricien qui-sait-mieux-que-vous-ce-qui-est-bon-pour-vous. Typique du socialisme au pouvoir durant cinq ans, au point d’exaspérer les électeurs, qui lui préféreront Le Pen au second tour en 2002… avant de reculer, effrayés de leur audace. Heureusement, Audrey Tautou fait tout : cette jeune fille fraîche et simple, au visage expressif et à la coiffure de jeune garçon, plaît à tout le monde. Elle est la Parisienne pour les étrangers, avec ses grosses pompes de mec noires, selon la mode brutasse du temps, et son rouge à lèvres très rouge.
Le fabuleux destin est une carte postale pour Visit France, Montmartre à l’honneur avec sa bouteille de butane en guise d’hommage catho tradi sur la butte, pour expier la révolte de la Commune et la première défaite contre les Boches (il y en aura d’autres). Pourtant, le réalisateur présente la Butte comme une tanière de fous. Tout le monde est blanc, sauf Jamel Debbouze en victime du racisme ordinaire d’un épicier misogyne et célibataire (Urbain Cancelier), l’affreux Collignon. Mais tout le monde est décalé, névrosé, abîmé (au fond, seul l’arabe, « pas un génie » dit la voix off, semble sain d’esprit). Raymond aux os de verre (Serge Merlin) ne sort jamais et peint une fois par an depuis vingt ans la même copie de Renoir, le Déjeuner des canotiers, une guinguette où il rêverait d’être. La concierge Madeleine (Yolande Moreau) pleure comme une fontaine Wallace à cause d’un mari disparu il y a quarante ans. La patronne du café Les deux moulins où travaille Amélie, Suzanne (Claire Maurier), ne peut vivre l’amour à cause d’une jambe amputée, et elle surveille les amours des autres. Le comptoir du tabac voit Georgette (Isabelle Nanty), malade imaginaire à force de se triturer les méninges faute de sexe. Joseph (Dominique Pinon) est un pilier de bistro qui passe son temps à surveiller Gina la serveuse (Clotilde Mollet), avec qui il a eu une fois une liaison. Lucien le commis d’épicerie (Jamel Debbouze), traité de crétin et trisomique, sert de souffre-douleur pour se faire valoir et reste obsédé par la Didi, princesse de Galles écrabouillée dans sa Mercedes sous le tunnel de l’Alma. Le client Hipolito (Artus de Penguern) s’exhibe au bar en écrivain toujours apprenti, dont les manuscrits sont refusés car racontant l’éternelle histoire de l’époque : celle du nombrilisme, un jeune branleur qui ne fout rien et croit son histoire digne d’intéresser tout le monde. Nino Quincampoix (Mathieu Kassovitz) est un collectionneur maniaque et lunaire, circulant en mobylette dans un Paris quasi sans voiture, et qui bosse dans une sex-shop ; il est obsédé par les clichés ratés de photomatons qu’il va chercher dans les poubelles et sous les cabines ; il veut découvrir l’identité de l’homme chauve aux baskets rouges qui laisse des traces dans tous les photomatons de la capitale.


La jeune serveuse Amélie découvre, un matin qu’elle se met du parfum (pour qui ?), une boite de gâteau en métal derrière une plinthe de sa salle de bain. Un jeune garçon l’a cachée là quarante ans auparavant et elle contient des trésors de gosse : une voiture de course miniature, des secrets. La sociopathe décide d’en savoir plus : elle interroge la concierge, qui la renvoie à l’épicier, lequel l’envoie à sa mère, une véritable encyclopédie cancanière du quartier. C’est le vieil homme de verre qui lui déniche enfin le nom et l’adresse, que lui a probablement livré le « crétin » Lucien (qui ne l’est donc pas tant que ça). Amélie décide alors de faire du bien à ce gamin inconnu devenu adulte d’âge mûr (Maurice Bénichou). Plutôt que de l’aborder, elle l’espionne, pose la boite dans une cabine téléphonique (du genre qui n’existe plus) et téléphone dans le vide à son passage. L’appel du téléphone est irrésistible dans tous les films, même si la personne sait que c’est un harceleur ; l’homme décroche, elle raccroche. C’était juste pour qu’il voie sa boite. Il la découvre, l’ouvre, en est heureux. Et d’un !
Elle va faire ensuite le bonheur de la concierge en lui volant ses lettres d’amour et concoctant avec des ciseaux et une photocopieuse une lettre ultime où son mari lui dit venir la retrouver, lettre que la Poste distribue après quarante ans parce qu’elle provient d’un avion écrasé dans les Alpes – où est censé avoir disparu ledit mari amoureux. Et de deux !



Suivra l’homme de verre, avec qui elle échange des cassettes vidéo de scènes désopilantes et diverses pour le sortir de sa coquille. Ensuite Georgette et Gina, puisqu’en livrant sa consommation à Joseph, elle le persuade que la première est amoureuse de lui et pas l’autre ; ce qui aboutira à une scène d’anthologie, la baise hard dans les toilettes avec Georgette, qui fait trembler le bar et siffler le percolateur au moment de l’orgasme. Elle écrira sur un mur des mots d’Hipolito, lus dans son manuscrit impubliable. Pour son père (Rufus), qui ne l’a jamais touché que froidement sur geste médical et qui se morfond à la retraite dans son pavillon de banlieue en pierre meulière, elle fera voyager son nain de jardin via une hôtesse de l’air qui revient chaque fois au bar, lui envoyant une photo instantanée du nain devant un monument (prélude à ces selfies fétichistes des blogs des années 2000) ; son père finira par désirer voyager lui aussi et se sortir de son marasme mental. Puis ce sera le tour de Lucien qu’elle venge en s’introduisant chez le vil Collignon pour lui saccager ses habitudes : décalage du réveil à 4 h du matin, inversion du dentifrice et de la crème pour pieds, échange de la poignée des toilettes, ampoule grillée, tige de métal dans un fil électrique pour faire court-circuit, modification de la touche d’appel Maman sur le téléphone par celle des Urgences psychiatriques… Du drôle, du potache, du mesquin.


Mais l’acmé est pour Nino, le collectionneur maniaque. Elle va lui retrouver son album perdu et son chauve à baskets rouges ; elle va le retrouver lui-même, après un jeu de piste où elle se photomatonne en Zorro adolescent après l’avoir traqué à la Foire du trône où il œuvre comme squelette attoucheur. Elle aura enfin trouvé l’amour, après ces rituels névrotiques interminables.



Tout ça pour ça : est-ce que « ça fait du bien » ? J’y vois surtout l’inadaptation des urbains solitaires, mal élevés et perdus dans la grande ville, asservis aux petits boulots routiniers sans avenir, soumis à leurs tares psychiatriques. Ils ont la lâcheté de se laisser aller et le seul courage de ne rien faire pour s’en sortir. Sauf Amélie. C’est ça le message ; elle est un passeur. La musique de Yann Tiersen rythme bien ces dérives successives, décrites selon un humour dérisoire, bien porté par les acteurs secondaires. Ainsi la mort de maman, d’une chute d’une suicidée du haut de Notre-Dame lorsqu’Amélie avait 6 ans, son cœur qui bat la chamade lorsque son père l’ausculte, lui qui ne la prend jamais dans les bras à cet âge tendre. Le son lui aussi est passeur d’émotion.
Un film léger, agréable, dont il ne faut pas attendre trop.
DVD Le fabuleux destin d’Amélie Poulain, Jean-Pierre Jeunet, 2001, avec Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz, Michel Robin, Rufus, Serge Merlin, UGC 2019, français, 2h01, 9,99Blu-ray €15,00
(mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés par amazon.fr

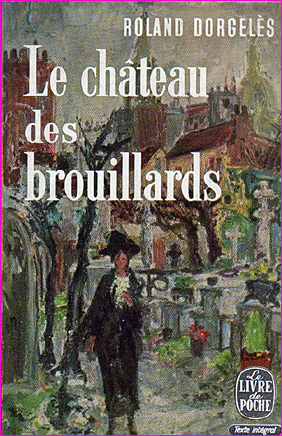
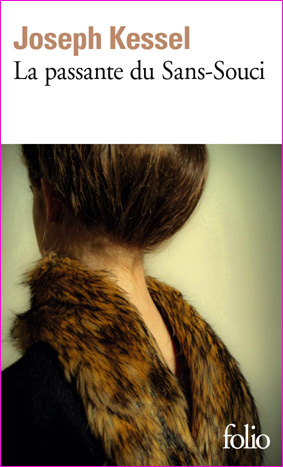
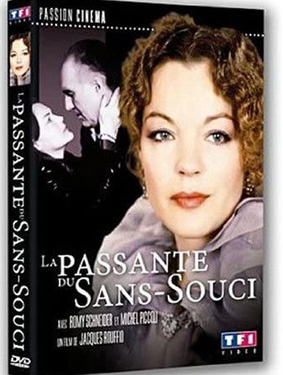
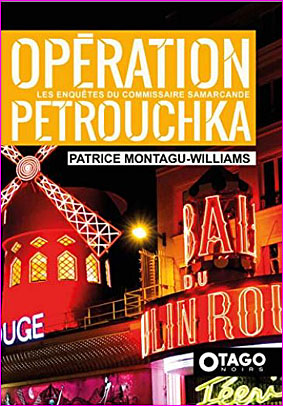
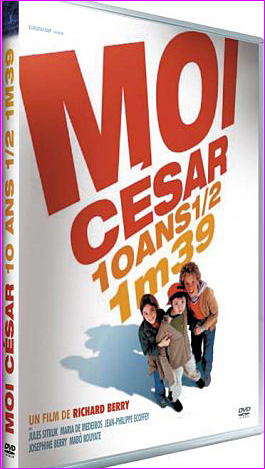


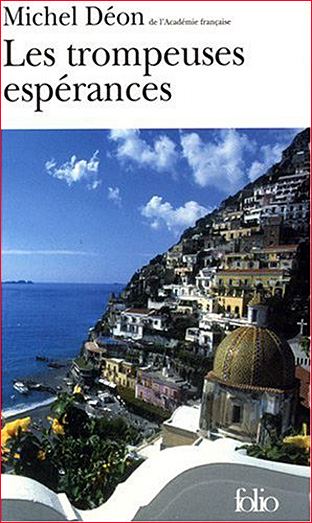
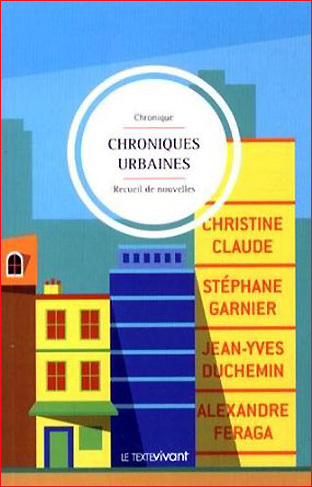
Commentaires récents