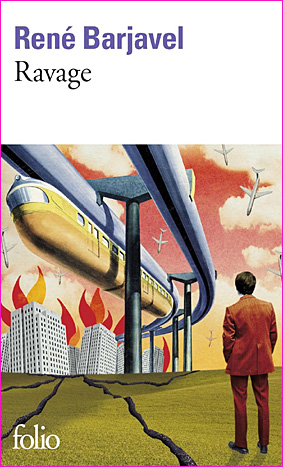
Qui connaît « l’inventeur » de la science-fiction à la française ? Du moins celui qui a mis l’anticipation au cœur de ses romans dont le premier, Ravage, publié en pleine Occupation, en 1943. Ravage est à (re)lire car son ironie touche encore, sa satire de l’illusion technologique aussi, de même que le retour aux valeurs de base de l’humain, c’est-à-dire la sauvagerie quand rien ne va plus, et l’émergence d’un chef naturel lorsque tout doit recommencer.
François et Blanchette, deux jeunes de Provence « montés » à Paris, fils et fille de paysans comme il se doit à l’époque, vivent dans la technologie de l’année 2052, à peine un siècle après la publication du roman. Les trains sont hyper-rapides, à sustentation magnétique, les autos à propulsion nucléaire cèdent peu à peu la place aux autos à quintessence, carburant d’eau de mer, inépuisable et peu polluant ; les avions sont de gros cigares à hélice enveloppante ; les taxis, des « puces » à décollage vertical. Le livre audio permet de passer le temps, bien que le « journal » subsiste, le visiophone montre le visage de l’interlocuteur – ou non s’il est à poil sortant du bain comme Blanchette. Les vêtements sont synthétiques et moulants, les plus à la mode étant aux boutons magnétiques pour les fermer. Les engins et les meubles, comme les œuvres d’art, sont en plastec, matériau souple et résistant issu de la chimie moderne. L’alimentation est assurée par des usines qui font germer le blé sous radiations et composent par biotechnologie, issue des travaux d’Alexis Carrel, de la « viande » synthétique fort agréable, rendant inutiles les paysans. La population est donc de plus en plus nombreuse dans les villes et l’on a créé autour de Paris, désormais 25 millions d’habitants) d’immenses villes nouvelles aux noms marketing : Ville Radieuse, Ville d’Or, Ville d’Azur, Ville Rouge.
François Deschamps, à 22 ans, est peintre indépendant (non autorisé par le gouvernement) et tire le diable par la queue dans un atelier parisien de la rive gauche ; son amie d’enfance Blanchette, à 17 ans, est pressentie pour devenir la vedette de la radio nationale (car les nations ont subsisté), et la fiancée de son propriétaire, le jeune milliardaire Jérôme Seita, qui veut transformer Blanche Rouget en Regina Vox. François, premier au concours d’ingénieur agronome mais sorti de la liste sur intervention de Seita, veut épouser Blanchette qui, elle, hésite et préfère plutôt le confort de l’argent.
Drame de la technique qui change l’humain, le rend esclave matériel et soumis moral, avili, affaibli. La fable écrite en 1943 prend tout son sens lorsque l’on considère le contexte : Pétain et la Révolution nationale, la terre qui ne ment pas (mot d’Emmanuel Berl pour un discours du maréchal), l’arrière-plan idéologique allemand avec la critique radicale de la Technique par Martin Heidegger (proche du parti nazi à l’époque). Vaste sujet philosophique, dont déjà Platon en discourait : l’instruction ne vaut que pour une élite, le commun des mortels doit plutôt produire et ne pas réfléchir car les machines abêtissent et asservissent. Le Jérôme, minet fluet narcissique en haut de sa tour de Radio-300 (300 m au-dessus des toits du commun), est un faiblard physique et un faible moral qui croit que l’argent achète tout, comme la célébrité. Il sera inapte à la survie lorsque surviendra la Catastrophe.
Car elle survient, en pleine émission radio d’inauguration de la nouvelle vedette Regina. Lorsqu’elle va chanter, tout s’éteint. Plus aucune électricité nulle part, le courant électrique ne passe plus, le métal ferreux devient cassant. Les autos et les métros s’arrêtent – dans le noir absolu -, les avions tombent sur les immeubles, les trains sans freins ni moteur foncent dans l’inconnu. Plus d’armes à feu, plus d’énergie électrique, plus de climatisation, plus d’eau ailleurs que dans les rivières, plus de fermetures magnétiques, portes, coffres ou vêtements – les gens à la pointe de la mode se retrouvent tout nu : plus de civilisation. C’est fou ce que l’électricité permettait de faire…
Est-ce un phénomène naturel, une mutation des lois physiques ? Est-ce dû à la massive attaque des forces du « roi nègre » de l’empire sud-américain contre les anciens esclavagistes blancs des États-Unis nord-américain ? Nul ne sait, pas plus le vieux père de l’Académie des Sciences, convoqué par le gouvernement mais que la foule happe et lynche car la Science a failli. Le gouvernement, comme en 40, est impuissant, même le ministre de la Jeunesse et des Sports se révèle incapable de faire à vélo les quelques kilomètres entre Passy et le ministère.
Retour à l’âge de pierre, ou presque. C’est très vite la guerre civile entre bandes armées de bâtons et d’instruments en fer, où le plus fort agrège autour de lui des hommes qui raflent la nourriture. Très vite, le choléra va se déclarer. Le clergé et l’Église ont beau multiplier les messes en continu et officier jusqu’en haut de la tour Eiffel, Dieu s’en fout. Le ministre de la Santé morale, un prêtre, s’avère impuissant. Dieu punit les humains de leurs péchés et de leur laisser-aller hédoniste – thème très pétainiste.
François n’a qu’une idée en tête : retrouver Blanchette, la sauver et l’emmener avec lui pour le retour à la terre, en Provence chantée par Mistral et Charles Maurras – fort à la mode en ces années Pétain. Il marche à pied, monte les étages de la tour par l’escalier (interminable), retrouve Blanchette évanouie et fiévreuse. Une curieuse « maladie des pucelles » semble s’être déclarée en effet chez les jeunes filles pubères mais vierges avec la mutation électrique.
Nous sommes dans la satire ironique de l’époque Pétain, avec une aventure sentimentale en condition de survie, l’Exode de la ville et le retour à la terre avec fin morale « comme il faut ». Les « valeurs sûres » du travail manuel agricole, la hiérarchie « naturelle » du Patriarche à la Pétain qui gère la communauté autosuffisante, la phobie de la technique sous toutes ses formes, le bûcher des livres qui ne servent qu’à pervertir les esprits, la vie en familles élargies où les hommes sont polygames comme chez les Mormons parce qu’ils sont moins nombreux après la Catastrophe – tout cela sied à l’hebdomadaire collabo Je suis partout, où le livre est publié en feuilleton. L’auteur sera cependant blanchi en 1945 des faits de collaboration par le Comité national des écrivains, grâce à une lettre de Georges Duhamel.
Mais le livre va plus loin, il pousse à l’excès caricatural la pensée conservatrice de son époque, ce qui est une cruelle critique du pétainisme, au fond. Il est dit que François engendrera 128 enfants, « tous des garçons » avec huit femmes (dont 17 avec Blanchette) sauf une fille avec la dernière qui a 18 ans alors que lui en a déjà 129. Nous sommes dans la Bible, chérie du maréchal et des cathos tradis. Barjavel, petit-fils de boulanger, a toute sa vie (achevée en 1985 à 74 ans) pétri son pain lui-même. Nous sommes aussi, ce qui est plus curieux mais pas improbable si l’on connaît l’histoire des idées politiques, dans l’écologisme le plus contemporain. Vouloir tout arrêter, tout conserver, conduit inexorablement à en « revenir » au Livre, à la vie « d’avant » toute technique et tout État.
François va agréger autour de lui des hommes et des femmes qu’il connaît, les armer, trouver du transport par bicyclettes et charrettes, de la nourriture pour le voyage, sortir de Paris et de sa conurbation, atteindre enfin la Loire – qui fournit l’eau – passer les montagnes du centre pour aboutir à cette Drôme rêvée, curieusement préservée de la civilisation (et que les bobos investissent depuis la fin des années 1980). C’est que, depuis Paris, un gigantesque incendie a ravagé une bonne partie du pays, né d’une cigarette tombée dans une voiture abandonnée et avivée par la chaleur écrasante du climat qui s’est réchauffé (intuition prémonitoire !).
En ces temps où les gouvernements encouragent le tout-électrique, même pour les voitures, en cette époque de Bayrou moral et d’écologisme pétainisant, relire Ravage est un délice.
René Barjavel, Ravage, 1943, Folio 1972, 313 pages, €9,40, e-book Kindle €8,99
(mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés Amazon partenaire)

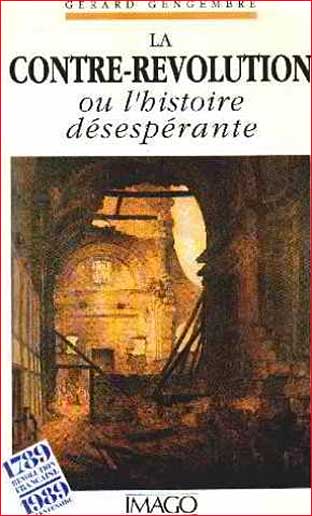
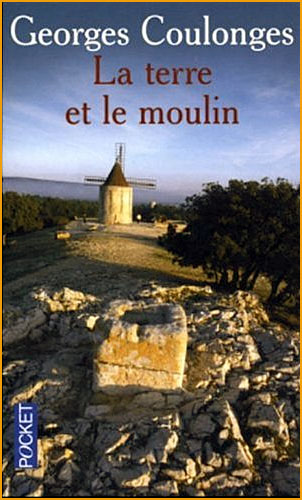
Commentaires récents