
Les hommes se font vieux en ce début de la décennie 1980 contée en 2007 : le monde change et il n’est plus pour eux. Ni Llewelyn Moss (Josh Brolin), ancien du Vietnam vingt ans avant, ni le shérif Tom Bell (Tommy Lee Jones) vétéran de la Seconde guerre mondiale, ni même le tueur à gage moderne Carson Wells (Woody Harrelson), ancien colonel au Vietnam, ne comprennent plus ce qui se passe. Il n’y a guère que le psychopathe robotisé et sans affect Anton Chigurh (Javier Bardem), tueur à gage pour les cartels mexicains, qui s’adapte. En tuant sans état d’âme tous ceux qui se mettent en travers de son chemin. La violence gratuite comme humour noir ou la relative stupidité texane du shérif adjoint Wendell (Garret Dillahunt) qui fait son boulot sans y penser sont peut-être les mutants de la modernité dans un monde du n’importe quoi où tout est permis. Il suffit désormais d’oser.

Moss, chassant l’antilope dans les plaines texanes, trouve par hasard quatre 4×4 explosés dans le désert, les cadavres de Mexicains armés gisant tout autour. Seul un blessé gémit au volant d’un véhicule et réclame en espagnol de l’eau. Son pick-up est rempli de sacs d’héroïne passés en fraude. Sans doute un règlement qui a mal tourné. A l’affut, Moss se met à la place du dernier survivant – il y en a toujours un. Il suit la piste jusqu’à un arbre où il s’est mis à l’ombre, blessé, avant de crever. A côté de lui une sacoche pleine de billets : 2 millions de dollars au moins. Moss la ramasse, ainsi qu’un pistolet-mitrailleur et un revolver nickelé, une belle arme qui peut servir – et qui lui servira.

Il rentre chez lui et planque les armes sous son préfabriqué mais sa femme, la geignarde Carla Jean (Kelly Macdonald), l’entreprend et veut tout savoir ; elle est très agaçante et il ne lui dit que le minimum. Ce personnage, nul au début, prendra de la consistance durant le film jusqu’au tragique de la fin. Mais son mari aurait mieux fait de lui parler au lieu de décider seul et de faire en macho texan « une grosse connerie ». Il le sait, il la fait, il se perdra. Moss est le viril joueur.

Il retourne en effet de nuit sur les lieux du massacre avec un bidon d’eau pour le blessé. Qui est évidemment mort depuis, tandis que la came s’est envolée. Mais son pick-up est repéré car les trafiquants sont à la recherche du fric et il se fait poursuivre tous phares allumés puis, lorsqu’il se jette à l’eau blessé, par un molosse lâché sur lui. Il réussit à s’en débarrasser mais, avec la plaque d’immatriculation, il ne faut pas être bien sorcier, aux Etats-Unis, pour retrouver quelqu’un.

La mission est confiée au tueur laid et implacable au nom pas très catholique, Anton Chigurg, qui agit surtout avec un pistolet pneumatique à tuer le bétail. Nous sommes au Texas et la « virilité » exige d’user des armes en fermier. Comme nous sommes bien au Texas, les gens ont l’esprit bovin de leur bétail : le shérif adjoint qui a arrêté Anton ne le surveille plus une fois mises les menottes, ce pourquoi l’autre réussit à l’étrangler ; ayant piqué la voiture du shérif, le tueur arrête un bouseux qui obéit bien sagement, bien qu’aucune étoile de shérif ne soit piquée dans la chemise et que le soi-disant shérif porte un pistolet pneumatique au bout d’une bouteille, le gros con se laisse complaisamment mettre sur le front l’embout à bœuf tout en n’y comprenant rien – pas grave, les cons vont en enfer. Chigurh est le viril rendu fou.


Par quoi ? On ne sait pas. Il est en tout cas le personnage le plus fascinant du film, bien que répugnant. Peut-être est-il né comme ça, étranger à la société avec un nom pareil, étranger à la vie à cause de son enfance ou de ses parents. Peut-être est-il devenu psychopathe parce qu’habitant le Texas, pays dur aux faibles qui ne connait que la loi du plus fort. Même l’adolescent qui lui donne sa chemise pour s’en faire une écharpe afin de maintenir son bras blessé dans un accident de priorité (Josh Blaylock, 16 ans au tournage) ne lui soutire aucun remerciement ni sourire : seulement un billet de vingt dollars pour ne rien devoir à personne. Que le garçon commence par refuser en déclarant, selon les vieux principes de la communauté américaine, que « c’est normal de donner sa chemise à quelqu’un qui en a besoin ». Le tueur est un serial killer qui jouit de donner la mort ou de gracier, jouant à pile ou face le destin. Mais il faut que la victime annonce ; Carla Jean, qui ne le fera pas, laisse son destin en suspens. Le spectateur ne pourra que spéculer sur ce qui lui est arrivé : exécutée ou graciée ?



Anton pique la voiture de l’abruti, « une Ford de 1977 » dit Bell, shérif de père en fils depuis trois générations mais qui se fait vieux. Toute cette drogue, ces fusils automatiques en vente libre, cette avidité du fric, ces cadavres multipliés, montrent qu’il décroche du mouvement social. Il va finir son boulot, boucler autant que faire se peut l’enquête en tentant de protéger Moss et sa femme, mais prendra sa retraite aussitôt après. Lui obéit aux vieux principes de l’Amérique : qui a commis une faute la paye. Ainsi a-t-il fait passer sur la chaise électrique un jeune homme qui a tué sa petite amie de 14 ans sans raison. Mais après jugement, pas par bon plaisir ni en se prenant pour Dieu comme Chigurh. Bell reste le viril raisonnable. Au début des années 1980, ces vieux principes fondateurs de la loi et de l’ordre semblent abandonnés par des tueurs sans raison, des égoïstes sans morale, des violents sans mesure. Cela donnera la réaction républicaine avec Reagan dès 1981, puis la réaction raciste revancharde de Trump et de ses partisans déclassés.

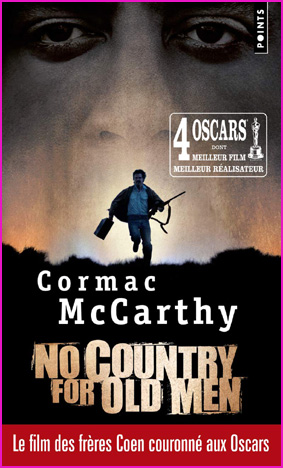
(Coffret 2 DVD True Grit +) No country for old men (Non, ce pays n’est pas pour le vieil homme), Joel et Ethan Coen, 2007, avec Tommy Lee Jones, Javier Bardem, Josh Brolin, Woody Harrelson, Kelly Macdonald, Garret Dillahunt, Paramount Pictures 2011, 2h02 €24.90
Cormac McCarthy, Non, ce pays n’est pas pour le vieil homme (No Country for Old Men), Cormac McCarthy, 2005, Points Seuil 2008, 320 pages, €7.10

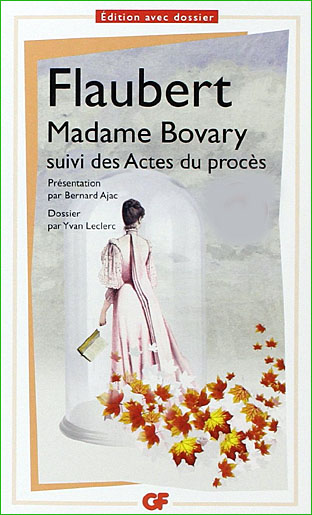
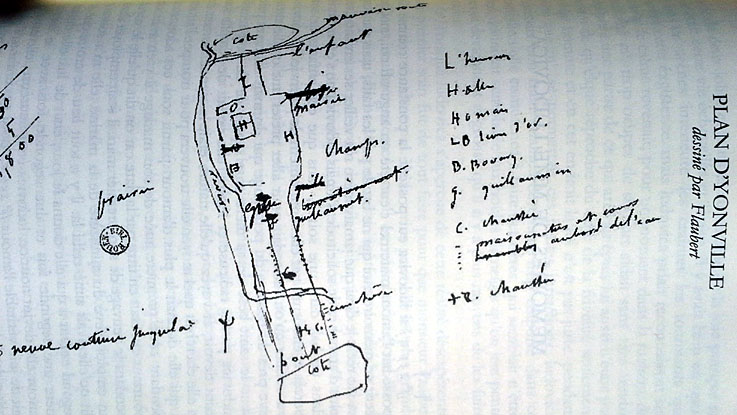
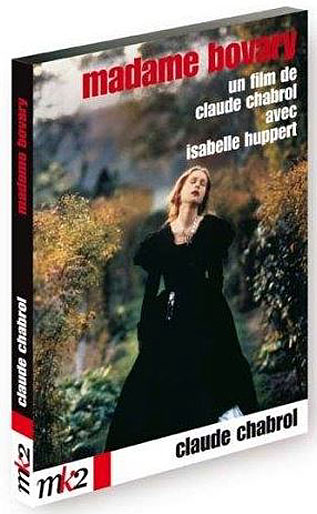
Commentaires récents