Dans un précédent billet, inspiré du tome 1 des Œuvres de Jules Vallès en Pléiade, j’écrivais que Vallès n’aimait pas Hugo, ce qui m’a valu l’ire commentée d’un président de fans dont le poète national est le fonds de commerce (il faut toujours voir les intérêts derrière les indignations). Pour Vallès, Hugo est avant tout « une statue creuse », une outre gonflée de vent. Dans le tome 2 de ses Œuvres, Vallès persiste et nuance. Hugo s’est converti – sur le tard, mais converti – au peuple, et descend de son Olympe pour regarder par sa fenêtre.
« Les fanfares crèvent le ciel », ainsi est Victor Hugo pour Jules Vallès (1er mars 1881, p.426 Pléiade). Il oppose Eugène Pottier, poète populaire et réaliste à Victor Hugo, poète romantique et idéaliste. Deux mondes dont il a choisi le sien. S’il reconnaît bien volontiers du talent à Hugo, il lui reproche son « biblisme », sa propension à voler toujours au-dessus de tout, dans les nuées de l’illusion et des grands principes. « M. Hugo (…) est trop longtemps resté sur les sommets (…) avec sa manie d’idéal » id.
Certes Victor Hugo a du « génie immense (…) qui a su dominer toute cette rouille et tenir ces traditions et ces idées au-dessus de l’égout des gémonies, dans le manteau de sa gloire. Mais c’est d’un autre côté maintenant qu’il faut tourner ses regards et son cœur ! ». Dans un article précédent, de mars 1874 (p.73 Pléiade), Jules Vallès loue le roman de Hugo : Quatre-vingt-treize. Parce que « sa prose a pris la défense des malheureux et des calomniés, passant en plein peuple, en plein cœur » p.74. Mais « on peut reprocher encore à Hugo un biblisme de phrases qui noie l’idée dans l’ombre ou la mouille dans le brouillard. Une manière solennelle et vague, mal appropriée à la précision terrible du drame qui se joue » p.79. Il « parle aux nuages » mais parle « à l’automne de sa vie » des « sacrifiés de l’humanité » p.80.
C’est au généreux, pas au prophète, que va l’admiration de Vallès pour Hugo : à l’ultime Hugo passé 70 ans, pas au reste de sa vie. « Il domine son temps, moins du sommet de son génie que du haut de la fenêtre de cette maison modeste que le poète ouvrit toute grande, un soir, à des vauriens couverts de sang et de crachats » (19 février 1882, p.766 Pléiade). Ramener le génie à la fenêtre est un rééquilibrage ironique bienvenu. L’idéal ne sert qu’à se donner bonne conscience mais l’acte concret, réel, est juste.

Victor Hugo a forgé sa propre statue et la nation l’a suivi pour des funérailles grandioses ; encore faut-il rappeler, comme Vallès, « qu’il tint pendant un quart de siècle pour le roi et pour l’empereur. Il n’arriva au respect du peuple, à la haine des Bonaparte, que le surlendemain de Juin et que le lendemain de Décembre » (id. p.767). La poésie est-elle liée à la tradition ? Ne chante-t-on bien qu’en religion ? « Je m’aperçois que tous les bardes sans exception ont été des religieux ou des religiosâtres, qu’ils ont tous chanté le bon Dieu ou le roi. – Tous ! » (id.). Y compris Victor Hugo, « qui marche si tard à la foule (…) malgré ses grands airs d’inspirée, malgré sa crinière au vent, et ses yeux pleins d’éclairs ! » (id.). Hugo en BHL va au peuple comme un père tout-puissant se penche sur les enfants, tout en prenant la pose théâtrale qui va rester dans l’opinion…
« Quand j’ai parlé d’Hugo, j’ai dit ce que je pensais, rien de plus, rien de moins », précise-t-il le 16 janvier 1882 à un lecteur du Réveil qui a vu ses convictions froissées par sa critique du poète national (p.755). Moi de même, j’ai dit ce que je lisais, rien de plus, rien de moins. N’en déplaisent aux croyants hugolâtres.
Jules Vallès, Œuvres tome II 1871-1885, Gallimard Pléiade 1990, édition de Roger Bellet, 2045 pages, €72.00


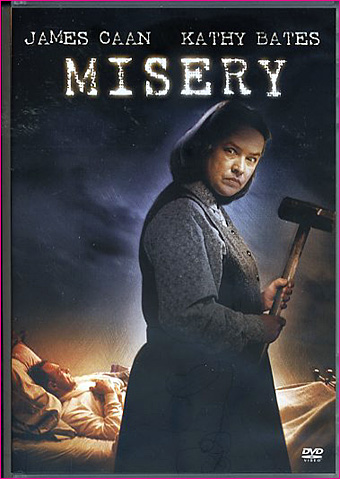

Commentaires récents