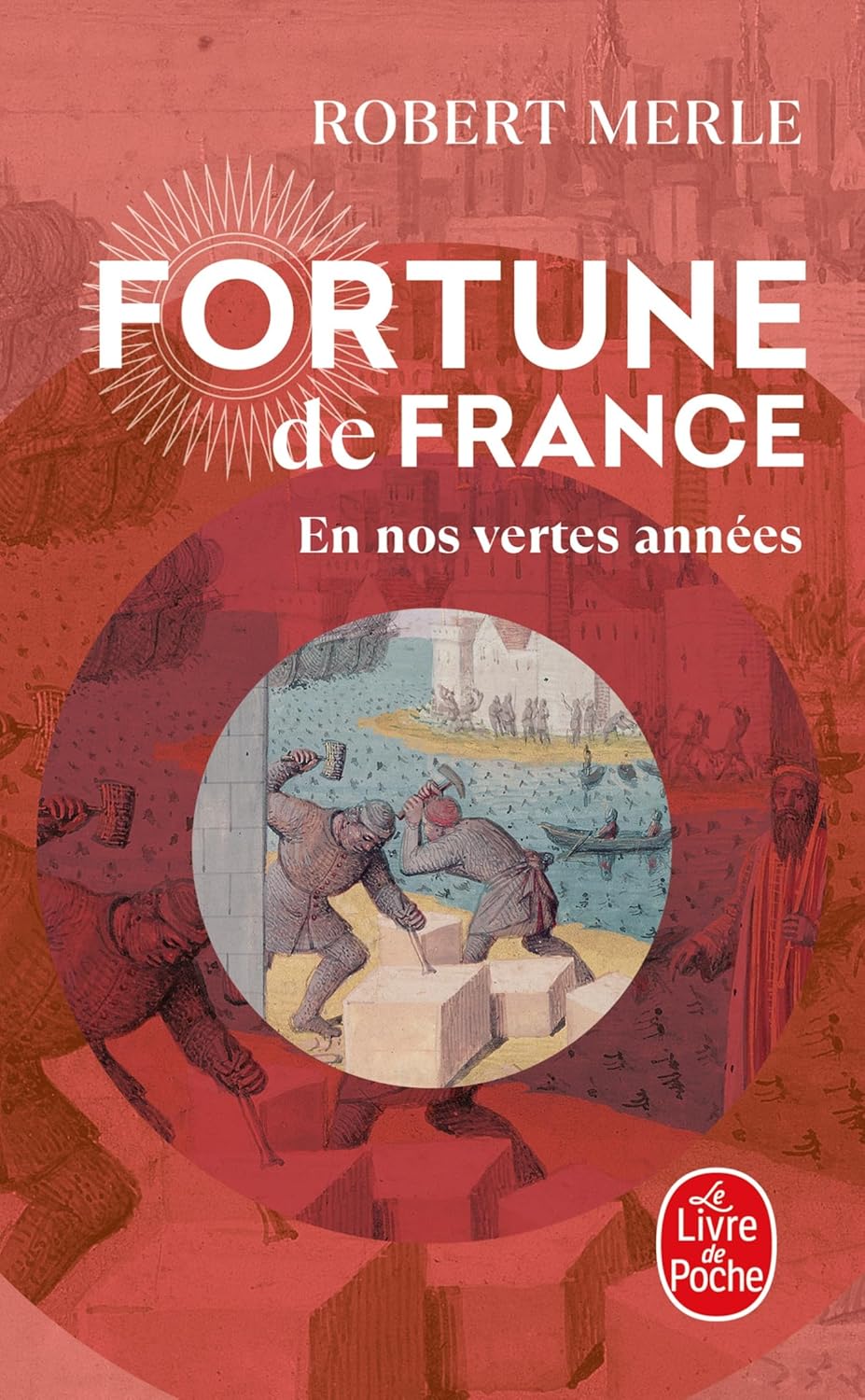
Si Fortune de France (chroniqué sur ce blog) a conté l’enfance de Pierre de Siorac, cadet du baron de Mespech, et de ses frères (et fait l’objet d’une série télé 2024), En nos vertes années conte son adolescence gonflée de vie et de tumulte. Né, comme on se ramentevoit (se souvient) le 28 mars 1551, Pierre n’a que 15 ans lorsqu’il est envoyé par son père à Montpellier, y apprendre en faculté la médecine. Il est accompagné de son demi-frère Samson du même âge que lui, et de son fidèle valet Miroul de trois ans plus âgé. Les trois compagnons entrent dans la belle ville du Languedoc en juin 1566.
Entre temps, que d’aventures ! Pierre n’a d’yeux que pour les garcelettes et les trousse à loisir quand leurs beaux yeux y consentent. Mais il ne les prend pas en soudard, aimant plutôt les envelopper de paroles et de compliments, tant il a appétit de leur chair fraîche et tendre. « Je le vois bien, c’est le piège que nous tend l’exquise beauté, en toutes ses parties, le corps de la femme. On cuide de se contenter de la rondeur d’un bras. Mais le bras qu’on vous abandonne, baisé et mignonné, l’appétit croît de sa nourriture même : il y faut tout » chapitre 10. Comme le jeune garçon est, à 15 ans, beau et bien fait, fort et courageux, elles consentent bien volontiers. Dès l’auberge de Toulouse, il doit besogner la soubrette puis l’aubergiste à la suite, en la verdeur de ses 15 ans.
Il est le chef de la troupe, son père en ayant décidé ainsi, Samson tenant les pécunes et Miroul surveillant ses excès, étant vite échauffé et de folle bravoure. Samson est un éphèbe grec, blond-roux bouclé et musclé comme une statue. Mais, élevé dès son âge tendre dans la religion réformée, il tient pour péché la chair et ne suit pas son frère bien-aimé Pierre en ses débordements. Celui-ci doit s’entremettre pour qu’il tombe amoureux de la belle Dame du Luc, Normande veuve en début de trentaine, qui fait pèlerinage à Rome en compagnie d’une troupe commandée par le baron de Caudebec. Samson est si beau que la dame en tombe raide ; elle ne tarde pas à l’initier aux plaisirs de la couche, Pierre intrigue pour cela, sans que le bienveillant et naïf Samson n’y touche. Il en a du remord car c’est péché pour la sainte religion, mais Pierre le convainc habilement que c’est péché bénin, Dieu nous ayant créé ainsi. La méchanceté est péché, pas l’amour. «Je sais qu’en lisant ceci d’aucuns vont aller sourcillant, me voyant tout entier à Vénus, et non content de courir moi-même le cotillon, d’en jeter un, et des plus ardents, dans le lit de Samson. Mais c’est la grande affection que j’avais de lui qui me fit faire cela, et tout autant, mon souci quasi paternel que l’être de Samson répondit à son apparence qui, certes, n’avait rien d’escouillé ni d’efféminé, car outre sa grande beauté, il était plus fort, robuste et musculeux qu’aucun fils de bonne mère en France, et c’était grande pitié, à mon sens, de voir ce bel étalon vivre comme nonne desséchée en cellule » chapitre trois.
Pierre se taille une réputation de vaillant capitaine en luttant contre les Caïmans qui écument les Cévennes, bandits de grand chemin qui rançonnent et qui tuent les voyageurs. Par ruse et stratégie, il défait la troupe, et le baron de Caudebec lui en sait gré, avant qu’il ne soupçonne qu’il soit huguenot. Ce que Pierre, par ruse, détourne en se confessant à la chevauchée à un moine sourd mais gourmand, auquel il baille un par un les gâteaux et tartelettes données par son aubergiste reconnaissante du plaisir qu’il lui a donné.
L’auteur, qui s’est documenté, nous fait découvrir l’état de la médecine en ce XVIe siècle de Rabelais et de Montaigne, laquelle consiste surtout à relire les Anciens en se méfiant de l’expérience et des dissections, condamnées par l’Église et à peine tolérées en faculté. Le trio loge chez Maître Sanche, un apothicaire marrane (juif faussement converti), chassé d’Espagne pour établir boutique de simples et de préparations dans Montpellier. Samson, voué initialement au droit, tombe en adoration devant cette profession, aimant par-dessus tout toucher aux remèdes plutôt qu’embarrassé à penser aux maladies. Ils font la connaissance de Fogacer, maigre et aux membres longs comme des pattes d’araignée, qui est Bachelier en médecine, tuteur des novices – et accessoirement sodomite.
Pierre, qui ne peut contenir sa crête haute, défie dès le jour de la rentrée des deuxièmes années qui veulent le chahuter malgré l’interdiction du Doyen, mais retourne la situation pour s’en faire des amis. C’est avec eux qu’il va déterrer deux cadavres dans un cimetière pour les disséquer, un orphelin de 8 ans mort de faim et une putain morte en couches, au logis d’un curé athée qui a écrit un libelle contre Dieu et le Diable, ne croyant ni à l’un, ni à l’autre. C’est dans ce cimetière sous la lune que Pierre est agrippée par une jeune folle, fille de sorcière et de sorcier brûlés pour cela, qui s’est fait prédire être engrossée à minuit par Belzébuth en cimetière. Pierre en profite, malgré lui, pour couvrir ses compagnons qui déterrent malgré les interdits. La fille lui happe sa semence, dont il espère qu’elle ne donnera pas naissance. Un peu plus tard, la fille sera brûlée pour blasphème et sorcellerie, tout comme le curé athée sera défroqué et brûlé lui aussi, moins pour ne pas croire que pour l’avoir écrit.
Dénoncé par le curé sous la torture, Pierre est obligé de se cacher, puis de fuir la ville au bout de quinze mois. Il a heureusement pris l’audace de faire la connaissance du vicomte de Joyeuse, père du magnifique petit garçon de 5 ans Anne de Joyeuse, qui fera sa gloire aux armées une fois adulte. Pierre a eu l’amabilité de donner au bel enfant des soldats de bois qu’il a fait sculpter par un caïman qui voulait l’’expédier, mais qu’il a sauvé, et ce jeu ravit tellement le garçonnet que son père en est tout ému et sa mère curieuse de faire sa connaissance. Pierre, en ses 15 ans, va donc conquérir l’esprit puis le cœur, enfin le corps de Madame de Joyeuse, la faisant vite se pâmer sous ses caresses manuelles et buccales, quasi nu sous son baldaquin, les suivantes renvoyées. Elle l’appelle son « petit cousin » pour une vague parenté de noblesse avec sa mère, née de Caumont. « Mon mignon, faites-moi cela que je veux », lui ordonne-t-elle sous les draps. Ce sont les Joyeuse qui recommandent Pierre aux Montcalm à Nîmes, pour qu’il aille avec son frère, le gentil Samson, et son valet fidèle, Miroul s’y mettrent au vert un moment.
Las ! C’est en cette année que les Protestants profitent des menaces des Catholiques, encouragée par la vipère changeante Catherine de Médicis, pour les attaquer dans les villes où ils ne sont pas assez nombreux, dont Montpellier et Nîmes. Pierre et sa suite se trouvent donc pris dans les Michelades de Nîmes, ce massacre de papistes opéré par les Huguenots, souvent convertis de fraîche date. Pierre en profite pour sauver l’évêque et le jeune frère de lait du capitaine huguenot. Il peut donc quitter Nîmes sain et sauf pour joindre le château de Barbentane, où Montcalm a pu se réfugier sur ses terres, avec sa femme et sa fille.
Mais d’autres Caïmans ont enlevé le trio, réclamant mille écus de rançon, avant de dépêcher les otages. Pierre de Siorac décide alors d’aller à leur recherche. Il s’adjoint des moines soldats d’une abbaye proche, plus l’intendant de Barbentane qui apportait la rançon, et maniant pistolet, arbalète, rapière, dague et arquebuse, réussit à occire tous les malfrats. Une fois au château, blessé au bras gauche, il fait l’objet de toute la reconnaissance de la famille et des soins attentifs des deux femmes. Il tombe amoureux de la fille unique, Angelina, qu’il séduit du plat de la langue en lui contant ses aventures, sans pousser physiquement ses avantages. Ils se promettent l’un à l’autre lorsque le père de Pierre et Samson, le baron de Mespech, vient les chercher en lourd équipage, en attendant des jours meilleurs.
Qu’il est bon de relire cette prose pleine de verdeur des années soixante-dix, qui chante l’adolescence et le plaisir en sus de l’étude et du combat, formant un homme complet ! Robert Merle nous a laissé un bain de jouvence dans ces livres d’aventures à la langue si mignonne du français qui se cherchait encore. Tous les aspects du temps sont abordés, de la condition des servantes à l’ingratitude des hommes, des plaisirs de la noblesse aux querelles de pensée, de l’avidité d’Église pour l’argent à la rude morale des soldats.
Robert Merle, En nos vertes années – Fortune de France tome 2, 1979, Livre de poche 1994, 667 pages, €10,68
(mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés Amazon partenaire)

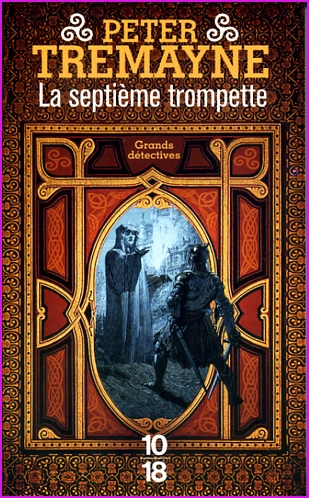
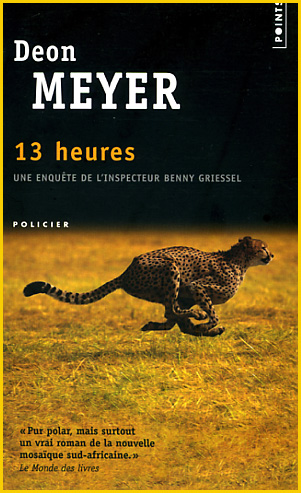


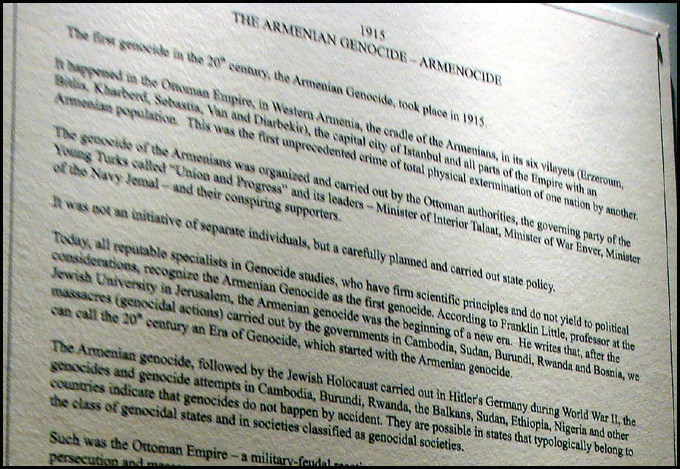


Commentaires récents