Ce livre très récent fait le point sur la bourse et sa place dans l’épargne des particuliers – donc des professionnels qui gèrent pour eux. Il se lit bien, présenté assez logiquement mais, malgré ses qualités, présente un défaut majeur et trois mineurs. On aimerait qu’il soit encore meilleur, ce pourquoi les quelques faiblesses sautent aux yeux.
Le défaut majeur est d’être publié au mauvais moment, dans une période où rares sont les particuliers à s’intéresser encore vraiment à la bourse, perçue comme un « casino » où les requins sans scrupules s’en mettent plein des poches sur le dos des entreprises comme des épargnants, tandis que « les autorités » ne voient rien, ne font rien et se contentent (des mois ou des années après) d’un appel à la morale.
Les défauts mineurs sont d’une part son titre mal choisi, dans la mode « identitaire » qui n’a pas grand sens pour une entité telle que « le » marché, mais aussi de ne jamais prendre clairement position avec un ton porté à la synthèse, enfin de ne pas dégager véritablement les « conseils » donnés aux particuliers.
Le trading à haute fréquence, plus ou moins défendu par l’auteur, améliorerait selon certains la liquidité du marché mais la submergerait de faux mouvements pour d’autres. A mon avis, cette façon de contourner la concurrence de marché par une série de micro-monopoles techniques (algorithmes automatiques, serveur local gagnant de la microseconde à se trouver plus proche du serveur central, afflux d’ordres pour faire monter les cours et affoler les indicateurs puis aussitôt les « annuler »), devrait purement et simplement être interdite. L’ampleur des volumes et les feintes de traders sont une mise en danger systémique de tout « le marché » financier.
Malgré cela, ce livre est rare en français, émis par un praticien de la finance sur une trentaine d’années, surtout comme vendeur actions puis analyste. Il se situe dans la suite des ouvrages de Paul Gagey, Didier Saint-Georges, Alain Sueur et Edouard Tétreau, pour citer les plus significatifs. L’auteur a le mérite de faire état des études américaines sur le sujet, bien plus nombreuses qu’en Europe, car il existe un vrai engouement pour « le marché » aux Etats-Unis, bourse toujours leader de la planète.
L’investisseur avisé, qu’il soit particulier ou même professionnel, lira donc Philippe Gallot avec profit. Le livre est en trois parties, la première sur les rumeurs et les informations, la seconde sur l’efficience attribuée au marché boursier, les exceptions et les conseils (la meilleure, à mon avis) et la dernière sur les acteurs, les malversations et la non-transparence.
Bien-sûr, il y a abus d’adverbes et des phrases parfois alambiquées, une erreur sur les Exchange Traded Funds (ETF) qui ne sont pas « Electroniques » (p.171) et Gustave Le Bon qui s’écrit en deux mots. Il y a aussi le dédain pour l’analyse technique ou graphique, sans expliquer vraiment pourquoi (sinon que l’auteur a été longtemps analyste, donc opposé à toute vue directe des mouvements). S’il évoque la finance comportementale avec profit, il manque d’exemples pris dans la pratique de gestion boursière et ne donne de conseils que généraux pour éviter ces erreurs humaines. Sur le trading et ses risques, il ne cite pas Jérôme Kerviel, pourtant LE cas français, ce qui est curieux pour un ouvrage destiné à un lecteur français.
Il est cependant très vivant lorsqu’il fait état de sa propre expérience, ce qu’il aurait dû mieux développer et imager. Ce livre apparaît plus comme un essai que comme un manuel pratique mais expose de façon utile la manière de fonctionner des « marchés », c’est-à-dire des acteurs qui le composent, chacun dans sa propre fonction. Le lecteur aura une compréhension large de ce qui se passe et pourra donc, avec ce recul, gérer au mieux sur le long terme, ses avoirs en actions, obligations ou monétaire.
Je ne crois pas, à la différence de l’auteur, au « moyen » terme, car les techniques automatiques de passations d’ordres en masse biaisent le moment : entre le trading au jour le jour (pour jouer les écarts) et la gestion à long terme (type assureur ou Warren Buffet), il n’y a plus rien. Comment un particulier ou un professionnel classique pourraient-ils « se battre » avec les algorithmes automatiques et faire triompher le bon sens là où n’existe que la curée du plus rapide et du plus fort ?
Philippe Gallot aime à citer les adages boursiers issus de la longue tradition anglaise d’abord, puis américaine ensuite. Il est cependant un adage qu’il ne cite pas : « Sell in May and go away – but buy back on Derby Day”, vendez en mai et quittez la bourse, mais rachetez dès le jour du Derby passé (premier dimanche de juin). L’observation – graphique, n’en déplaise à l’auteur – de cette année 2018 montre qu’effectivement, il était judicieux de de délester autour du 15 mai pour racheter dès le 1er juin, comme quoi les adages ont un fond de sagesse. L’explication en est probablement la publication des résultats à venir après la clôture du 30 juin, anticipés par le marché. Or, toute anticipation étant un risque, la prudence prévaut. Le premier trimestre est traditionnellement meilleur que les autres, avec les ventes de Noël et les perspectives de l’année entière ; le second trimestre suscite des doutes, donc du retrait de la part des investisseurs – même automatiques, car les modèles amplifient tous les mouvements moutonniers.
Au total un livre utile aux boursicoteurs (pour qu’ils prennent conscience de l’inanité de se battre contre les machines) et au épargnants long terme (qui verront pourquoi le bon sens et les grandes tendances emportent tout sur la durée).
Philippe Gallot, L’identité des marchés financiers – Conseils aux épargnants avisés, mars 2017, L’Harmattan, 276 pages, €29 e-book Kindle, €22.99



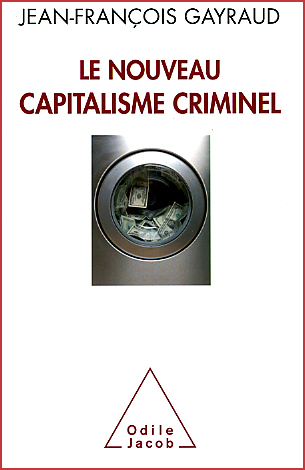


Édouard Tétreau, Analyste
La vraie vie vécue des années folles, celles de la bulle Internet 1998-2000, par un analyste en charge du secteur médias au Crédit lyonnais Securities Europe à Paris. Écrit clair, il y a de l’action à l’américaine et des exemples précis (sous pseudos pour éviter le judiciaire). Tout est vrai – j’y étais.
Mais, mieux que les anecdotes navrantes (la lâcheté Messier) ou croustillantes (le Puritain maître de la finance américaine et ses putes à Paris), une interrogation sur le snobisme social, les sursalaires indus et la course à la cupidité court-terme. La finance anglo-saxonne est une nuisance de l’économie globale, une guerre économique où « le droit », brandi par les puritains yankees, sert surtout à ligoter les autres, Européens et Japonais – alors que des hordes de lawyers et d’opportuns centres offshore à quelques dizaines de minutes de côtes américaines permettent d’y échapper.
Ce livre est écrit après l’éclatement des prémisses de la grande bulle (les valeurs technologiques en 2000 ont précédé la paranoïa du 11-Septembre en 2001 puis la comptabilité frauduleuse et l’audit mafieux en 2002) – mais avant le délire des dérivés en 2007 et la faillite de Lehman Brothers en 2008 – avec les conséquences systémiques, donc économiques, donc sociales, donc politiques dont on n’a pas encore vu tous les effets. Il décrit « comment ce théâtre de gens si savants au-dehors est en fait construit sur du sable. Le sable mouvant des fantasmes et des incohérences humaines » p.273.
Car vous pensiez que les analystes, après 5 ans minimum d’études supérieures en macroéconomie, audit, évaluation des entreprises et mathématiques financières, sont des experts capables de diagnostiquer la santé ou la maladie des sociétés cotées, de proposer des remèdes et de conseiller utilement les investisseurs ? Vous n’y êtes pas ! « Dans la formulation de son message comme dans sa conception, l’analyste doit aller au plus vite. Ce qui signifie : lire le communiqué de presse de la société, ou l’interview, ou le tableau de chiffres et, dans un minimum de temps, sortir le commentaire qui va faire vendre » p.39. Il ne s’agit pas de mesurer mais d’agiter. La bourse exige de la volatilité, des écarts de cours pour générer du business, donc de juteuses commissions. Ce pourquoi l’analyste passe plus de temps à commenter l’immédiat, appeler les clients, organiser des roadshows, qu’à analyser les entreprises. Il n’a plus « dans l’année que deux ou trois douzaines d’heures pour travailler activement sur chacune des entreprises suivies » p.174.
A son époque (2004) c’étaient les conseils d’achat et de vente aux gestionnaires de portefeuille pour faire tourner plus vite leurs actifs ; aujourd’hui (2014) plus besoin des gérants, le trading à haute fréquence, par algorithmes informatisés, s’en charge tout seul : plus besoin non plus d’analystes, ni de vendeurs, ni même de clients… Seul le marché pur et abstrait est le terrain de jeu pour les spéculateurs, entièrement déconnecté des entreprises réelles, de ce qu’elles produisent et des gens qui y travaillent.
Mais ce n’est pas que le commerce ou la bougeotte qui tord le métier d’analyste. C’est aussi la chaîne d’organisation, depuis l’entreprise jusqu’aux portefeuilles, qui incite à la stupidité. « Le processus d’investissement sur les marchés est simple : il suffit de suivre, ou de se raccrocher à la recommandation déjà émise par quelqu’un d’autre » p.49.
L’auteur l’a vécu, analyste médias dans les années flambeuses de J6M chez Vivendi (Jean-Marie Messier moi-même maître du monde, disait-il de lui-même…). « Le 6 mai [2002], deux jours après un changement de notation de l’agence Moody’s sur la dette de Vivendi, j’envoyais une note, alertant les clients investisseurs du Crédit lyonnais Securities d’un risque de faillite (bankruptcy) de ce groupe. Le lendemain, tous mes travaux furent placés sous embargo, en prélude à diverses sanctions disciplinaires. Le 3 juillet, Jean-Marie Messier quittait la présidence d’un groupe à quelques heures de la quasi-cessation de paiement » p.15.
Édouard Tétreau s’est reconverti en créant Mediafin, conseil en communication pour les entreprises. Il a publié fin 2010 ’20 000 milliards de dollars’ témoignage de trois années aux États-Unis après 2007 pour développer une filiale du groupe Axa, qui lui a fait comprendre combien la religion de la finance restait prégnante, laissant présager une bulle de la dette américaine vers 2020. L’ouvrage a été traduit en chinois, montrant combien la Chine est vigilante sur ses investissements en bons du Trésor des États-Unis…
Il y a pire que la vente à tout prix et la mauvaise organisation : l’emprise de toute une idéologie de la finance qui s’apparente à une véritable religion venue des États-Unis. Les croyants usent de mots magiques comme « création de valeur », « benchmark », EBITDA (bénéfices avant toute autre dépense), WACC (coûts du capital) et autre jargon en anglais. Lorsqu’il n’existe aucun mot dans votre langue pour traduire des concepts étrangers, vous les utilisez comme des boites noires sans savoir trop ce qu’elles contiennent. Mettant les habits d’une autre culture, vous avancez patauds, incertains, servilement scolaires. Ne comprenant pas le fond, vous singez. Non seulement vous vous abêtissez, mais vous agissez comme tout le monde pour donner le change et l’illusion sociale d’avoir compris. C’est bien ce qui se passe en analyse financière comme en gestion de portefeuille, j’en ai eu l’expérience directe personnellement (voir Les outils de la stratégie boursière, 2007).
Le « benchmark » est par exemple considéré par les directeurs de gestion français comme un garde-fou à surtout ne jamais franchir au-delà d’une étroite fourchette. La simple lecture d’un dictionnaire vous apprend que benchmark signifie en anglais utile le niveau du maçon : il est donc une mesure, pas un carcan ! Un maçon qui pave un trottoir parfaitement horizontal, selon le niveau à bulle, est un mauvais ouvrier doublé d’un imbécile : l’eau va stagner dans les creux. Le trottoir doit être en légère pente vers le caniveau pour remplir sa fonction de trottoir, le benchmark sert de référence pour marquer cette pente. Pas en France – où l’on doit obéir : à la hiérarchie qui n’y connais rien, à l’abstraction scolaire du mot anglais mal compris ! Quand on ne comprend pas on imite, quand on n’est pas pénétré de l’esprit on régurgite la leçon mot à mot. « Je mets d’ailleurs au défi n’importe lequel des dirigeants des vingt premières banques européennes d’être capable de comprendre, et accessoirement de faire comprendre à ses administrateurs et actionnaires, ce qui se passe exactement dans ces boites noires de l’industrie financière que sont les départements d’ingénierie financière et de produits dérivés… » p.75. M. Bouton, PDG de la Société générale, l’a illustré à merveille lors de l’affaire Kerviel.
Édouard Tétreau prend le même exemple en analyse avec la « shareholder’s value », maladroitement conçue en français comme « créer de la valeur pour l’actionnaire ». Or on ne « crée » pas de valeur, on en a ou on en hérite, l’entrepreneur ne crée que de la richesse (du flux), pas de la valeur (du stock). L’analyste français, par ce concept mal compris, ne va donc s’intéresser qu’à l’actionnaire, à la distribution de dividendes, au retour sur investissement du portefeuille. Alors que la base de la richesse de l’entreprise, celle qui va permettre qu’elle soit durable et puisse investir pour générer du bénéfice (à répartir ensuite en partie aux actionnaires apporteur de capital), est mesurée par la rentabilité : le retour sur fonds propres en fonction du risque assumé. C’est cela qu’il faut analyser, pas la distribution.
Plus qu’un simple témoignage de ces années stupides, ce livre est une sociologie de l’entre-soi parisien où les gens d’un même milieu, sortis des mêmes écoles avec les mêmes concepts abstraits, baignant dans le même jargon anglo-saxon qu’ils comprennent mal, font du fric en toute bonne conscience en enfumant les clients – qui sont, au total, vous et moi, les assurés comme les retraités. Mais ce qui est vrai de l’analyse financière l’est aussi en d’autres domaines : les médias, l’engouement web, les capteurs solaires, en bref tout ce qui est trop à la mode et qui fait délirer comme, il y a 4 siècles, les bulbes de tulipes !
Édouard Tétreau, Analyste – Au cœur de la folie financière, 2005, Prix des lecteurs du livre d’économie 2005, Grasset, 283 pages, €4.96 (occasion) à 18.34 (neuf)
Son site personnel
L’auteur de cette note a passé plusieurs dizaines d’années dans les banques. Il a écrit ‘Les outils de la stratégie boursière’ (2007) et ‘Gestion de fortune‘ (2009).