
Wade Owen Watts (Tye Sheridan) n’est pas encore né, il ne naîtra qu’en 2027. Mais, en 2049, orphelin depuis longtemps, il vit à 22 ans dans un taudis à Columbus (Ohio) avec sa tante qui l’a recueilli et le beauf macho qui est son compagnon. La société s’est effondrée avec la crise énergétique et climatique, et la société américaine « développée » s’est réfugiée dans l’illusion. La « réalité » virtuelle a remplacé la réalité tout court, tout comme les fausses vérités de Trompe remplacent dès aujiourd’hui la vérité réelle.

![]()
C’est ainsi que des petits génies de la tech, James Donovan Halliday (Mark Rylance) et Ogden Morrow (Simon Pegg), ont créé la société Gregarious Games – et fait fortune. Halliday est un inadapté social qui a voulu que l’Oasis remplace le monde réel où il se sentait mal. Il a inventé un système mondial de jeu vidéo multijoueurs, accessible par des casques de réalité virtuelle, des gants et des combinaisons qui simulent les sensations tactiles depuis chez soi dans son taudis. Dans ce métavers idéal, chacun compense ses frustrations dans la vie réelle. Une « bonne » façon (américaine) de se faire un max de fric avec la solitude et la psychopathie créée par le système économique où l’homme est un loup pour l’homme.
D’ailleurs, la compétition est ici encore encouragée. Halliday ne quitte pas le système américain lorsqu’il propose dans une vidéo, à sa mort en 2040, de « donner » les actions de son entreprise à celui ou celle qui parviendra à « gagner » (à l’américaine, où tous les coups sont évidemment permis) l’easter egg (œuf de Pâques) caché dans l’Oasis. Le gagnant des trois clés permettant d’ouvrir le coffre de l’œuf aura 500 milliards de $ et les pleins pouvoirs sur le jeu. De quoi devenir Maître du monde, même s’il n’est que virtuel.


Depuis cinq ans, rien. Nul n’a réussi à avancer dans le concours. Wade, sous son avatar de Parzival (le Perceval de la Quête du Graal) qui le magnifie en blond à la coiffure proliférante et aux yeux bleu clair, le corps tatoué de partout sous son tee-shirt noir et veste de jean sans manches ornée d’une épée d’or dans le dos, décide de devenir lui aussi un chasse-œufs. Il se mesure aux Sixers de la société Innovative Online Industries (IOI) dirigée par Nolan Sorrento (Ben Mendelsohn). Cet entrepreneur qui n’a rien inventé veut mettre la main sur l’Oasis en remportant le concours, pour maximiser les profits avec de la pub. Wade veut que le jeu reste libre. Deux conceptions du capitalisme américain : le fric ou le divertissement – on ne sort pas du système, mais le jeune Parzival est plus sympathique que le technocrate Nolan qui s’est créé un avatar de gros con musculeux bien que lent du cerveau. D’autant que Parzival n’a pas une armée d’experts à sa solde, comme le business man qui les fait bosser à des horaires d’esclave, mais quatre amis et son astuce. Toujours le mythe du Pionnier, seul contre la nature hostile.
Il échoue dans l’épreuve de la course automobile, où il retrouve son grand ami Aech (sous avatar super-mâle Terminator et qui se révélera être… la fille Helen – Lena Waithe) et la fameuse Artémis (déesse de la chasse) sous l’avatar d’une jeune rousse à moto (Olivia Cooke). Il se tourne alors vers les archives de la vie d’Halliday, un ensemble d’enregistrements vidéo reconstitués en réalité virtuelle, guidé par le Conservateur du Journal d’Halliday. Il découvre que le fondateur d’Oasis regrette certaines de ses décisions et aurait voulu revenir en arrière : voilà comment il faut gagner la course, non en se précipitant en avant, comme les jeunes loups avides du système capitaliste, mais en arrière, pour les devancer à la fin de la boucle… Être à contresens permet de ne pas penser comme la horde. C’est le secret du génie.
La première clé obtenue permet un indice. Artémis l’imite, suivie par Aech ainsi que Daito (en vrai Toshiro – Win Morisaki) et Sho (Philip Zhao), autres amis de Parzival dans le monde virtuel. Notez que le politiquement correct est respecté dans la répartition des races dans le monde réel : un Blanc, une Blanche, une Noire, un Japonais et un Chinois (lequel est un geek de 11 ans). L’indice est « un pas non franchi ». Ce serait le regret d’Halliday de ne jamais avoir embrassé Kira, laquelle s’est accouplée avec son partenaire Ogden Morrow. Il semble qu’Halliday n’ait jamais fait l’amour à une femme, d’où sa fuite dans le virtuel. Parzival gagne son pari sur le Conservateur, qui croyait que Kira était mentionnée plus d’une seule fois. L’avatar lui donne alors une pièce de 25 cents, qui aura un rôle crucial par la suite.


Sorrento veut alors éliminer ce redoutable concurrent qui arrive mieux que ses équipes de petits besogneux à se retrouver dans le jeu. Il envoie son mercenaire i-R0k (T. J. Miller) rechercher l’identité réelle de Parzival, lequel a la niaiserie de révéler son nom à Artémis qu’il connaît à peine, dans une boite (virtuelle) où Halliday a rencontré Kira. Écouté par i-ROk, l’amoureux se vend, et comme le bataillon de Sixers ne parvient pas à le dézinguer dans la boite, il fait sauter la pile où il habite, pulvérisant sa tante et son mec. Le père de Wade est mort endetté dans un Centre de fidélité de IOI et a été contraint de servir pour payer ses dettes. Aussi, lorsque Sorrento propose à Wade de travailler pour lui pour un très gros salaire avec bonus s’il gagne le concours, il refuse.
Capturé par Artémis – qui est dans la vraie vie la rebelle Samantha Cook – il rejoint Aech, Daito et Sho et tous comprennent que la seconde clé se trouve dans une simulation de l’hôtel Overlook de Shining, le film que Halliday voulait voir avec Kira. Artémis est capturée, Parzival s’évade et rejoint ses trois autres amis dans un fourgon postal anonyme. Ils préparent la troisième épreuve, qui est de jouer sur la console de jeu favorite d’Halliday, l’Atari 2600. Elle se trouve dans une forteresse gardée par IOI et protégée par une orbe magique. Wade parvient à pirater le fauteuil de jeu virtuel de Sorrento, assez stupide pour avoir laissé écrit sur un post-it ses mots de passe, et à délivrer Samantha enfermée dans une cage de l’usine à jeu. Parzival lance alors un appel au peuple, comme une cagnotte virtuelle, pour attaquer en masse la forteresse. Le combat faite rage, Daito lutte contre le Mecha-Godzilla de Sorrento et meurt en virtuel, Aech aussi en Géant de fer, ce qui permet à Parzival, Artémis et Sho de pénétrer la forteresse. Pour que Samantha puisse s’enfuir de l’IOI, Parzival tue son avatar Artémis. Elle est cueillie dans le fourgon d’Aech, mais ils sont poursuivis par F’Nale (Hannah John-Kamen), cheftaine implacable des Sixers – une véritable executive woman yankee.


Sorrento, vaincu, réinitialise le jeu par une bombe qui anéantit tous les avatars… sauf un : Parzival, grâce à sa pièce de 25 cents, possède une vie supplémentaire. Il joue alors à Adventure pour y trouver l’easter egg en trouvant la salle secrète du jeu, et la troisième clé. Il découvre alors un avatar d’Halliday qui lui donne à signer le contrat de cession de ses actions. Mais Parzival est un pur ; il se souvient que qu’Halliday a perdu son seul ami, son partenaire Morrow, avec ce genre de contrat. Il refuse alors de signer – et Halliday est content. Cette tentation du veau d’or était la dernière épreuve (les Yankees restent très bibliques, et Sipelberg très dans les codes).
Après une dernière course-poursuite dans la tradition d’Hollywood (la trilogie grosses bagarres, grosse course, grosse explosion, auquel le film de Spielberg sacrifie largement), le Wade du monde réel décide de partager le contrôle de l’Oasis, qu’il a gagné avec leur aide, avec ses quatre amis. Le Conservateur était l’avatar de Morrow et il offre ses services de consultant pour un salaire de 25 cents. Le jeu qui aurait pu devenir totalitaire reste démocratique… jusqu’aux Tromperies depuis. Les cinq amis prennent la décision saluée d’interdire l’accès au jeu aux Centres de fidélité d’IOI. Ils prennent aussi une liberté très impopulaire : l’Oasis sera fermé deux jours par semaine, les mardis et jeudis. Il faut parfois être impopulaire pour le bien du peuple. Les gens doivent prendre du temps pour vivre et aimer dans le monde réel.

Le film a plu aux ados par ses nombreuses références à la pop-culture comme à la culture geek des jeux vidéo, des super-héros, des films et des séries télé cultes. Un film rempli d’effets spéciaux et sans aucune scène que la pudibonderie croyante pourrait réprouver (à peine un seul baiser, à la fin). D’innombrables souvenirs des années 80, ses jeux vidiots, ses héros super – toute une génération du divertissement, biberonnée à Hollywood sous Mitterrand, qui nous donne ces politiciens minables d’aujourd’hui. La génération des bébés boum, ceux qui animaient les boums et et y baisaient à loisir (et pas avec les curés), selon la nomenclature Bayrou. Pas la mienne. Reste un film qui se regarde une fois. Un vestige d’époque.
DVD Ready Player One, Steven Spielberg, 2018, avec Tye Sheridan, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn, Warner Bros. Entertainment France 2018, anglais doublé français, allemand, italien, 2h18, €3,45
(mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés par amazon.fr)













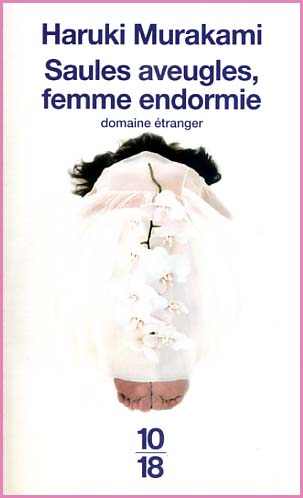

Commentaires récents