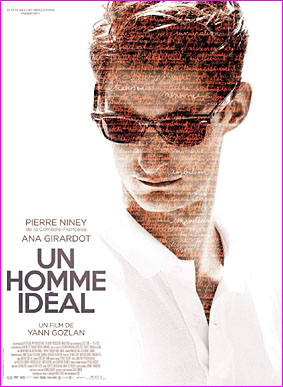
Mathieu (Pierre Niney, 26 ans au tournage) est le Julien Sorel moderne. Comme le héros de Stendhal, il part de rien, au bas de la société, et veut arriver par les lettres. Il veut conquérir la femme et la fortune pour être enfin quelqu’un. Sauf qu’il n’a pas de talent véritable et que les romans qu’il écrit sont insipides et lassants ; ils sont tous refusés par les éditeurs. Machines à fric, ces derniers se contentent de la lettre administrative standard pour refuser les manuscrits (qui ne sont pas rendus). Or Mathieu voudrait bien savoir pourquoi ce qu’il écrit ne fonctionne pas. Sa femme plus tard lui livrera la clé : « La différence entre un bon auteur et un mauvais auteur c’est le discernement. Un bon auteur quand c’est mauvais il jette. »
Déménageur au noir chez son oncle, il survit de petits boulots qui lui font quelques muscles et lui assurent la matérielle, mais il voudrait émerger. Lors d’un enlèvement de colis dans un lycée, il entend quelques minutes la conférence d’une jeune bourgeoise lettrée, Alice (Ana Girardot), qui évoque les parfums comme réveillant la mémoire dans le roman. Il en est subjugué.
Lorsqu’un beau jour il découvre le cahier manuscrit d’un ancien appelé en Algérie entre 1956 et 1958, il tient là de quoi publier : un modèle. Son auteur est mort sans héritier et les déménageurs mettent tout à la benne. Mais, parce qu’il veut arriver vite, Mathieu fait ce que tous les jeunes de sa génération (10 ans en 2000) font avec leur CV ou leurs mémoires et thèses : il triche (les grandes écoles usent de logiciels anti-plagiat contre ça). Il aurait pu présenter le texte et le publier en l’absence d’héritiers ; il aurait pu s’en inspirer pour en faire un roman en modifiant les noms et les dates… Mais non : il s’approprie le texte brut et le signe de son nom ; il n’invente même pas le titre, Sable noir, qu’il trouve en marge du manuscrit.

Il croit seulement mettre un pied dans la porte pour publier ensuite ses propres romans, une fois son nom reconnu. Mais le succès surgit, imprévu, et cela le dépasse. Il doit gérer les interviews et les cocktails mondains qui ne sont pas de son monde. Il se documente à la bibliothèque et sur le net, va au plus facile (les livres illustrés pour enfants) et aux résumés wikipèdes. Il apprend par cœur quelques dates et événements pour faire croire. Ainsi que quelques citations sur l’écriture trouvées sur YouTube pour briller devant les critiques (dont une de Romain Gary).
Il obtient le prix Renaudot (comme Matzneff), un prix de journalistes et de copains. Voilà Mathieu Vasseur lancé comme jeune espoir de la littérature en France. Il écrit sec, direct, attentif aux petits détails. Du moins le cahier volé est-il ainsi rédigé – car lui ne parvient pas à imiter son modèle ; il n’essaie même pas, se contentant de retravailler son manuscrit refusé.

Il se marie avec Alice mais, trois ans plus tard, l’éditeur s’impatiente : le montant des à-valoir dépassent le budget et Mathieu n’a toujours pas livré de second roman. En vacances dans la villa sur la côte d’Azur des parents d’Alice, Mathieu s’acharne mais rien ne vient. C’est l’angoisse de l’écran bleu (version moderne de la page blanche). D’autant que le succès le poursuit, l’empêchant de se concentrer. Lors d’une dédicace en librairie de la ville, un homme, Vincent (Marc Barbé) se présente comme ayant connu le véritable auteur du cahier ; il a le matin même envoyé à la villa une photo de l’appelé en Algérie. Il fait chanter le juvénile et fragile Mathieu à peine de le dénoncer publiquement devant ses riches beaux-parents et devant la presse avide de scandale (et de trainer dans la boue ceux qu’elle vient d’adorer).

Mathieu perd prise ; il ne contrôle plus rien, tout part à vau-l’eau : il doit trouver 50 000 € pour contenter le maître chanteur, fournir un manuscrit terminé à son éditeur, couvrir ses dettes auprès de son banquier, penser à Alice qui se déclare enceinte !… Sauver les apparences en étouffant l’incendie là où il se déclare est la seule façon de rester ancré dans la réalité car le rêve est terminé. On ne devient adulte qu’à ce prix. Or Mathieu est entre-deux, encore adolescent par son corps fluet et nerveux, ses grands yeux expressifs, son émotion à fleur de peau et son long décolleté imberbe. Comme Alain Delon jadis dans Plein soleil, ou La piscine, Pierre Niney exprime une violence latente par tout son corps. Il est en pleine tension du désir : aimer, écrire, arriver. Mais, comme Julien Sorel, il est pris dans l’engrenage de la fatalité, chaque initiative entraînant son lot de conséquences.

Ainsi simule-t-il une agression pour justifier auprès de son éditeur la perte du nouveau manuscrit sur son ordinateur détruit.
Ainsi vole-t-il des pistolets de collection du beau-père pour l’équivalent des 50 000 € du chantage. Mais il les cache dans la maison en attendant le rendez-vous avec l’homme et Stanislas (Thibault Vinçon), le filleul du beau-père, le découvre. Il soupçonne Mathieu d’être un imposteur dès l’origine, probablement parce qu’il n’a pas les codes de son milieu bourgeois et qu’il est un brin jaloux de la préférence d’Alice et de l’admiration de son parrain. Dans la lutte, Mathieu le frappe d’un coup de crosse – et le tue. Cela non plus n’était pas prévu et il doit encore improviser, s’enfonçant un peu plus dans le mensonge au risque d’y perdre son âme. Il ficelle le corps dans une bâche comme un rôti et va le jeter en mer. Las ! des pêcheurs le prennent dans leurs filets car il n’est pas allé assez loin : il ne va jamais assez loin dans l’escroquerie mais pare au plus pressé, en naïf encore immature. Son ADN va parler mais il retarde le prélèvement.
Ainsi invite-t-il son maître chanteur qui lui demande encore de l’argent à venir avec lui dans la villa que les parents ont quitté pour Londres quelques jours. Il introduit une pièce de monnaie dans le mécanisme de la ceinture de sécurité pour qu’elle soit inutilisable puis fonce avec la BMW du beau-père dans une paroi de terre. Lui s’en sort, ceinture et airbag, pas son voisin. Il l’installe alors à sa place de conducteur, lui met son portable dans la poche et sa montre au poignet puis brûle le véhicule. La police, candide ou préoccupée d’autre chose, admet la thèse de sa mort. Le maître chanteur, bien que disparu, ne gêne personne : telles sont les invraisemblances de la fin, un brin acrobatique, de ce thriller pourtant bien mené.

Mathieu devient alors une non-personne : il retourne travailler au noir et se cache de ceux qui l’ont connu célèbre (pas son oncle ni ses ouvriers qui se moquent des livres comme de leur premier slip). Il aurait pourtant pu orienter autrement sa vie : Alice, en lui disant être enceinte, stimule en lui la maturité et lui permet d’accoucher d’un roman aussi de lui que son enfant. Sous le titre Faux-Semblant, il y conte directement son histoire de faussaire, dans le même style direct de l’appelé d’Algérie. Parler de ce qui vous arrive est plus facile que d’inventer des personnages. Ayant démêlé l’écheveau de son destin, il aurait pu être adulte, père, écrivain et bourgeois des lettres arrivé ; ce n’est passé qu’à un cheveu, comme dans Match point. Mais s’il ressurgit, son ADN parlera dans l’enquête sur la mort de Stanislas et, le corps calciné n’étant pas le sien, il sera accusé d’un second crime avec préméditation.
Il ne peut que se faire oublier. Mais pour combien de temps ? Est-il condamné à rester non-existant sans jamais se faire repérer, sans pouvoir officiellement travailler, sans jamais qu’on lui demande ses papiers ? Il voulait être quelqu’un et il n’est plus personne – ou plutôt il n’est que ce qu’il laisse derrière lui : une publication devenue célèbre sous son nom, un second roman de lui qui semble réussir et une petite fille. Comme Achille, comme Julien Sorel, il aura eu une vie courte et brillante plutôt que longue et terne. Deux ans plus tard… mais je vous laisse découvrir le choix qui sera fait. .
Pierre Niney porte le suspense de bout en bout, blanc-bec et décidé, ambitieux et amoral, mais pas complètement : il se sait imposteur et ne parvient pas à incarner le mal entièrement. Le spectateur le trouve alternativement sympathique et antipathique, sans talent mais inventif, inabouti et courageux. Au fond, tout est vanité sociale dans la comédie humaine : briller, c’est se brûler les ailes ; être soi-même, c’est être rejeté par la horde légère de celles et ceux qui font l’opinion – sauf si l’on a du talent. Mais le travail ne suffit pas à le créer, contrairement aux promesses de la méritocratie bourgeoise… Cette découverte du candide 2015 au mitan de sa vingtaine rend le personnage attachant.
DVD Un homme idéal, Yann Gozlan, avec Pierre Niney, Ana Girardot, André Marcon, Valeria Cavalli, Thibault Vinçon, Marc Barbé, TF1 studio 2015, 1h33, €7.16 blu-ray €4.49



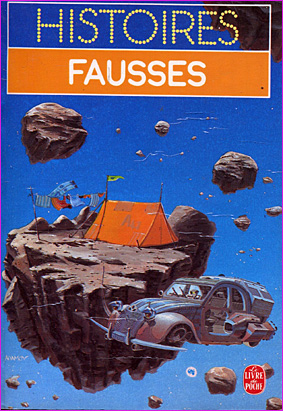
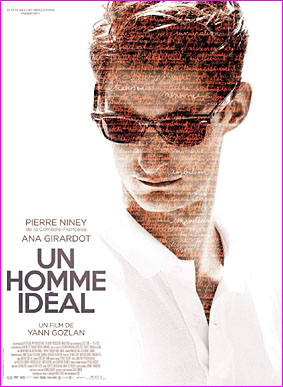





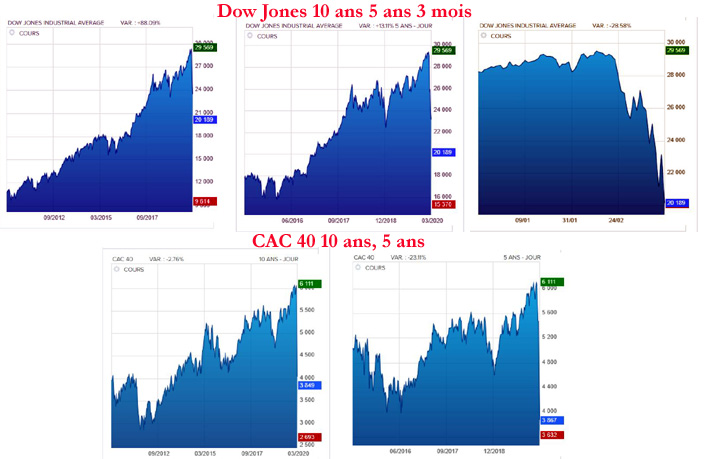
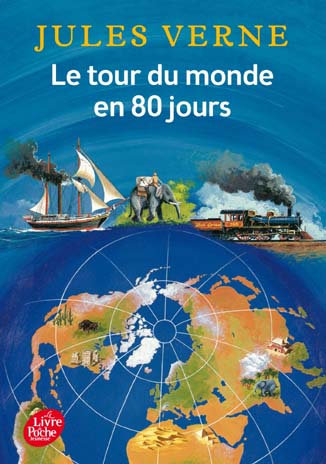

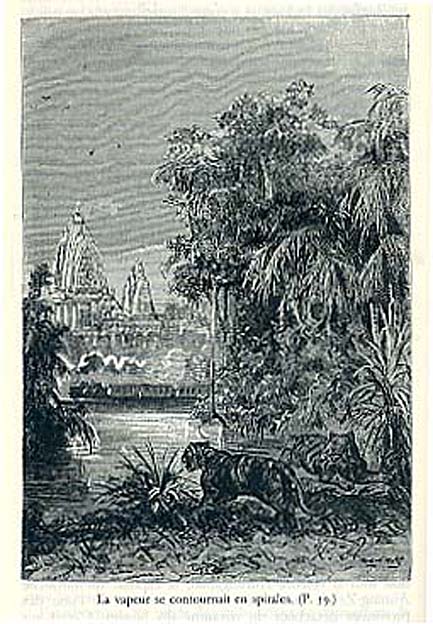
Commentaires récents