
Bientôt le 4 novembre, et peut-être le bouffon Trump au pouvoir… Souvenons-nous de Giuliano di Empoli.
Dans un livre éclairant, l’auteur montre comment l’informatique et les réseaux sociaux ont utilisé le marketing commercial pour créer le populisme en politique. En six chapitres, il examine le mouvement italien des cinq étoiles, la dérision à la Waldo, le troll en chef Trump, l’illibéralisme d’Orban en Hongrie et le rôle des physiciens. La politique est un nouveau carnaval, plus proche des jeux télévisés que du débat sur l’agora. « Le nouveau Carnaval ne cadre pas avec le sens commun, mais il a sa propre logique, plus proche de celle du théâtre que de la salle de classe, plus avide de corps et d’images que de textes et d’idées, plus concentrée sur l’intensité narrative que sur l’exactitude des faits » Introduction. Ce n’est pas le Mélenchon et les pitreries d’ados de Troisième de ses affidés à l’Assemblée qui le contrediront.
Mais il y a pire : « Ce qui fait encore une fois de l’Italie la Silicon Valley du populisme, c’est qu’ici, pour la première fois, le pouvoir a été pris par une forme nouvelle de techno–populisme post–idéologique, fondée non pas sur les idées mais sur les algorithmes mis au point par les ingénieurs du chaos. Il ne s’agit pas, comme ailleurs, d’hommes politiques qui engagent des techniciens, mais bien de techniciens qui prennent directement les rênes du mouvement en fondant un parti, en choisissant les candidats les plus aptes à incarner leur vision, jusqu’à assumer le contrôle du gouvernement de la nation entière » chapitre 1. « Le modèle de l’organisation du mouvement 5 étoiles (est) une architecture en apparence ouverte, fondée sur la participation par le bas, mais en réalité complètement verrouillée et contrôlée par le haut » chapitre 2.
Mais les algorithmes ne sont rien sans les passions humaines. « Dans un livre publié en 2006, Peter Sloterdjik a reconstruit l’histoire politique de la colère. Selon lui, un sentiment irrépressible traverse toutes les sociétés, alimenté par ceux qui, à tort ou à raison, pensent être lésés, exclus, discriminés ou pas assez écoutés. (…) Bien plus que des mesures spécifiques, les leaders populistes offrent aux électeurs une opportunité unique : voter pour eux signifie donner une claque aux gouvernants. (…) Il est plus probable qu’Internet et l’avènement des smartphones et des réseaux sociaux y soient pour quelque chose. (…) Nous nous sommes habitués à voir nos demandes et nos désirs immédiatement satisfaits. (…) Mais derrière le rejet des élites et la nouvelle impatience des peuples, il y a la manière dont les relations entre les individus sont en train de changer. Nous sommes des créatures sociales et notre bien-être dépend, dans une bonne mesure, de l’approbation de ce qui nous entoure. (…) Chaque like est une caresse maternelle faite à notre ego. (…) La machinerie hyper puissante des réseaux sociaux, fondée sur les ressorts les plus primaires de la psychologie humaine, n’a pas été conçue pour nous apaiser. Bien au contraire, elle a été construite pour nous maintenir dans un état d’incertitude et de manque permanent » chapitre 3,
« La rage, disent les psychologues, est l’affect narcissique par excellence, qui naît d’une sensation de solitude et d’impuissance et qui caractérise la figure de l’adolescent, un individu anxieux, toujours à la recherche de l’approbation de ses pairs, et en permanence effrayé à l’idée d’être en inadéquation » chapitre 3. Les électeurs, infantilisés par la télé puis par les réseaux et les théories du complot qui sont si séduisantes parce qu’elles donnent une « raison » claire à ce qui est bien compliqué, sont restés des ados. « Le mégaphone de Trump est l’incrédulité et l’indignation des médias traditionnels qui tombent dans toutes ses provocations. Ils lui font de la publicité et, surtout, ils donnent de la crédibilité à sa revendication, a priori saugrenue pour un milliardaire new-yorkais d’être le candidat anti-establishment. (…) Les téléspectateurs de l’Amérique rurale n’ont qu’à observer la réaction scandalisée des élites urbaines face à la candidature de The Donald pour se convaincre que vraiment, cet homme peut représenter leur ras-le-bol contre Washington » chapitre 4.
Comment en est-on arrivé là ?
« Premièrement : une machine surpuissante, conçue à l’origine pour cibler avec une précision incroyable chaque consommateur, ses goûts et ses aspirations, a fait irruption en politique. (…) Deuxièmement : grâce à cette machine, les campagnes électorales deviennent de plus en plus des guerres entre software, durant lesquelles les opposants s’affrontent à l’aide d’armes conventionnelles (messages publics et informations véridiques) et d’armes non conventionnelles (manipulations et fake news) avec l’objectif d’obtenir des résultats : multiplier et mobiliser leurs soutiens, et démobiliser ceux des autres. » Chapitre six.
« Le rôle des scientifiques a été décisif. Facebook leur a permis de tester simultanément des dizaines de milliers de messages différents, sélectionnant en temps réel ceux qui obtenaient un retour positif et réussissant, à travers un processus d’optimisation continue, à élaborer les versions les plus efficaces pour mobiliser les partisans et convaincre les sceptiques. Grâce au travail des physiciens, chaque catégorie d’électeurs a reçu un message ad hoc (…) de plus, grâce à toutes les versions possibles de ces messages taillés sur mesure, les physiciens ont pu identifier celles qui étaient les plus efficaces, de la formulation du texte au graphisme » chapitre 6.
« Comme le Revizor de Gogol, le leader politique devient « un homme creux » : « les thèmes de sa conversation lui sont donnés par ceux qu’il interroge : ce sont eux qui lui mettent les mots dans la bouche et créent la conversation. » L’unique valeur ajoutée qu’on lui demande est celle du spectaculaire. « Never be boring » est la seule règle que Trump suit rigoureusement, produisant chaque jour un coup de théâtre, tel le cliffhanger d’une série télévisée qui contraint le public à rester collé à l’écran pour voir l’épisode suivant » chapitre 6.
Est-on condamné au chaos ?
« Le problème est qu’un système caractérisé par un mouvement centrifuge est, forcément, de plus en plus instable. Cela vaut pour les gaz naturels, comme pour les collectifs humains. Jusqu’à quand sera-t-il possible de gouverner des sociétés traversées par des poussées centrifuges toujours plus puissantes ? » chapitre 6.
« Les nouvelles générations qui observent aujourd’hui la politique sont en train de recevoir une éducation civique faite de comportements et de mots d’ordre illibéraux qui conditionneront leurs attitudes futures. Une fois les tabous brisés, il n’est pas possible de les recoller » chapitre 6. Cela veut dire les injures et invectives des bouffons de l’extrême-gauche comme de l’extrême-droite, le mépris de toute vérité commune, le tout tout de suite de gamin de 2 ans, et – de fait – le bordel à la Mélenchon à l’Assemblée nationale.
La démocratie représentative apparaît comme une machine conçue pour blesser les egos. « Comment ça, le vote est secret ? Les nouvelles conventions consentent, ou plutôt prétendent, à ce que chacun se photographient à n’importe quelle occasion, du concert de rock à l’enterrement. Mais si tu essaies de le faire dans l’isoloir, on annule tout ? Ce n’est pas le traitement auquel nous ont habitué Amazon et les réseaux sociaux ! »
« Si la volonté de participer provient presque toujours de la rage, l’expérience de la participation aux 5 étoiles, à la révolution trumpienne, aux Gilets jaunes, est une expérience très gratifiante, et souvent joyeuse ». Cette passion politique doit être reprise par les libéraux traditionnels pour vanter leurs projets et faire aduler leurs candidats. Une nouvelle ère politique commence, où la raison et la vérité sont éclatées. « Avec la politique quantique, la réalité objective n’existe pas. Chaque chose se définit, provisoirement, en relation avec quelque chose d’autre et, surtout, chaque observateur détermine sa propre réalité » Conclusion.
Attendons-nous à de nouveaux dégâts, même si le mouvement 5 étoiles a disparu dans les limbes, le Brexit laissé un goût amer aux Anglais qui y ont cru, et que les promesses de l’extrême-droite un peu partout montrent très vite leurs limites dans la réalité concrète (sauf peut-être en Italie, ce laboratoire politique de l’Europe de demain). Le pire serait un régime autoritaire usant des algorithmes pour museler toute déviance, un peu comme ce qui se fait en Chine communiste, et que Poutine tente d’acclimater chez lui, imité par Orban. Le Big Brother is watching you ! d’Orwell, était peut-être prophétique…
Giuliano di Empoli, Les ingénieurs du chaos, 2019, Folio 2023, 240 pages, €8,30 e-book Kindle (ou Kobo sur le site Fnac) €7,99
(mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés Amazon partenaire)
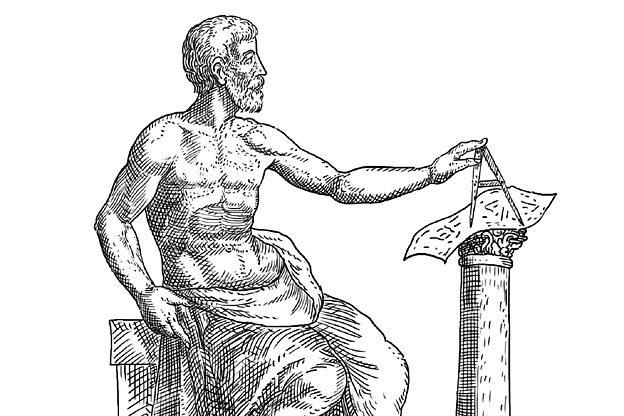






Édouard Tétreau, Analyste
La vraie vie vécue des années folles, celles de la bulle Internet 1998-2000, par un analyste en charge du secteur médias au Crédit lyonnais Securities Europe à Paris. Écrit clair, il y a de l’action à l’américaine et des exemples précis (sous pseudos pour éviter le judiciaire). Tout est vrai – j’y étais.
Mais, mieux que les anecdotes navrantes (la lâcheté Messier) ou croustillantes (le Puritain maître de la finance américaine et ses putes à Paris), une interrogation sur le snobisme social, les sursalaires indus et la course à la cupidité court-terme. La finance anglo-saxonne est une nuisance de l’économie globale, une guerre économique où « le droit », brandi par les puritains yankees, sert surtout à ligoter les autres, Européens et Japonais – alors que des hordes de lawyers et d’opportuns centres offshore à quelques dizaines de minutes de côtes américaines permettent d’y échapper.
Ce livre est écrit après l’éclatement des prémisses de la grande bulle (les valeurs technologiques en 2000 ont précédé la paranoïa du 11-Septembre en 2001 puis la comptabilité frauduleuse et l’audit mafieux en 2002) – mais avant le délire des dérivés en 2007 et la faillite de Lehman Brothers en 2008 – avec les conséquences systémiques, donc économiques, donc sociales, donc politiques dont on n’a pas encore vu tous les effets. Il décrit « comment ce théâtre de gens si savants au-dehors est en fait construit sur du sable. Le sable mouvant des fantasmes et des incohérences humaines » p.273.
Car vous pensiez que les analystes, après 5 ans minimum d’études supérieures en macroéconomie, audit, évaluation des entreprises et mathématiques financières, sont des experts capables de diagnostiquer la santé ou la maladie des sociétés cotées, de proposer des remèdes et de conseiller utilement les investisseurs ? Vous n’y êtes pas ! « Dans la formulation de son message comme dans sa conception, l’analyste doit aller au plus vite. Ce qui signifie : lire le communiqué de presse de la société, ou l’interview, ou le tableau de chiffres et, dans un minimum de temps, sortir le commentaire qui va faire vendre » p.39. Il ne s’agit pas de mesurer mais d’agiter. La bourse exige de la volatilité, des écarts de cours pour générer du business, donc de juteuses commissions. Ce pourquoi l’analyste passe plus de temps à commenter l’immédiat, appeler les clients, organiser des roadshows, qu’à analyser les entreprises. Il n’a plus « dans l’année que deux ou trois douzaines d’heures pour travailler activement sur chacune des entreprises suivies » p.174.
A son époque (2004) c’étaient les conseils d’achat et de vente aux gestionnaires de portefeuille pour faire tourner plus vite leurs actifs ; aujourd’hui (2014) plus besoin des gérants, le trading à haute fréquence, par algorithmes informatisés, s’en charge tout seul : plus besoin non plus d’analystes, ni de vendeurs, ni même de clients… Seul le marché pur et abstrait est le terrain de jeu pour les spéculateurs, entièrement déconnecté des entreprises réelles, de ce qu’elles produisent et des gens qui y travaillent.
Mais ce n’est pas que le commerce ou la bougeotte qui tord le métier d’analyste. C’est aussi la chaîne d’organisation, depuis l’entreprise jusqu’aux portefeuilles, qui incite à la stupidité. « Le processus d’investissement sur les marchés est simple : il suffit de suivre, ou de se raccrocher à la recommandation déjà émise par quelqu’un d’autre » p.49.
L’auteur l’a vécu, analyste médias dans les années flambeuses de J6M chez Vivendi (Jean-Marie Messier moi-même maître du monde, disait-il de lui-même…). « Le 6 mai [2002], deux jours après un changement de notation de l’agence Moody’s sur la dette de Vivendi, j’envoyais une note, alertant les clients investisseurs du Crédit lyonnais Securities d’un risque de faillite (bankruptcy) de ce groupe. Le lendemain, tous mes travaux furent placés sous embargo, en prélude à diverses sanctions disciplinaires. Le 3 juillet, Jean-Marie Messier quittait la présidence d’un groupe à quelques heures de la quasi-cessation de paiement » p.15.
Édouard Tétreau s’est reconverti en créant Mediafin, conseil en communication pour les entreprises. Il a publié fin 2010 ’20 000 milliards de dollars’ témoignage de trois années aux États-Unis après 2007 pour développer une filiale du groupe Axa, qui lui a fait comprendre combien la religion de la finance restait prégnante, laissant présager une bulle de la dette américaine vers 2020. L’ouvrage a été traduit en chinois, montrant combien la Chine est vigilante sur ses investissements en bons du Trésor des États-Unis…
Il y a pire que la vente à tout prix et la mauvaise organisation : l’emprise de toute une idéologie de la finance qui s’apparente à une véritable religion venue des États-Unis. Les croyants usent de mots magiques comme « création de valeur », « benchmark », EBITDA (bénéfices avant toute autre dépense), WACC (coûts du capital) et autre jargon en anglais. Lorsqu’il n’existe aucun mot dans votre langue pour traduire des concepts étrangers, vous les utilisez comme des boites noires sans savoir trop ce qu’elles contiennent. Mettant les habits d’une autre culture, vous avancez patauds, incertains, servilement scolaires. Ne comprenant pas le fond, vous singez. Non seulement vous vous abêtissez, mais vous agissez comme tout le monde pour donner le change et l’illusion sociale d’avoir compris. C’est bien ce qui se passe en analyse financière comme en gestion de portefeuille, j’en ai eu l’expérience directe personnellement (voir Les outils de la stratégie boursière, 2007).
Le « benchmark » est par exemple considéré par les directeurs de gestion français comme un garde-fou à surtout ne jamais franchir au-delà d’une étroite fourchette. La simple lecture d’un dictionnaire vous apprend que benchmark signifie en anglais utile le niveau du maçon : il est donc une mesure, pas un carcan ! Un maçon qui pave un trottoir parfaitement horizontal, selon le niveau à bulle, est un mauvais ouvrier doublé d’un imbécile : l’eau va stagner dans les creux. Le trottoir doit être en légère pente vers le caniveau pour remplir sa fonction de trottoir, le benchmark sert de référence pour marquer cette pente. Pas en France – où l’on doit obéir : à la hiérarchie qui n’y connais rien, à l’abstraction scolaire du mot anglais mal compris ! Quand on ne comprend pas on imite, quand on n’est pas pénétré de l’esprit on régurgite la leçon mot à mot. « Je mets d’ailleurs au défi n’importe lequel des dirigeants des vingt premières banques européennes d’être capable de comprendre, et accessoirement de faire comprendre à ses administrateurs et actionnaires, ce qui se passe exactement dans ces boites noires de l’industrie financière que sont les départements d’ingénierie financière et de produits dérivés… » p.75. M. Bouton, PDG de la Société générale, l’a illustré à merveille lors de l’affaire Kerviel.
Édouard Tétreau prend le même exemple en analyse avec la « shareholder’s value », maladroitement conçue en français comme « créer de la valeur pour l’actionnaire ». Or on ne « crée » pas de valeur, on en a ou on en hérite, l’entrepreneur ne crée que de la richesse (du flux), pas de la valeur (du stock). L’analyste français, par ce concept mal compris, ne va donc s’intéresser qu’à l’actionnaire, à la distribution de dividendes, au retour sur investissement du portefeuille. Alors que la base de la richesse de l’entreprise, celle qui va permettre qu’elle soit durable et puisse investir pour générer du bénéfice (à répartir ensuite en partie aux actionnaires apporteur de capital), est mesurée par la rentabilité : le retour sur fonds propres en fonction du risque assumé. C’est cela qu’il faut analyser, pas la distribution.
Plus qu’un simple témoignage de ces années stupides, ce livre est une sociologie de l’entre-soi parisien où les gens d’un même milieu, sortis des mêmes écoles avec les mêmes concepts abstraits, baignant dans le même jargon anglo-saxon qu’ils comprennent mal, font du fric en toute bonne conscience en enfumant les clients – qui sont, au total, vous et moi, les assurés comme les retraités. Mais ce qui est vrai de l’analyse financière l’est aussi en d’autres domaines : les médias, l’engouement web, les capteurs solaires, en bref tout ce qui est trop à la mode et qui fait délirer comme, il y a 4 siècles, les bulbes de tulipes !
Édouard Tétreau, Analyste – Au cœur de la folie financière, 2005, Prix des lecteurs du livre d’économie 2005, Grasset, 283 pages, €4.96 (occasion) à 18.34 (neuf)
Son site personnel
L’auteur de cette note a passé plusieurs dizaines d’années dans les banques. Il a écrit ‘Les outils de la stratégie boursière’ (2007) et ‘Gestion de fortune‘ (2009).