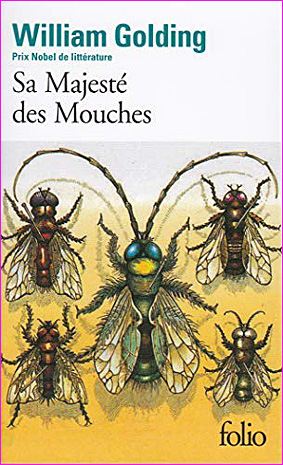
A 43 ans, et après avoir exercé neuf ans comme prof, le prix Nobel de littérature 1983 et chevalier William Golding écrit sur les enfants. Lui-même en aura deux, une fille et un garçon, mais il écrit ici sur les garçons. La discipline et les bonnes manières inculquées au collège ne semblent qu’un vernis que la mise en situation fait vite craquer.
La guerre de Corée vient à peine de se terminer dans le Pacifique sud et c’est peut-être cette situation que décrit l’auteur plutôt qu’une « troisième guerre mondiale ». L’un des enfants fait allusion à des « communistes ». Une bande de garçons de 6 à 12 ans, tous blancs et britanniques, se retrouvent isolés sur une île déserte tropicale, riche en fruits et en cochons sauvages, après le crash de leur avion. Aucun adulte n’a survécu, et probablement d’autres enfants non plus. Mais l’auteur va au plus simple : pas d’épave, aucun blessé, un nombre inconnu d’enfants.
Très vite, deux groupes se forment : les grands et les petits. Les premiers se mettent en bande, les seconds jouent égoïstement dans le sable. Les grands ne les protègent pas et se soucient peu d’eux ; ils ne savent même pas combien ils sont. Un petit, reconnaissable à la tache de vin qu’il a sur la figure, disparaît – personne ne sait où ni quand ; il n’est plus là, c’est tout. Ils reproduisent ce qui se passe dans leur famille où les garçons sont mis en pension dès 9 ou 10 ans alors que les autres restent à la maison.
La première chose que fait un garçon livré à lui-même est de se mettre nu. Ralph, 12 ans de belle carrure, enlève tout d’abord ses chaussures, marcher pieds nus est toujours délicieux. Il quitte ensuite sa chemise, qu’il ne remettra qu’épisodiquement pour protéger sa peau du soleil ou de la fraîcheur de la nuit ; mais elle sera vite une gêne, salie, raidie, déchirée – il finira par s’en débarrasser, comme tous les autres. Pour la culotte, c’est plus incertain : outre le tabou relatif de se balader sexe à l’air, l’organe est sensible aux épines et aux rochers, or le garçon se déchire le derme sur les lianes et les pierres lorsqu’il joue ou chasse. Les grands garderont leur culotte jusqu’à ce qu’elle tombe en lambeaux, tandis que les petits s’en débarrassent très vite pour vivre entièrement nus.
Ralph ne trouve que Piggy (ou Porcinet), un gros à lunettes de son âge qui a de l’asthme. Avec lui l’intello, il se baigne nu dans le lagon avant de se sécher sur le sable. Piggy trouve une conque marine et sait qu’on peut en jouer. Ralph en tire des sons qui attirent les autres enfants autour de lui. Désormais, la conque sera le symbole du pouvoir, de la voix anonyme qui surmonte celle de tous. La tenir à la main donne la parole, telle est la règle.
Inspiré par Robinson Crusoé et par le Robinson suisse, les garçons ont la volonté de construire des cabanes pour se protéger de la pluie et des bêtes, et de faire un grand feu avec beaucoup de fumée pour qu’on les repère du large. Ce qui est entrepris au début avec enthousiasme. Mais l’auteur s’inspire bien plus de Jules Verne et de ses Deux ans de vacances, même s’il ne l’évoque pas. Ralph le blond, qui a une prestance politique qui attire les petits et sait tirer de l’intello impotent Piggy des idées utilisables est, comme le Briant de Verne, pour la démocratie et les règles. Il ne tarde pas à se voir défier par Jack le roux, assez laid et maigre mais musclé, qui est un démagogue né, enthousiaste dès qu’il s’agit d’entraîner la troupe au jeu ou à la chasse. Comme le Doniphan de Verne, chasser et guerroyer est sa grande passion.
S’il garde au début le tabou de tuer, il le transgresse très vite. Le prétexte est de nourrir la bande, mais il y prend goût et n’hésite pas à se barbouiller du sang de ses victimes. Il est le seul à posséder un poignard scout dans une gaine à la ceinture, tandis que Ralph ne possède que les lunettes de Piggy dont les verres permettent d’allumer le feu. Les deux garçons seraient complémentaires, comme dans Jules Verne, s’il n’y avait pas la sauvagerie native de tout être humain. La puissance vitale veut le pouvoir et l’imposer par la force. Ce n’est pas pour rien que Jack se présente au début en chef avec sa troupe de chœur d’enfants alignée, marchant au pas, chacun arborant casquette et cape noire – mais rien dessous. Jack est le démagogue qui va virer fasciste, agitant les symboles, dirigeant les transes et manipulant les superstitions pour assurer son emprise. Il est roux comme Judas, perfide comme le serpent, celui qui sème la zizanie par ses tentations. Il instaure l’offrande au « monstre » de la montagne en fichant une tête de cochon tué sur un bâton épointé aux deux bouts : Sa Majesté des Mouches, autre nom de Belzébuth.
Simon l’intelligent, mais un peu pris de la tête, observera cette sauvagerie et se retrouvera face à face avec Sa Majesté. Une voix intérieure lui dira que le monstre n’est pas dans la montagne mais en lui, en chacun. C’est la sauvagerie de la horde primitive de Freud, celle qui refuse la raison pour socialiser en groupe tribal, hostile à tout étranger. Roger, le second de Jack, prendra sur son exemple un tel goût à tuer qu’il ira tout nu, barbouillé de boue et de sang, l’épieu pointu à la main et l’air terrible. Le masque lui permettra toutes les transgressions. Il se fera même cochon pour miner la chasse dans une danse orgiaque qui fera monter la transe des chasseurs. Il se fera frapper et fouailler, y prenant une sorte de plaisir masochiste, avant de s’effacer dans le cercle et, dans un paroxysme de foule sadique, de lyncher à mort le garçon Simon qui, comme le Christ apportant la « bonne nouvelle », venait apprendre au groupe la vérité : que « le monstre » que tout le monde craignait au point que Jack et Ralph avaient fui devant lui, n’était qu’un parachute tombé sur l’île avec son pilote mort.
Après l’abandon d’un petit, l’assassinat en groupe d’un grand : la civilisation recule. Freud fait des non encore pubères des « pervers » polymorphes, ayant la prédisposition, propre à la plasticité de leur âge, de transgresser par pulsions les tabous sociaux encore mal assimilés pour assouvir un plaisir érogène hors génitalité par le voyeurisme, l’exhibitionnisme, le sadisme. C’est ce qui arrive à Jack, à Roger, aux jumeaux Eric-et-Sam, contraints par la force et les coups à rejoindre la bande de Jack. Si Ralph prend plus de plaisir à se baigner nu et à organiser le maintien d’un feu constant pour attirer les navires, Jack préfère flairer la piste d’un cochon au ras du sol, le traquer en silence et l’éventrer d’un coup d’épieu. Tout cela est jouissance. Les deux garçons participent à la communauté, l’un en prévoyant les secours possibles et en allumant le feu, l’autre en assurant la viande par la chasse.

Mais Jack préfère le jeu au présent plutôt qu’un futur contraignant. Chasser donne plus de plaisir que chercher encore et toujours du bois pour le foyer. De plus, la chasse permet de donner aux autres de la nourriture, tandis que le feu allumé pour les étoiles ne donne rien que d’hypothétique. Très vite, les grands se rallient à Jack par plaisir, instinct grégaire ou contraints. Jack commande un raid sur les cabanes en pleine nuit pour ravir le feu, sous la forme des lunettes de Piggy. Lequel, devenu quasiment aveugle, geint et oblige Ralph à aller parlementer avec les mutins réfugiés dans leur fort de roches. Mais Roger, excité par la cruauté et le goût qu’il a pris de tuer, déloge un gros rocher qui va écraser Piggy. C’est le deuxième assassinat mais, cette fois-ci, perpétué par un individu conscient de ce qu’il fait.
Dès lors, la barbarie submerge l’île. Ralph, désormais tout seul et tout nu, le flanc blessé par l’épieu de Jack, la peau déchirée par les épines, va être traqué sur toute l’île comme un animal – ou comme le Ku Klux Klan chasse encore le nègre dans les années cinquante. Abel le chasseur-tueur veut tuer Caïn, le frugivore détenteur du feu civilisé. Pour débusquer le gibier humain, la bande met le feu à la forêt. Ce qui incite heureusement un cuirassé à venir voir dans l’île – et ses marins sauver Ralph in extremis alors que la bande avait déjà préparé un épieu épointé aux deux bouts pour l’empaler comme un cochon.
On peut se demander ce qui serait advenu si les mois avaient passés sans qu’un navire ne survienne. Ralph empalé et mort sous les tortures, Jack se serait-il approprié son scalp blond pour le porter à la ceinture en guise de cache-sexe et de symbole de puissance, sa culotte ayant rendu l’âme de ses derniers lambeaux ? Cela lui aurait agréablement chatouillé les parties intimes et, la puberté survenant, l’aurait porté à abuser de son pouvoir sur les petits. Il aurait peut-être été supplanté par Roger, plus radical dans la cruauté, donc plus fascinant, qui aurait instauré un régime de terreur.
Cette fable sur la civilisation, qui n’est qu’un vernis sur la sauvagerie primitive, était une leçon de la guerre, du nazisme au stalinisme. Être civilisé, ce n’est pas imposer l’ordre social par la force, mais faire participer chacun au projet commun. C’est dominer ses pulsions, maîtriser ses passions, agiter ses petites cellules grises. L’être humain complet n’est pas que jouisseur, ni que guerrier, ni qu’intello – il est tout à la fois.
William Golding, Sa majesté des Mouches (Lord of The Flies), 1954, Folio junior 1984 – illustrations de Claude Lapointe, 287 pages, €13,00
(mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés Amazon partenaires)
Une autre chronique sur William Golding :

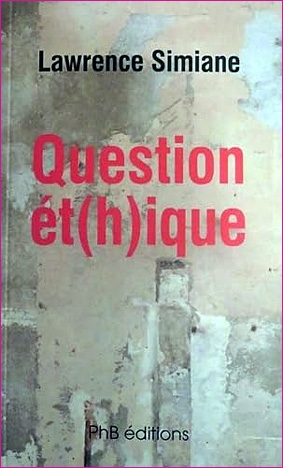


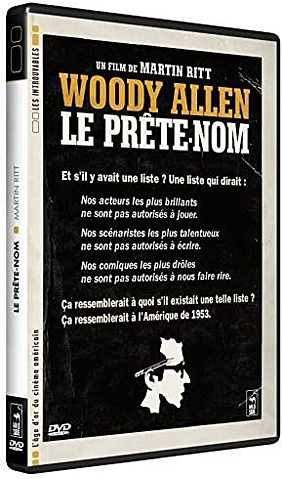




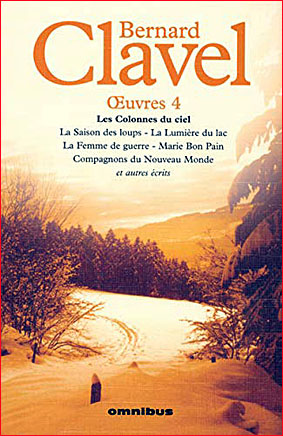
Commentaires récents