Dans le domaine du roman policier, autant les Français ont réussi dans le psychologique, autant les Anglaises dans le sociologique, autant les Américains ont inventé une nouvelle forme : l’efficacité.
Les hommes créent des thrillers, romans montés comme des films et découpés comme au cinéma en séquences courtes remplies d’actions, caractérisées par des caractères tranchés et une grande précision pour faire vrai (horaires, paysages, rues, procédures, crimes, institutions, self-défense – tout est documenté soigneusement). La morale est celle, individualiste, du self-made man, du cow-boy, du pionnier, qui ne compte que sur lui-même et se méfie de l’État. Il n’a, comme base, que les Dix Commandements du moralement correct, encore que la nécessité lui fasse prendre quelques libertés avec le meurtre et l’adultère. Chez Robert Ludlum, Tom Clancy, David Morrell, Clive Cussler, Stéphane Coonts, Frederick Forsyth, Ken Follett, le cadre est le monde et le thème est la guerre.
Les femmes ont investi l’intérieur du pays. Leur thème est la psycho-sociologie, la banlieue moyenne. Patricia Cornwell, Mary Higgins Clark, Lawrence Sanders, Dorothy Uhnak, sont de cette veine. Avec Patricia MacDonald, les suspenses sont bien montés. Le lecteur entre sans peine dans le décor, partage vite la façon de voir les choses du personnage central, qui est une femme. L’intrigue avance sans temps mort, pas à pas, avant l’apothéose – souvent inattendue.
Sans retour va au-delà du divertissement en évoquant un personnage, le tueur, jusqu’à sa dimension mythique. En 1989, époque où ce roman a été écrit, le Japon semble avoir battu l’Amérique sur beaucoup de plans. Le modèle américain vacille. Dans ce livre, il est incarné superbement par Grayson, un jeune homme de 15 ans. Grayson est flamboyant, il est la réussite en personne, fierté de son père, de son collège, de sa ville – le parfait bon gars américain, le gendre idéal. Il est intelligent, sportif, travailleur. Il baise les plus belles filles, dirige l’équipe de baseball, bûche ses maths, est lauréat de la Chambre de commerce. Grand, blond, musclé, très beau, il est le fils de rêve, le rejeton du Nouveau Monde. Mais voilà, il a les défauts de ses étonnantes qualités : l’égoïsme, l’arrogance, l’amoralité, l’hypocrisie. Tout lui est dû, tout doit s’arranger selon ses désirs. Il se sent d’une espèce supérieure, au-dessus du commun des mortels et des règles qui les régissent, au-dessus des lois et de la morale. Lorsque quelque événement dérape, il ment à la société et séduit ses proches pour arranger les faits à sa manière. Un vrai Yankee au fond, la suite des ans le prouvera… Mais tout comme l’Amérique de Nixon et de Reagan n’est qu’apparence de force et de santé, la beauté de l’adolescent individualiste n’est qu’extérieure : elle est celle du diable.
Patricia MacDonald est Bostonienne, d’une ville–référence pour la bonne société américaine, celle qui établit les conventions. Son personnage de maman est obstiné, scrupuleux, attentif à l’amour. Mais le féminisme est passé par là et cette mère pèse dans sa propre balance ce que les hommes de son entourage lui apportent : la sécurité, le plaisir, la position sociale. Les figures mâles sont rarement positives dans ce livre. Elles sont fragiles et très mêlées : la lâcheté voisine avec la force ou le courage avec la faiblesse. Pour l’auteur, le modèle WASP, blanc, anglo-saxon, protestant est décrépi. Elle préfère valoriser les femmes, les filles, les Noirs – probablement l’essentiel de ses lecteurs qu’il s’agit de caresser dans le sens du poil. Elle a le sens commercial. Le seul garçon un peu aimable est homosexuel mais il périra de trop aimer le diable.
Étonnante thérapie qu’entreprend l’Amérique par ses séries romanesques ou filmées, à la fin du siècle dernier. Plus qu’ailleurs, on peut suivre les états d’âme du pays suivant les thèmes de sa littérature populaire. Ce MacDonald-là est bon pour la santé.
Patricia MacDonald, Sans retour, 1989, Livre de poche 1992, 377 pages, €7.60 e-book Kindle €7.99
Les romans policier de Patricia MacDonald déjà chroniqués sur ce blog https://argoul.com/?s=patricia+macdonald

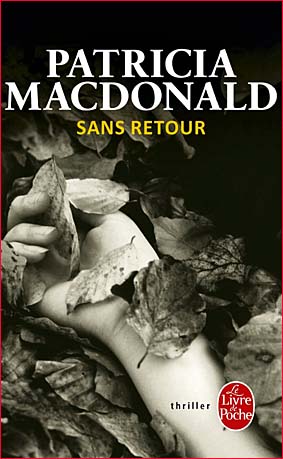
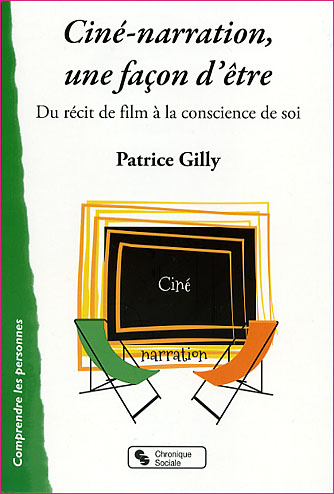
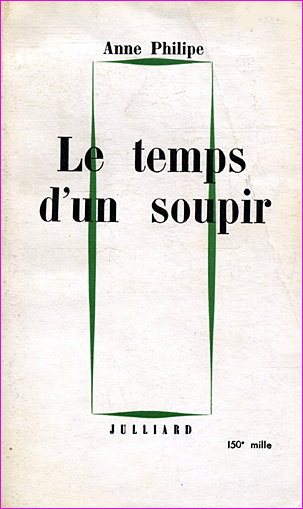






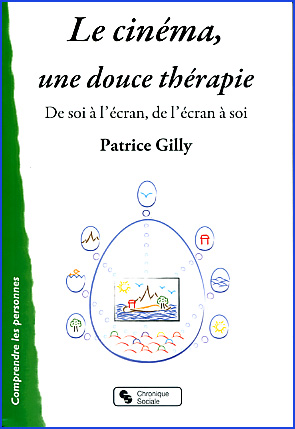

Commentaires récents