La Bretagne, ce n’est pas seulement la mer, c’est aussi la campagne profonde, isolée, autarcique jusqu’au début du 20ème siècle. Près du gros village de Commana dans les monts d’Arrée, un territoire de 12 hectares a été conservé tel qu’il était dans les années 1850. Il s’agit d’un « écomusée ». Cet établissement conserve les rapports techniques de l’homme avec la nature.
 Une rivière détournée, un étang de régulation, et voici un bassin utilisable pour le génie des hommes. Dès le 17ème siècle, une quinzaine de bâtiments sont érigés ici à usage de moulins à farine, de tannerie, de culture d’herbes fourragères, de lavoir, de potager et d’élevage associés à toute habitation humaine avant l’ère moderne. Le tout est restauré, entretenu et exposé avec des explications qui n’ont pas la lourdeur du « pédagogisme » qui sévit trop souvent à l’E.Na (l’éducation nationale quand elle se croit). Ici, tout est simple et direct, ce qui est bien le moins pour des visiteurs dont les arrière-grands-parents étaient, ainsi que 80% des Français, paysans.
Une rivière détournée, un étang de régulation, et voici un bassin utilisable pour le génie des hommes. Dès le 17ème siècle, une quinzaine de bâtiments sont érigés ici à usage de moulins à farine, de tannerie, de culture d’herbes fourragères, de lavoir, de potager et d’élevage associés à toute habitation humaine avant l’ère moderne. Le tout est restauré, entretenu et exposé avec des explications qui n’ont pas la lourdeur du « pédagogisme » qui sévit trop souvent à l’E.Na (l’éducation nationale quand elle se croit). Ici, tout est simple et direct, ce qui est bien le moins pour des visiteurs dont les arrière-grands-parents étaient, ainsi que 80% des Français, paysans.
 J’ai ainsi personnellement connu mon arrière-grand-mère, décédée alors qu’elle abordait presque un siècle révolu. Elle vivait en son grand âge comme elle avait toujours vécu, sur terre battue, tirant l’eau au puits dans la cour, l’électricité n’étant enfin installée que pour les dernières années de sa vie (ah, les vertus de lenteur du Monopole). C’était en une autre région qu’ici, mais les granges de Kerouat sont restées comme dans mon souvenir d’ailleurs.
J’ai ainsi personnellement connu mon arrière-grand-mère, décédée alors qu’elle abordait presque un siècle révolu. Elle vivait en son grand âge comme elle avait toujours vécu, sur terre battue, tirant l’eau au puits dans la cour, l’électricité n’étant enfin installée que pour les dernières années de sa vie (ah, les vertus de lenteur du Monopole). C’était en une autre région qu’ici, mais les granges de Kerouat sont restées comme dans mon souvenir d’ailleurs.
 L’étable et l’écurie n’ont pas changé. La maison à avancée de 1831 (l’époque de Jacquou le Croquant en d’autres lieux) comprend lit clos breton et vaisseliers de bois sombre. L’avancée, qui fait « riche » comme l’étaient nécessairement les meuniers, était l’endroit réservé aux repas, en retrait des lieux de passage. Le sol est dallé car les bovins, contrairement à ce qui était le cas chez mon arrière-grand-mère, ne vivaient pas dans le même bâtiment pour y communiquer leur chaleur. Le saloir en granit, vaste auge chère à saint Nicolas, rappelle que le cochon était un animal déjà fort élevé en Bretagne.
L’étable et l’écurie n’ont pas changé. La maison à avancée de 1831 (l’époque de Jacquou le Croquant en d’autres lieux) comprend lit clos breton et vaisseliers de bois sombre. L’avancée, qui fait « riche » comme l’étaient nécessairement les meuniers, était l’endroit réservé aux repas, en retrait des lieux de passage. Le sol est dallé car les bovins, contrairement à ce qui était le cas chez mon arrière-grand-mère, ne vivaient pas dans le même bâtiment pour y communiquer leur chaleur. Le saloir en granit, vaste auge chère à saint Nicolas, rappelle que le cochon était un animal déjà fort élevé en Bretagne.
 Un judicieux panneau explicatif montre que l’on cultivait volontairement plusieurs essences de bois autour des fermes bretonnes. Chacun était destiné à un usage particulier :
Un judicieux panneau explicatif montre que l’on cultivait volontairement plusieurs essences de bois autour des fermes bretonnes. Chacun était destiné à un usage particulier :
- le frêne faisait de solides manches d’outils ;
- l’orme faisait des charpentes, le plancher des charrettes et ses feuilles étaient un régal pour les cochons ;
- le châtaignier servait de patate à l’automne, d’alimentation porcine l’hiver et son bois était utilisé en menuiserie ;
- l’épine annonçait le printemps quand elle fleurissait et servait à faire des fagots d’allumage pour le feu comme… à étendre le linge ;
- le houx permettait de ramoner la cheminée avant de la décorer pour Noël ;
- l’osier était utile pour faire des liens et tresser des paniers ou des casiers à écrevisses ;
- de même que le saule, dont le bois chauffait en plus parfaitement la poêle à crêpe, donnant des galettes dorées à souhait et point brûlées ;
- pommier, cerisier, poirier, laurier servaient aux alcools et à la cuisine ;
- le camélia blanc fleurissait les mariages et les fêtes religieuses.
On le voit, le « respect » de la nature était surtout un usage intelligent de ce qui poussait « naturellement ». L’homme s’ébattait dans son entour comme un poisson dans l’eau, il l’aménageait imperceptiblement, mais avec l’acquis des millénaires depuis la révolution néolithique. Il « gérait » les alentours de son nid.
 Un autre panneau décrit finement les « cercles d’activités » qui s’étendaient, de façon concentriques, autour des fermes.
Un autre panneau décrit finement les « cercles d’activités » qui s’étendaient, de façon concentriques, autour des fermes.
Le premier cercle, privatif, est celui des bâtiments et dépendances auxquels on accède sans presque se mouiller. C’est le domaine privilégié des petits enfants et de l’activité des mois d’hiver.
 Un second cercle est constitué par l’ensemble des parcelles qui délimitent le village avant les champs cultivés. C’est un enchevêtrement de clos, de vergers, de haies, de chemins, d’aires à battre, de puits, de fontaines, de four à pain, de calvaires. Cet espace est semi-privatif et fait l’objet de droits d’usage bien réglementés. Il protégeait aussi le village des vents dominants et permettait à chacun de faire ses besoins sans trop s’éloigner (eh oui, le tout à l’égout n’existait pas !). C’est aussi le domaine des fleurs « sauvages », qui trouvent dans cette protection un terrain propice (pervenches, primevères, pissenlits, pâquerettes…), et le domaine des oiseaux « familiers » qui trouvent toujours du grain à becqueter été comme hiver tout en protégeant du trop d’insectes et de vers (merles, pinsons, rouges-gorges, chardonneret, fauvette, mésanges, pigeons). Parfois étaient installées les ruches. Ce cercle est aussi celui des vieux qui n’aiment pas s’éloigner trop des habitations.
Un second cercle est constitué par l’ensemble des parcelles qui délimitent le village avant les champs cultivés. C’est un enchevêtrement de clos, de vergers, de haies, de chemins, d’aires à battre, de puits, de fontaines, de four à pain, de calvaires. Cet espace est semi-privatif et fait l’objet de droits d’usage bien réglementés. Il protégeait aussi le village des vents dominants et permettait à chacun de faire ses besoins sans trop s’éloigner (eh oui, le tout à l’égout n’existait pas !). C’est aussi le domaine des fleurs « sauvages », qui trouvent dans cette protection un terrain propice (pervenches, primevères, pissenlits, pâquerettes…), et le domaine des oiseaux « familiers » qui trouvent toujours du grain à becqueter été comme hiver tout en protégeant du trop d’insectes et de vers (merles, pinsons, rouges-gorges, chardonneret, fauvette, mésanges, pigeons). Parfois étaient installées les ruches. Ce cercle est aussi celui des vieux qui n’aiment pas s’éloigner trop des habitations.
 Le troisième cercle est celui des récoltes : champs cultivés, prés au bétail, bois de coupe, taillis, landes. C’était déjà le territoire semi-sauvage, celui où « la main de l’homme mettait à peine le pied », selon l’expression d’un Dupont d’Hergé. Le domaine des adultes et des enfants dès dix ans, laboureurs, bûcherons, bergers.
Le troisième cercle est celui des récoltes : champs cultivés, prés au bétail, bois de coupe, taillis, landes. C’était déjà le territoire semi-sauvage, celui où « la main de l’homme mettait à peine le pied », selon l’expression d’un Dupont d’Hergé. Le domaine des adultes et des enfants dès dix ans, laboureurs, bûcherons, bergers.
 Voici donc une culture ancrée dans l’histoire et présentée de façon attrayante, double rareté digne d’être observée. Les moulins de Kerouat ne sont plus aujourd’hui habités ni utilisés, il s’agit donc d’un « spectacle » mais, à l’inverse de Disneyland et équivalents, ce lieu n’est pas une reconstitution en chambre ni la mythification d’un âge d’or. Il a la vérité de son passé, il est un beau musée de plein air pour expliquer la campagne aux ignorants des villes. De la culture qui enrichit l’âme – que l’on me pardonnera de préférer à celle, éphémère et m’as-tu-vu, des histrions.
Voici donc une culture ancrée dans l’histoire et présentée de façon attrayante, double rareté digne d’être observée. Les moulins de Kerouat ne sont plus aujourd’hui habités ni utilisés, il s’agit donc d’un « spectacle » mais, à l’inverse de Disneyland et équivalents, ce lieu n’est pas une reconstitution en chambre ni la mythification d’un âge d’or. Il a la vérité de son passé, il est un beau musée de plein air pour expliquer la campagne aux ignorants des villes. De la culture qui enrichit l’âme – que l’on me pardonnera de préférer à celle, éphémère et m’as-tu-vu, des histrions.














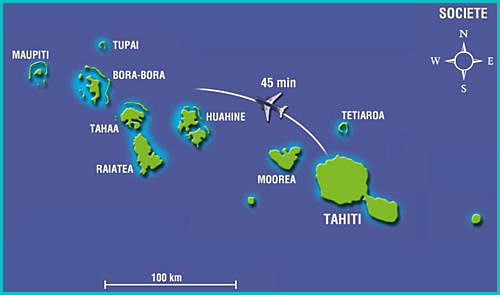






















Commentaires récents