Wow, I love this book ! Je m’y reconnais dans la façon de voir le monde, je me sens bien avec le tempérament de son auteur. En deux voyages de 67 et 65 jours en solitaire vers le grand nord des mers libres, Roger Taylor, 64 ans, par ailleurs homme d’affaires parlant plusieurs langues, expérimente avec délices the tonic of wilderness, la salubrité des étendues sauvages – vierges. Il me rappelle Bernard Moitessier, le hippie contemplatif de La Longue route, mais en moins immature et de solide qualité anglaise.
Solitaire mais pas introverti, seul sur la mer mais attentif à toute vie, il médite sur les origines et sur les fins, se disant par exemple que les éléments sont complètement indifférents au vivant, que la nature poursuit obstinément son processus sans dessein et, qu’au fond, les terres sont une anomalie et l’océan la norme – à l’échelle géologique.
Le premier périple, intitulé Tempêtes, sillonne presque la route des Vikings, ralliant Plymouth à la Terre de Baffin, qu’il ne parviendra pas à joindre. En effet, à 165 milles du Cap Desolation au sud-ouest du Groenland, au bout de 34 jours de mer sur son bateau de 6m50 sans moteur, gréé de voiles à panneaux comme les jonques afin de pouvoir le manœuvrer seul et simplement sans beaucoup sortir, l’auteur se casse une côte dans un coup de mer et décide de virer de bord pour rentrer à bon port.
Ce n’est pas sans avoir vécu intensément les mouvements et le chatoiement des vagues, écouté la plainte du vent et, plus rarement, le chant des baleines, observé les milliers d’oiseaux qui cherchent leur pitance et se jouent des masses d’air, joui des lumières sans cesse changeantes du ciel et de la mer. C’est ce récit d’observations méditatives qui fait le sel de ce livre – un grand livre de marin. Tout ce qui occupe en général les récits de voyage, ces détails minutieux de la préparation, des réparations et des opérations, est ici réduit à sa plus simple expression. En revanche, l’auteur est ouvert à tout ce qui survient, pétrel cul blanc ou albatros à sourcils noirs (rarissime à ces latitudes), requins, dauphins, rorquals, ondes concentriques des gouttes de pluie sur une mer d’huile ou crêtes échevelées d’embruns aussi aigus que des dents. « Plus on regarde, plus on voit » (p.42), dit ce marin à l’opposé des hommes pressés que la civilisation produit.
Il est sensible à cette force qui va, sans autre but qu’elle-même, de la vague et du vent, des masses d’eau emportées de courants, des masses d’airs perturbées de pressions. « Cette bourrasque (…) est arrivée sans retenue, toute neuve et gonflée d’une splendide joie de vivre » p.98 – les derniers mots en français dans le texte. Il va jusqu’à noter sur une portée musicale, dans son carnet de bord p.134, la tonalité de son murmure incessant. « La mer était formée de vagues qui se développaient sur des vagues qui s’étaient elles-mêmes développées sur des vagues », dit-il encore p.101. Et à attraper l’œil du peintre : « Les innombrables jeux de lumière, créés par la diffraction et par l’agitation liquide, se diffusaient dans une infinité de bulles minuscules, de mousse et d’air momentanément emprisonné, et ils rendaient la mer d’un vert presque blanc, d’un vert émeraude et parfois, c’était le plus beau, d’un vert glacé translucide » p.123.
4100 milles plus tard, il boucle la boucle, de retour à Plymouth. De quoi passer l’hiver à réparer, améliorer et songer à un nouveau voyage.
C’est le propos de Montagnes de nous emporter vers le Spitzberg depuis le nord de l’Écosse, via l’île Jan Mayen. Le lecteur peut se croire chez Jules Verne, grand marin lui aussi, amoureux de la liberté du grand large en son siècle conquis par la machine. Roger Taylor vise les 80° de latitude Nord, aux confins d’un doigt étiré que le Gulf Stream parvient à enfoncer dans les glaces polaires envahissantes. « La fin de l’eau libre au bout de la terre », traduit-il p.153. Il retrouve avec bonheur « la délicieuse solitude du navigateur solitaire, une solitude ouverte, accueillante, qui devient en elle-même la meilleure des compagnes » p.185. D’autant qu’il n’est pas seul : toute une bande de dauphins pilotes fonceurs, un troupeau placide de baleines à bosse, un puissant rorqual boréal, puis le ballet des sternes arctiques, labbes pomarin charnus, mouettes tridactyles, guillemots de Brünnich – et même une bergeronnette égarée qui va mourir – peuplent de vie l’univers pélagique.
La liberté est une libération. « Ce changement commence par l’effacement progressif du personnage terrien : non pas la perte de soi, mais de la partie de soi qui est construite par besoin social et par besoin d’image (…) largement artificielle » p.219. Roger Taylor retrouve la poésie en chacun, ce sentiment océanique d’être une partie du Tout, en phase avec le mouvement du monde. « Le poète est le berger de l’Être », disait opportunément le Philosophe, que les happy few reconnaîtront.
Les 80° N sont atteints après 31 jours et 19 heures. C’est le retour qui prendra plus de temps, jusqu’à la frayeur ultime, au moment de rentrer au port. Un bateau sans moteur est sous la dépendance des vents, et viser l’étroite passe quand le vent est contraire et souffle en tempête, c’est risquer sa vie autant que dans une voiture de course lancée sur un circuit sous la pluie. Intuition ? Décision ? Chance ? L’auteur arrive à bon port deux heures avant que ne se déclenche le vrai gros mauvais temps !
Lors d’une nuit arctique illuminée du soleil de minuit, alors qu’à l’horizon arrière s’effacent les derniers pics du Spitzberg, l’auteur a éprouvé comme une extase : « Oui, pendant ces quelques heures d’immobilité, j’ai vu la planète, ce qui occupe sa surface et le grand espace de l’espace, nettoyés à blanc : la mer, l’air, la roche et l’animal, immaculés et élémentaires, éclatants et terribles » p.257. Lisez l’expérience de « l’homme qui a vu la planète », cela vaut tous les traités plus ou moins filandreux d’écologie !
Roger Taylor, Mingming au rythme de la houle (Mingming and the tonic of wildness), 2012, éditions La Découvrance 2015, 308 pages, €21.00
Roger Taylor est aussi l’auteur précédent de Voyage d’un simple marin (La Découvrance 2013) et de Mingming et la navigation minimaliste (La Découvrance 2013)
- Éditions La Découvrance, La Rochelle – attachée de presse Guilaine Depis – 06.84.36.31.85 guilaine_depis@yahoo.com
- Les photos sont de l’auteur, sauf la dernière.
- Le site de l’’auteur avec photos, vidéos et même compositions musicales (site en anglais, la page francophone est « not found »)






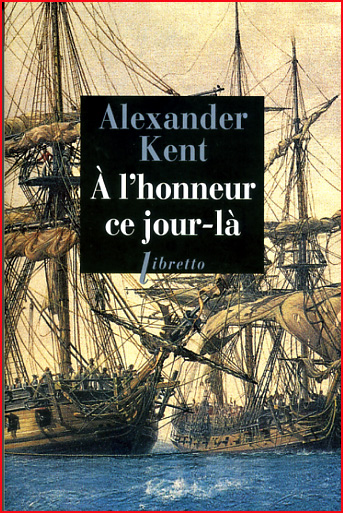



Commentaires récents