
Quatre personnages, quatre métiers solistes, quatre mouvements, appelés à jouer de concert comme dans un ensemble musical. Éloïse (déjà rencontrée avec son musicien dans Un être libre – chroniqué sur ce blog) est chef économiste d’une Institution ; Alphonse est violoncelliste reconnu ; Chloé est une journaliste d’investigation aux dents longues dans l’audiovisuel ; James, fils d’Éloïse, est journaliste à réseau d’un grand journal de presse écrite. Le thème ? La corruption dans les instances d’une institution internationale, des subventions publiques détournées à des fins privées car sous les montants surveillés.
Chacun sa vie, son âge, son ambition. Éloïse, passée de l’université au privé, rêve d’écrire un livre d’économie original ; Alphonse de jouer enfin aux États-Unis dans les orchestres bien nantis à la reconnaissance assurée ; Chloé de se faire une place à la télévision avec une émission percutante et étayée ; James d’assurer son couple avec ladite Chloé. L’Affaire, révélée par un lanceur d’alerte à Chloé, prend de l’ampleur. Chacun l’aide comme il peut pour qu’enfin tout cela finisse, car des menaces sont proférées, des agressions physiques pour voler des documents, une atmosphère de paranoïa sur les données.
L’art de l’auteur est de procéder dans le cadre contraignant du quatuor musical, adagio (tempo lent et détendu), andante (tempo modérément rapide), allegretto (tempo très vif, accéléré), grave (tempo lent, solennel, lourd). Cela l’oblige aux phrases courtes qui donnent un style haletant, aux découpages de scènes simultanées comme dans un thriller. Le mouvement s’accélère, jusqu’au finale qui tombe, comme un destin.
Le dernier tempo est inspiré par le Quatuor à cordes n°16 de Beethoven, sa dernière œuvre opus 135 intitulée « Der schwergefasste Entschluss » (La résolution difficilement prise). L’auteur conseille p.28 l’application de streaming Qobuz pour l’écouter « en haute-fidélité » – c’est toujours intéressant à apprendre. Le dernier mouvement porte une inscription en épigraphe de la main du compositeur : « Muß es sein? Es muß sein! », citée en tête du livre. La traduction courante est « Le faut-il ? Il le faut ! » – mais l’allemand mussen en appelle à la nécessité, au destin : « Cela doit-il être ? Cela doit être ! ». Ce qui a de la valeur contre ce qui reste léger : au fond, n’est-ce pas la leçon de vie de l’œuvre ? Chaque personnage recherche ce qui vaut le plus pour lui, au-delà du superficiel de son existence. Au-delà des tentations de la facilité aussi, des entorses à l’éthique de la profession, de la protection du couple toujours fragile.
Les caractères sont bien déterminés, complémentaires, les personnages crédibles. Le lecteur entre aisément dans chacun des métiers, dont on dirait que l’auteur a personnellement l’expérience. C’est documenté et bien mené, dans la lignée d’Alain Schmoll, chroniqué sur ce blog. En bref un thriller économico-social captivant dans la France d’aujourd’hui, ouverte sur le monde. Avec des remarques incisives sur l’air du temps.
Jean-Jacques Dayries, Quatuor, 2024, éditions Regard – Groupe éditorial Philippe Liénard, 151 pages, €21,50
(mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés Amazon partenaire)
Attachée de presse BALUSTRADE : Guilaine Depis, 06 84 36 31 85 guilaine_depis@yahoo.com

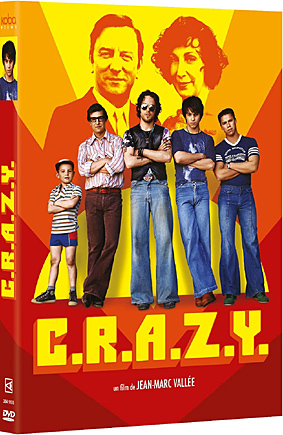

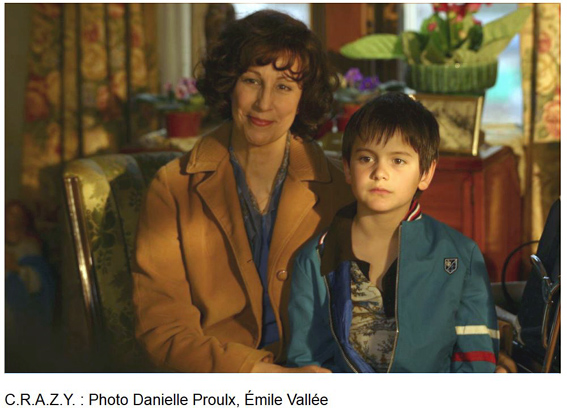




















Commentaires récents