Choisit-on sa famille ? Non – pire encore lorsque l’on est unique enfant. Pascal porte un prénom juif alors que son père est hystériquement antisémite. Pourquoi ? Bruckner serait-il un nom juif ? Pourtant, Anton Bruckner, musicien et compositeur autrichien n’est en rien juif. Sur le tard, le fils découvrira le père circoncis, mais peut-être pour raisons médicales… Le mystère reste entier. Cette haine hystérique du Juif par le père a cependant façonné l’enfance et l’existence du fils, qui n’a été « bon » que parce qu’il n’a jamais rompu totalement avec le père.
Le macho engueule sa femme, se mettant dans des colères orchestrées qui montent et le transforment en bête. Les années 40 et 50 avaient poussé au sommet l’autoritarisme mâle issu de la guerre et, plus avant, du traumatisme de la guerre de 14. Ingénieur des mines mais resté très petit bourgeois, intelligent mais haineux, le père René est fort avec les faibles et faible avec les forts. Ce que le gamin ressent, la terreur de l’ogre, l’adolescent comprend, la lâcheté du gueulard.
Heureusement, mai 68 vint… Né en 1948, Pascal Bruckner a donc vingt ans en 1968. S’il a été « déluré à huit ans », surpris la tête enfouie entre les cuisses de sa cousine, il n’a été dépucelé qu’à « dix-huit ans », par une fille de seize en camp de vacances non mixte. Entre temps, élevé chez les Jésuites, il a branlé ses camarades et réciproquement, consentant aussi aux offrandes de bouche des plus grands – dit-il – « l’hostie spermatique ». Mais que les professionnels du choqué ne fassent pas de crise cardiaque : « Des millions d’adolescents, aujourd’hui encore, entrent dans la carrière amoureuse par ce biais et l’effacent ensuite de leur mémoire. A cet âge, il convient de se dévergonder à outrance et par tous les moyens : la pulsion l’emporte sur l’objet, la libido est un fleuve en crue » p.99. De quoi rassurer les parents, s’ils ne comprennent pas leurs garçons parce qu’eux-mêmes sont névrosés à cause du sexe. Ce n’est pas parce que l’on a des comportements homoérotiques entre 10 et 16 ans que l’on devient pédé à jamais. Pascal Bruckner a eu deux enfants, un garçon tôt vers 20 ans, et une fille plus tard vers 45 ans. Il aime les femmes et célèbre la beauté dans toutes ses œuvres. C’était « avant », dans la société catholique patriarcale non mixte, que le sexe était considéré comme sale et, « avant » la pilule ou l’avortement que l’acte sexuel conduisait à la déchéance de la grossesse non désirée, de la fille-mère et de la bâtardise… Non, il faut le réaffirmer contre les mythes, ce n’était pas « mieux avant » !
Bruckner est de cette génération passée du XIXe au XXIe siècle en quelques dizaines d’années, sans intermédiaire. « Dans l’espace d’une seule vie, nous aurons connu les derniers soubresauts de l’ordre patriarcal, la libération des mœurs et des femmes, la chute du communisme, l’effondrement du tiers-mondisme et maintenant celui de l’Europe, mourant de son triomphe, de sa mauvaise conscience » p.97. Enfant il a connu les punitions corporelles de la gifle et du martinet ; jeune adulte, l’interdit d’interdire et le sexe à toutes les sauces. D’un extrême l’autre… Il en garde un scepticisme envers tous les dogmes, ni l’avenir radieux ni le c’était mieux avant ne l’ont convaincu – pour les avoir subis. Ce pourquoi il n’en veut pas à son père d’avoir été ce qu’il fut, seulement de ne pas avoir fait l’effort de reconnaître ses erreurs.
Car la colère peut être saine – si elle remet en cause les inerties ; l’indignation morale est utile – si elle débouche sur des initiatives concrètes ; la critique déconstructive est nécessaire – si elle permet de reconstruire sans être dupe. « Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort », soulignait Nietzsche.
Son amitié, un temps quasi fusionnelle, avec Alain Finkielkraut, lui a permis d’avancer. L’un a réussi Normale sup, pas l’autre ; l’un a enseigné par devoir, l’autre par hasard ; mais tous deux ont écrit des livres, certains à deux. Qui ont plu par leur ton. Comment ne pas être provocateur et un brin cynique lorsqu’on a été élevé par un bon Aryen aussi bon à rien ? Germanophone enfant, par force, Pascal est devenu anglophone par choix ; s’il a subi la « grande » musique petit, il a choisi Aretha Franklin et le « gospel, blues, jazz, soul, funk » (p.98) plus tard. S’il a cru en Dieu au point de lui demander de tuer son père à dix ans, il est devenu agnostique, mais de culture chrétienne, se réveillant chaque matin avec du Bach pour célébrer l’avenir. « Rien de plus doux qu’une grande religion à son crépuscule quand elle a renoncé à la violence, au prosélytisme, et n’exhale que son message spirituel » p.97.
S’il n’a jamais été communiste, trotskiste ou maoïste, il « a vagabondé quelques années d’une secte gauchisante à une autre » et même au PSU où « Michel Rocard nous enseigna[it] les rudiments de la guérilla urbaine sur une plage de Corse. J’en ris encore de bon cœur ». Au fond, « le gauchisme fut cette ruse de l’histoire qui permit de liquider le communisme dans l’intelligentsia » p.109. Il était « plus Charles Fourier que Lénine »… Il reste dans le camp du progressisme « malgré l’épaisse bêtise et la bonne conscience qui y règnent ». Ses « grands éveilleurs » furent Sartre, malheureusement vite tombé dans le gâtisme par avidité à se faire aimer, Jankélévitch avec qui il fit sa maîtrise de philo, et Barthes avec qui il soutint sa thèse sur l’émancipation sexuelle chez Fourier.
Pascal Bruckner a su construire une œuvre : ses deux enfants Éric et Anna, dédicaces de ce livre autobiographique écrit à 66 ans, ses multiples romans et essais récapitulés en fin d’ouvrage : sur le sanglot de l’homme blanc, la mélancolie démocratique, l’amour du prochain, l’euphorie perpétuelle, le fanatisme de l’Apocalypse, la misère de la prospérité, le paradoxe amoureux, la tentation de l’innocence, la tyrannie de la pénitence, les voleurs de beauté… Tous ces poncifs de la génération bobo, gaucho, écolo dont il est, dont il sait se sortir pour voir plus loin.
Ce livre court, écrit magnifiquement, avec ce ton reposé d’après la mort du père, dit en trois parties ce que fut cette vie : le détestable et le merveilleux de l’enfance, l’échappée belle parisienne de la jeunesse, le pour solde de tout compte adulte. On ne dira jamais assez la vertu de l’éducation classique, celle d’avant-68, sur le style et sur la pensée. Ce qui se conçoit bien s’énonce clairement. Pas de fioritures ni de préciosités mais la langue française dans sa clarté et les idées dans ses Lumières. Le récit se lit avec bonheur, le lecteur est captivé et ne ressort pas indemne de ces confessions d’un enfant du siècle.
Pascal Bruckner, Un bon fils, 2014, Livre de poche 2015, 207 pages, €6.60
e-book format Kindle, €6.99



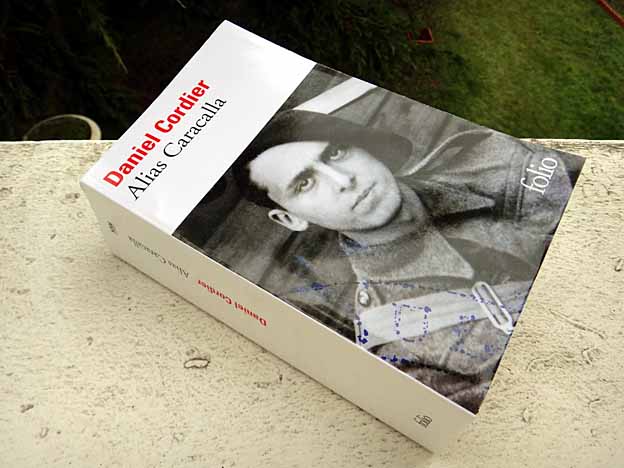






Commentaires récents