
L’auteur, prof d’anglais après un bac 68, s’est mis à l’élaboration de thrillers soigneusement documentés. Il a obtenu le Grand prix de littérature policière 1986 pour La Queue du scorpion. A désormais 72 ans, il ne semble plus écrire, son dernier opus date de 2008.
Il semble obsédé dans ses œuvres par les pédophiles et Les yeux du soupçon n’échappent pas à ce travers, comme s’il voulait exorciser quelques fantasmes sadiques de la société. S’il choisit à chaque roman une ville, il s’agit ici de San Francisco et le lecteur saura tout sur cette ville mythique, saisie au tournant du siècle. Mais le principal de ce policier de frissons où l’action se mêle assez bien à la psychologie est le portrait de « LA » conne américaine.
Il s’agit d’un idéal-type que l’on retrouve souvent dans les romans policiers yankees, notamment chez Mary Higgins Clark, mais que Christian Gernigon utilise ici à la perfection. Mary est en effet une « conne » : niaise, paniquée, séduite par les apparences, croyant à l’Hâmour à l’eau de rose Disney, genre pétasse qu’un prince charmant viendrait dénicher pour en faire la Femme de sa vie.
Mary a connu son mari David, prof en collège, massacré avec quelques élèves par un serial killer adolescent, frustré d’être nul et détesté sans que nul ne s’en préoccupe. L’égoïsme forcené américain valorise la compétition à outrance, pas seulement virile, et méprise les loosers. Avec la vente libre d’armes et les trafics possibles, pas étonnant à ce qu’il y ait autant de massacres de masse aux Etats-Unis. Le fric et le droit du plus fort importent plus que la vie humaine et la solidarité.
Un an s’est à peine passé après sa mort que Mary, flanquée de sa fillette de 6 ans Kelly (un prénom niais), tombe raide dingue d’un client à la quarantaine portant beau, venu consulter dans sa compagnie d’assurances. Aussi sec, sans même n’avoir baisé ni ne l’avoir questionné ou s’être tout simplement renseignée sur son métier et ses collègues, elle consent à se marier tout de suite, à Las Vegas en 24 h comme il est possible de le faire dans ce pays qui produit des tarés en série. Le « mariage » est en effet le fantasme social de base plutôt que la simple vie à deux. Un mariage à la Daech, vite prononcé à la chaîne par un imam protestant devant lequel les couples font la queue.
La conne américaine emménage donc avec son beau mari tout récent et il s’empresse de l’obliger – sans discussion – à démissionner de son emploi et à laisser tomber ses amies, selon le même schéma que le roman de Mary Higgins Clark publié en 1982, Un cri dans la nuit. Croyez-vous que cela lui aurait mis la puce à l’oreille ? Pas du tout ! L’illettrée ne l’a pas lu. Elle se dépêche de trouver mille excuses à ce comportement machiste et un brin paranoïaque, en rêvant de « la belle maison » (autre fantasme social de midinette) et de « la fortune » que son mari Peter est supposé avoir.
Sauf que le récit qu’il fait de son enfance malheureuse aurait dû la faire tiquer. Il n’en est évidemment rien, preuve que non seulement elle se complait aux fantasmes, mais qu’elle est en sus bête à pleurer. Son père dans l’armée a tué sa mère et Peter a été recueilli et élevé par son grand-père pasteur qui l’a élevé avec rigorisme ; une fois adulte, son épouse et sa fillette ont été massacrées à coups de marteau par un inconnu, Peter se trouvant soigneusement à distance pour qu’on ne puisse le soupçonner. Curieusement, il avait souscrit un fort contrat sur la vie au dernier survivant – et hérite donc de pas moins d’un million de dollars. De quoi voir venir et jouer au day trading.
Car la conne américaine, avec son petit diplôme de comptable et son boulot dans les assurances, ne s’est même pas préoccupée de savoir pourquoi son nouveau mari lui affirmait être gérant de portefeuilles boursier « chez Deloitte et Touche » alors que cette société n’a jamais géré aucun portefeuille boursier, ni fait de trading. Le site internet mentionne « Audit & Assurance, Consulting, Financial Advisory, Risk Advisory, et Juridique et Fiscal ». Mais croyez-vous que la future mariée, engagée à vie devant Dieu et devant les hommes, se soit préoccupée d’aller voir sur Internet ?
Son ami Mark, chargé d’enquêtes pour la compagnie d’assurance Briggs, dans laquelle ils travaillent tous les deux, a bien montré qu’un client douteux avait vu son épouse assassinée après un contrat sur la vie de 600 000 $ qu’il compte bien toucher, rien n’y a fait. Mary n’a pas effectué le rapprochement – pourtant évident – avec son propre cas.
Mark, aidé de son ami et collègue Willy, va démontrer que le mari a tué sa femme, terrorisé ses deux fils de 8 et 6 ans pour qu’ils la ferment et lui donnent un alibi, qu’il a été renvoyé de plusieurs métiers en rapport avec les enfants parce qu’il avait tendance à les faire mettre nus pour jouer au basket ou à la lutte. Peter ne semble pas atteint de cette perversité avec Kelly, mais…
Tout se résoudra dans le sang et la fureur, comme de bien entendu, non sans le venin dans la queue. Mark lui-même, qui aime Mary et voudrait bien l’épouser, a vu à l’âge de 10 ans son père fuir le domicile conjugal parce qu’il s’était découvert homo, et sa mère se suicider en essayant de l’entraîner avec elle. Il garde soigneusement le Colt .38 qui a servi et qui, curieusement, est le modèle par lequel son père a été tué au sortir d’une boite gay quelques années après.
La conne américaine va-t-elle répéter son schéma névrotique avec Mark comme avec Peter et David ?
Un bon thriller qui vous donne le portrait de la bêtise, côté US.
Christian Gernigon, Les yeux du soupçon, 2001, Livre de poche 2003, 383 pages, occasion €0.90, e-book Kindle €6.99


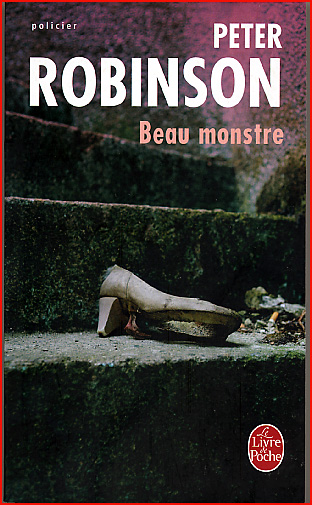


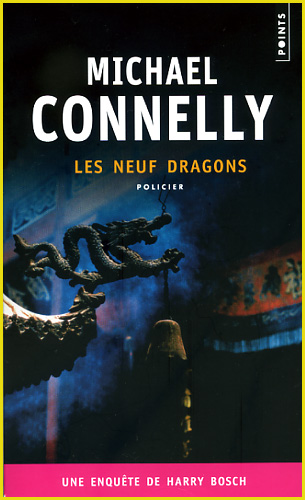
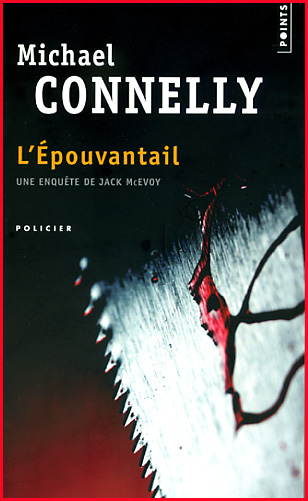
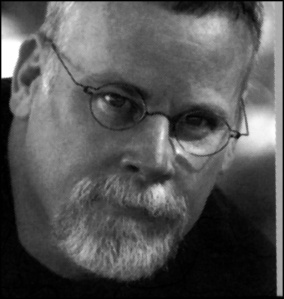
Commentaires récents