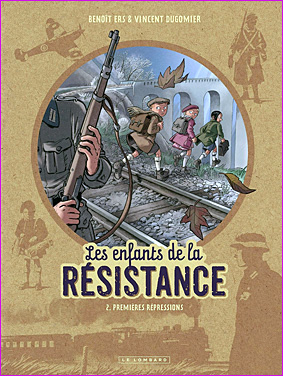
Dans un village de l’est français, l’Occupation nazie incite François, Eusèbe et Lisa, des gamins de 13 ans (« presque 14 ») à se rebeller contre cet état de soumission. Le vieux maréchal encourage la collaboration, mais la fierté républicaine enseignée par l’école résiste. Dans le premier tome (chroniqué sur ce blog le 16 octobre), les gamins ont saboté l’écluse, ce qui a permis de retarder le transport des métaux vers l’Allemagne, vitaux pour son industrie d’armement. Aujourd’hui, les Boches se méfient et il faut être plus subtil.

Comment l’être sans entraîner les adultes ? La venue d’un prisonnier français évadé d’un camp allemand en est le prétexte. Les parents d’Eusèbe le recueillent, malgré les risques. Ils se mettent en relation avec le maire, le curé et les parents de François. Puis un deuxième, qui dort dans un champ, est informé par un message écrit sur du papier peint par les gamins que l’école l’accueillera. C’est le début d’une filière d’évasion vers la zone sud non occupée, plus tard vers l’Angleterre. Ce qui fait le lien ? Le « Lynx », le trio des 13 ans, incognito, qui galvanise les adultes.
Lesquels osent enfin prendre des risques à résister, en aidant un tirailleur sénégalais évadé à s’en sortir. Irruption des Noirs dans la Seconde guerre mondiale, fraternité républicaine, antiracisme affirmé contre le racisme nazi. Il n’y a pas de sous-race, il n’y a que des combattants ; il n’y a pas d’hommes supérieurs, il n’y a que des humains libres.

Mais les Boches se défendent, forts de leurs armes et de leurs blindages – sinon de leur idéologie, guère partagée chez les hommes de troupe. En arrêtant un train sanitaire pour y planquer le tirailleur noir, les résistants se font tirer comme des lapins. Le père d’Eusèbe, blessé, est arrêté, torturé et fusillé. Son fils a le temps de lui dire que « Lynx », c’est lui et ses copains ; le papa est très fier de lui et meurt content. Ce sont ces petits grains de sable isolés qui vont s’agglomérer avec l’espoir de la Libération. La machine nazie n’a qu’à bien se tenir. Jamais la force brute ne peut l’emporter contre la ruse et la volonté – Ulysse le Grec nous l’a déjà appris.
Jolis dessins, gamins plein de vie, gravité de la situation – qui rappelle que la guerre n’est pas toujours hors de chez nous, et que résister vaut mieux que sempiternellement « commémorer ». Une morale optimiste et orientée vers la liberté républicaine, qui réconforte en ces temps de régurgitation fasciste, de Trump à Poutine, Orban, Ciotti et Bardela. Un dossier en fin de volume instruit sur la guerre en ces temps d’Occupation.
Benoît Ers et Vincent Dugommier, Les enfants de la Résistance 2 – Premières répressions, 2016, éditions du Lombard, 56 pages, €13,45, e-book Kindle €5,99
(mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés par amazon.fr)

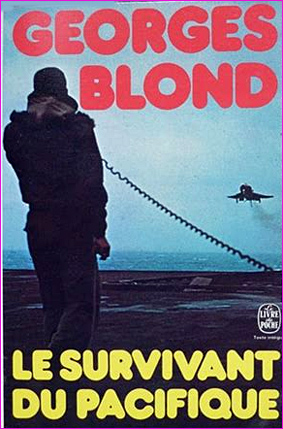
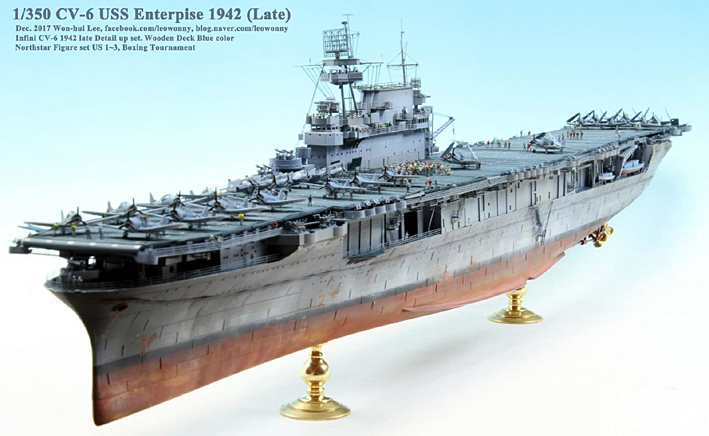
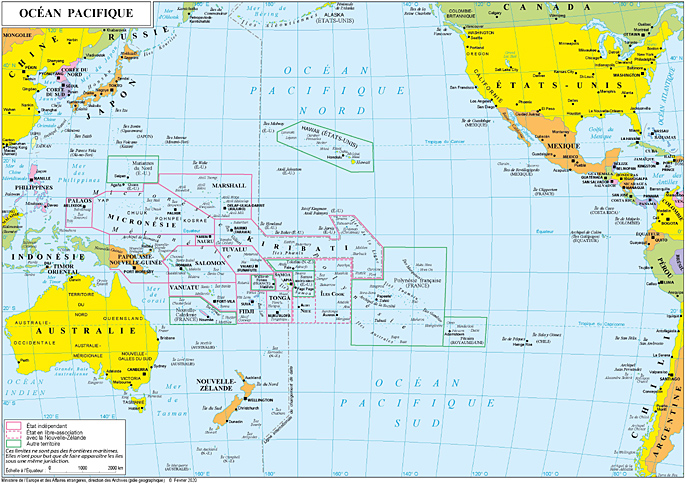
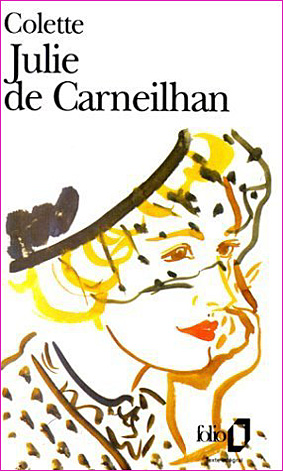
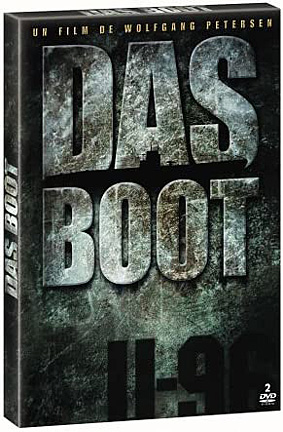



























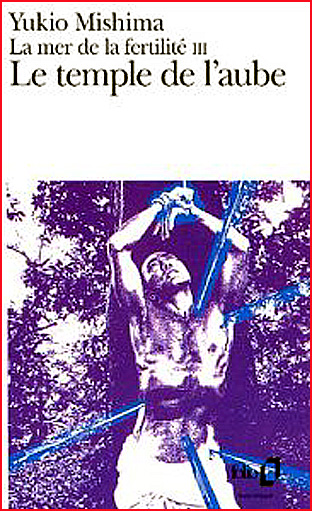



Commentaires récents