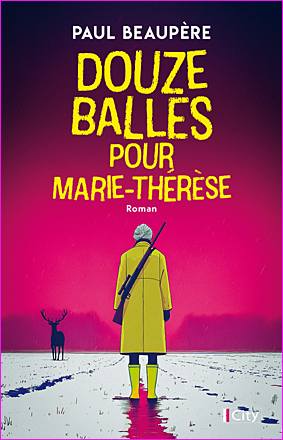
Le portrait du personnage est tracé d’emblée : « À soixante-dix ans, dont cinquante dans la forêt, Marie-Thérèse, fille d’un chasseur alpin, tireuse d’élite à ses heures perdues et veuve d’un artilleur, avait la balistique dans le sang » p.8. Un matin, dans la forêt des Vosges où elle traque le beau cerf dix-huit cors, elle trouve dans sa lunette la tronche en rut de Raoul le maboul, le violeur en série, en pleine action sur une jeunette « sidérée » au prénom alliant soleil et ange. Elle lui explose la tronche.
Le commissaire Abel Berg, au nom en euphonie avec le trop célèbre Adamsberg de Fred Vargas, un vieux cynique un peu tordu, comme lui, vient aux nouvelles. Il sait que la tireuse l’a fait, et il pourrait convoquer la balistique, faire analyser les fibres de l’écharpe qui s’est appuyée sur l’arbre d’où est parti le tir mortel, mais il a une autre idée en tête. A 60 ans, il en a marre de voir les mauvais s’échapper. « Voilà une liste. Les noms de ceux que j’ai poursuivis et qui, bien que coupables, ont échappé à la justice. Il y a là-dedans douze salopards qui méritent chacun une balle. Douze balles. Avec votre fusil, vous allez devenir mon bras armé et nous allons les éliminer, un par un » p.20. Le décor est planté.
Ma-Thé hésite, c’est pas moral – mais les douze salopards, dont deux femelles, ont vraiment fait des horreurs, tout en passant habilement entre les gouttes. Elle ne sait pas faire – mais Berg lui chante qu’il s’occupe de tout, tout sera prévu ; elle n’a qu’à exécuter. Elle se demande si les criminels qu’elle va abattre le méritent aux yeux de Dieu : ne sont-il pas autant fils de Dieu que fils de pute ? – mais Dieu lui répond, en la personne d’un prêtre qui ferme son église : « quoi que vous fassiez d’ici-là, Dieu sera content de vous retrouver ». D’ailleurs, la société tout entière est devenue brutale, individualiste, fanatique dans ses convictions : A Paris, par exemple, « des hordes de cyclistes cuissardés comme des amazones et casqués comme des Boches chargeaient plus violemment que des sangliers » p.66.
Donc, tous scrupules envolés, la traque commence : une par mois. Le premier est Novembre, la tête « d’un porc qui se prend pour un lion ». Il va bouffer du béton. Ni vu, ni connu. Le crime parfait, devant témoins… Sauf qu’elle a laissé des traces comme s’il en pleuvait. Heureusement qu’il n’y a pas eu d’enquête. Pour les suivants, c’est moins sûr.
Un roman passionnant, bougonnant, picolant, aux personnages attachants – et malheureusement clopant – et pour un tueur, c’est mortel. « Fumer, c’est une signature », est-il énoncé p.276. Mais on rit chez Beaupère : « Fallait quand même être un crétin de citadin pour penser que le paradis est un endroit où le lapin se fait niquer par le renard et où la fouine te zigouille de l’oisillon au kilomètre, songeait Marie-Thérèse. Y croient quoi, ces journaleux, que le dimanche matin les hérissons brunchent avec les blaireaux avant d’aller chanter des alléluias bras dessus bras dessous avec les vipères ? Faudrait leur expliquer que le joli rouge-gorge est un salaud qui marave la gueule de son voisin et que le délicieux hamster bouffe la moitié de ses petits pour pas se lever la nuit et faire des biberons par douzaines » p.13. Ou encore : « elle avait fait une pause à la gare de Brive. Elle y avait pris un café, mauvais, et un sandwich jambon-gruyère qui réussissait l’exploit de n’avoir ni le goût du jambon, ni celui du beurre, pas plus que du fromage ou du pain. L’auteur de ce truc méritait la peine de mort ou un prix Nobel, mais rien entre les deux » p.48 – d’autant, pour le Nobel, qu’elle ne savait pas pas vraiment comment on s’y prend.
 Photo copyright Paul Bertin
Photo copyright Paul Bertin
Auteur versaillais de nombreuses séries jeunesse publiées chez Auzou, Mame et Fleurus, Douze balles pour Marie-Thérèse est son premier roman adulte. Et l’auteur semble ne pas aimer le mot chocolatine, le gâteau au yaourt, les teckels, ni les cyclistes, surtout les bobos qui se la jouent écolo en vélo flemmard « électrique », tout en en profitant pour ne rien respecter : « En rentrant chez lui, le capitaine vit passer deux ou trois vélos, tous grillèrent un feu ou un stop, aucun ne respecta les priorités à droite, mais le flic ne le remarqua même pas tellement c’était habituel, il se demanda juste quelle était désormais leur espérance de vie » p.120.
Car une deuxième série des crimes doublent la première… A Versailles justement, cette fois. On sent comme une revanche. Et ce n’est pas par hasard. Une fin qui s’étire en peu en rebonds incessants, mais c’est passionnant.
Paul Beaupère, 12 balles pour Marie-Thérèse,2025, City éditions, 366 pages, €19,90
(mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés par amazon.fr)
Attachée de presse Emmanuelle Scordel-Anthonioz escordel@hotmail.com

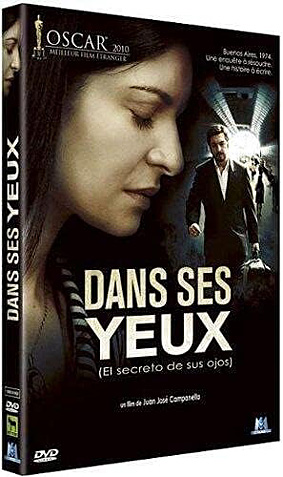








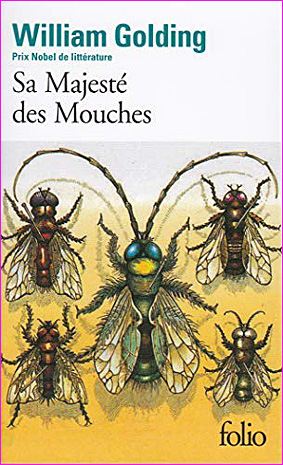

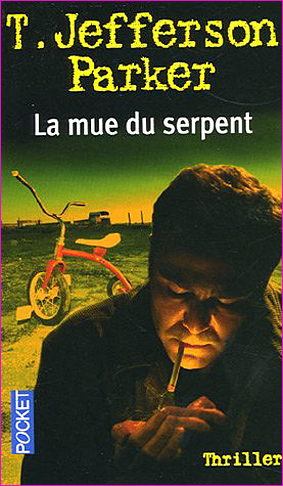






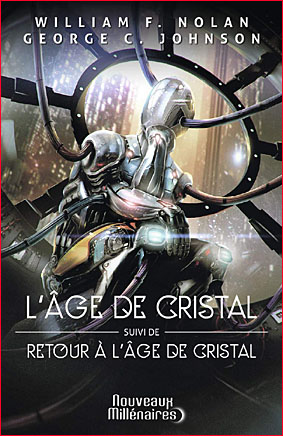




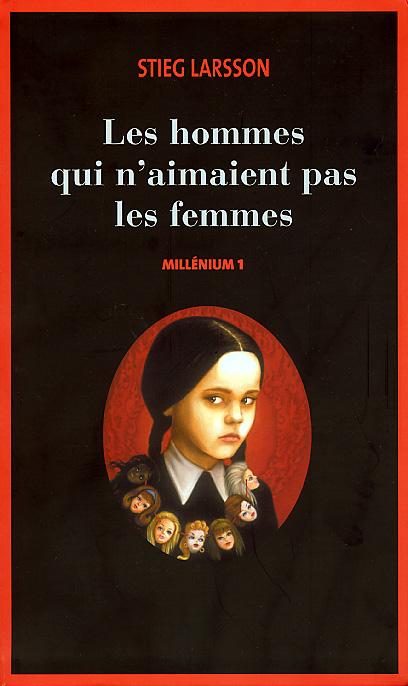
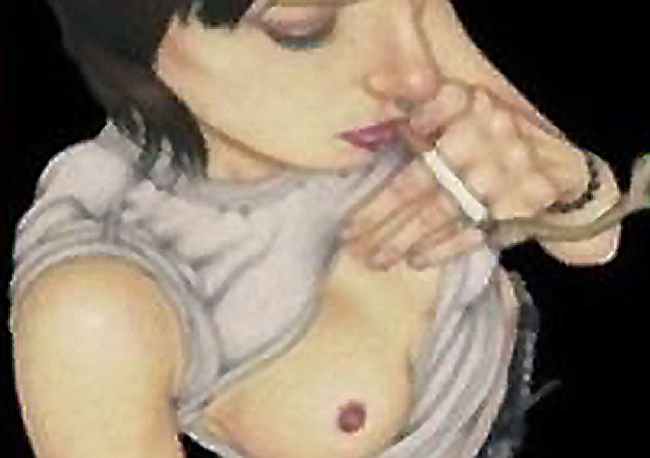
Commentaires récents