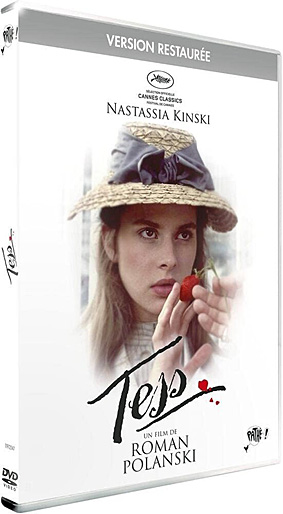
Le roman romantique de Thomas Hardy, publié en 1891, est adapté par un autre Roman – Polanski – dans un long film de près de trois heures. Tess d’Urberville est devenu un classique de la littérature, censuré en son temps par la pruderie victorienne. C’est que Tess, 18 ans (la superbe Nastassja Kinski qui n’en a que 17), est une avenante jeune femme, typique de la nature anglaise. Elle est en harmonie, malgré son père flemmard qui boit (John Collin), sa mère qui pond un gosse tous les deux ans (Rosemary Martin) et sa flopée de petits frères et sœurs. Lorsque le film commence, elle est fille de mai, habillée de blanc, dansant sur un pré reverdi par le printemps. Une fille de Botticelli.



Mais cette pureté va être souillée par la société, par l’étroitesse puritaine du christianisme anglais de l’époque Victoria (due d’ailleurs à son mari, le prince « qu’on sort » quand c’est utile). Et par la génétique, dont Darwin vient de montrer, à l’époque, qu’elle explique largement l’Évolution – autre nom du péché originel. En effet, le pasteur local salue en passant John Durbeyfield, le père de Tess d’un « bonjour, sir John ». Le poivrot met du temps à réagir, l’alcool ralentissant ses neurones déjà grevés par sa lourde hérédité. Il demande des explications, obligeamment fournies par le révérend : il a découvert dans les archives que les Durbeyfield descendaient probablement des d’Urberville, une famille de la conquête normande ; le nom aurait été déformé avec le temps, après la perte des terres et de la fortune par les héritiers affaiblis.
John se glorifie, lui qui n’est rien, d’avoir eu des ancêtres qui ont été tout. Cela l’encourage a encore moins travailler, et à encore plus boire pour oublier. Au point qu’il n’a plus de cheval et que sa famille s’appauvrit. Tess est alors encouragée par sa mère, qui se monte la tête avec les nobles origines supposées, à aller voir la vieille Madame d’Urberville en son manoir ; elle aura peut-être de l’ouvrage pour elle et pourra se faire accepter dans la famille. Tess, naïve, obéit à cette invite au proxénétisme. Mais la d’Urberville lui annonce tout de gob qu’elle n’est qu’une Stroke, le nom ayant été achetés par son mari puisque le titre était en déshérence. Néanmoins, elle veut bien confier à la jeune fille la gestion de son poulailler modèle, étant amoureuse des oiseaux et notamment des coqs.



C’est le début de l’engrenage. Alec, le fils d’Urberville (Leigh Lawson), est un coureur, beau jeune homme charmeur et moustachu, petit-bourgeois entiché de noblesse. Il tombe en désir pour sa « cousine » Tess (on ne peut vraiment parler d’amour, mais plutôt d’attirance sexuelle). Laquelle, oie blanche qui ne voit le mal nulle part, se laisse plus ou moins courtiser, résiste en disant non et montrant que oui, finit par repousser brutalement Alec qui se blesse à la tête avant de le soigner avec tendresse… Bref, elle se laisse avoir. Alec l’embrasse, la caresse, la viole. Sans méchanceté dans le film, mais avec l’égoïsme du fils de famille à qui rien ne doit être refusé. Il s’attache à Tess et veut l’attacher à lui. Mais, au bout de quatre mois, quand la jeune fille s’aperçoit qu’elle est enceinte, elle ne lui en parle pas, bien qu’il ait dit qu’il pourvoirait à tout s’il devait survenir un incident. Au contraire, elle quitte son emploi, le domaine et l’amant. Elle ne veut plus le voir. C’est ainsi que la hantise du « péché » victorien rend stupide les jeunes filles.
Pour la société du temps, ce sont des animaux qui doivent être domptés, à peine des êtres humains. La religion, la société, les pères, sont impitoyables aux filles qui ont commis le « péché » de chair hors des sacrements admis, reconnus et consacrés du mariage. Ce sont des païennes, des chiennes, des impures. Tess met au monde un fils souffreteux qui ne vit qu’une semaine. Son père a refusé de le faire baptiser par souci du Ciel et le pasteur refuse de l’enterrer au cimetière par souci du Qu’en-dira-t-on villageois. Tess baptise son enfant elle-même, selon les rites exacts de l’Église, ce qui est admis pour tout chrétien. Et elle l’enterre elle-même au bord du cimetière puisqu’il n’a pas le « droit » d’y être admis.



Elle retrouve du travail dans une laiterie où les vaches, comme les femmes, produisent du lait pour les enfants de la ville – d’ailleurs coupé d’eau car « trop riche » pour les amollis citadins. Les bidons partent chaque jour en train à vapeur pour Londres. Dans la ferme, un fils de pasteur apprend à devenir fermier ; il veut étudier les procédés avant de se lancer dans la culture. Angel Clare (Peter Firth) ignore les filles de ferme mais tombe sous le charme de Tess, en qui il voit une fille de la nature, paysanne saine et vierge, qu’il se souvient avoir vue au bal de mai. Il en ferait volontiers une épouse, pour l’aider aux travaux des champs et d’élevage qu’il projette. Son « amour » est ainsi biaisé par l’image idéale qu’il s’en fait, et par l’exploitation qu’il envisage de faire d’elle.
Tess sent bien que cet « amour », comme l’autre, est faux. Il est sur une image d’elle, pas sur ce qu’elle est vraiment. Elle tente d’en avertir Angel mais ne peut jamais lui parler, l’autre n’écoute pas – il ne parle que de lui, de son désir, de son romantisme ; elle lui écrit une lettre, mais en la glissant sous la porte, elle passe sous la carpette, donc il ne la voit pas – il ne voit d’ailleurs que ce qu’il veut, pas le réel. Ainsi envisage-t-il d’aller s’installer au Brésil, pays neuf dont il ne connaît rien et dont il reviendra quelques années plus tard, ayant enfin perdu son aveuglement. Le romantisme comme le puritanisme, leurre les sens, le cœur et la raison. Il voile la réalité et la colore selon le désir, créant de « fausses vérités » – comme les politiciens populistes en exploitent aujourd’hui. Ce n’est pas ainsi que l’on est « un homme ». Les femmes paraissent plus proches de la nature, donc du réel, qu’eux qui sont menés par leur désir immédiat plus que par la gestation à long terme.


Lorsque Tess finit par raconter à Angel son histoire, après le mariage, et parce qu’il lui a confessé avoir eu une liaison avec une autre avant de la rencontrer, elle croit que le pardon qu’elle lui, accorde va être réciproque. Sauf que l’égalité entre les femmes et les hommes n’est pas de mise dans la société chrétienne, bourgeoise et victorienne de l’Angleterre 1880. Les mâles sont libres comme des poulains au pré, leurs frasques sexuelles n’ont pas de conséquence sur la famille et l’héritage. Les femelles, en revanche, sont bridées car elles peuvent tomber enceintes, ce qui a d’inévitables conséquences sur la famille et l’héritage. Avant pilule et avortement (acquis du milieu du XXe siècle seulement), toutes les religions et les sociétés entravaient les désirs féminins pour ce motif. Tess se rend compte, à la tête que fait son mari, que ce qu’elle vient d’avouer entache leur union. Angel, malgré son prénom, n’a rien d’un ange. Il a épousé une image de jeune fille pure et se retrouve avec une femme souillée par un autre, qui a menti à Dieu, au prêtre et à son mari.
Il la quitte – sans divorcer – il a besoin de « réfléchir ». Comme il est fils de pasteur, frère de deux révérends, et peu éduqué car préférant les travaux pratiques de la ferme aux livres, il pense lentement. Trop lentement pour l’existence. Tess doit vivre durant ce temps. Elle retourne dans sa famille, mais son père est mort et sa mère est chassée de la maison car le bail était « à vie » pour le mari, mais pour lui seulement. Elle se retrouve à camper près de l’église avec sa marmaille.



C’est encore une fois Alec qui retrouve Tess, employée à déterrer des betteraves en hiver et à battre le blé avec la machine en été. Il lui propose de l’aider ainsi que sa famille. Elle commence par refuser, obstinée par réflexe, avant de consentir, faute de mieux. Tel son destin : obéir à sa condition et aux désirs des autres. Alec établit sa famille, envoie ses frères à l’école, et fait de Tess sa maîtresse car elle ne peut l’épouser étant déjà mariée.
Angel Clare revient de ses illusions brésiliennes et de son échec patent. Son orgueil est rabattu par le réel de la nature, sa raison a dompté son imagination. Il a « réfléchi » et veut bien reprendre Tess car, après tout (c’est l’évidence !) seul l’avenir compte, pas le passé sur lequel on ne peut rien. Il cherche Tess, qui a déménagé, retrouve sa mère, qui ne sait pas où elle est sauf le nom d’une ville en bord de mer. Lorsqu’il parvient à elle, elle lui déclare que « c’est trop tard », qu’il n’a jamais daigné écouter ses supplications, ni répondu à ses lettres, ni surtout accorder (chrétiennement !) son pardon. Car la foi n’est que singeries si elle n’est pas vécue, et la religion un prétexte hypocrite si elle sert la société avant les êtres humains.
Dans la chambre où Alec s’éveille, elle pleure et il la méprise pour cet abandon. Elle ne le supporte plus, son attention initiale pour elle ayant disparue avec la réalisation de son désir ; elle ne supporte plus sa condition de femme, soumise par sa condition et son hérédité – une « fin de race ». Elle le poignarde et quitte la maison en hâte pour la gare où, in extremis, elle parvient à sauter dans le train qui emporte Angel.
Dès lors, c’est la fuite du couple retrouvé. Mais Caïn a tué Abel et la Bible veut qu’il soit châtié mais non tué. Ici, c’est Tess qui a tué Alec et, en tant que femme, elle sera pendue. Angel ne peut jouer son rôle de protecteur jusqu’au bout, laissant son épouse étendue sur un autel païen de Stonehenge, ayant failli dès l’origine à pardonner. « Je vous croyais une enfant de la nature, mais vous êtes le rejeton tardif d’une aristocratie dégénérée. » Elle vient justement se régénérer dans le cercle de pierres de Stonehenge, au soleil qui se lève – dans l’axe du monument. Eve-Tess est coupable et Adam-Angel est chassé du paradis. Il gardera la trace du péché en lui à vie – lui qui aurait pu comprendre et pardonner. Tess a vécu son destin tragique en quelques années, depuis le moment où le pasteur a révélé à son père une origine noble douteuse jusqu’au moment où, deux fois flétrie, elle s’est condamnée à mourir par son crime.
Un film un peu long, un peu lourd, dédié « à Sharon », épouse de Roman assassinée enceinte par le sectaire Charles Manson et qui lui avait offert Tess d’Urberville pour qu’il fasse son cinéma. Un film qui déconstruit le romantisme, critique impitoyablement l’hypocrisie religieuse puritaine, qui expose l’exploitation des femmes dans l’Angleterre du XIXe. Beaux paysages, bonne musique accompagnante, bons acteurs malgré Nastassja Kinski qui reste retenue, comme sans désirs ni passion. Un bon film des années 70.
Césars 1980 du meilleur film, du meilleur réalisateur, de la meilleure photographie.
Oscars 1981 de la meilleure photographie, de la meilleure direction artistique, des meilleurs costumes.
Golden Globes 1981 du meilleur film étranger.
DVD Tess, Roman Polanski, 1979, avec Nastassja Kinski, Peter Firth, Leigh Lawson, John Collin, Rosemary Martin, Pathé 2014 version remastérisée 2012 doublée anglais-français ou vo, 2h44, €9,41, Blu-Ray €14,10
(mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés Amazon partenaire)





















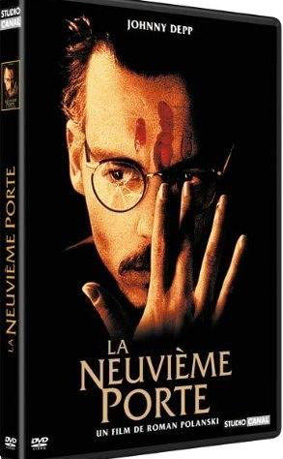
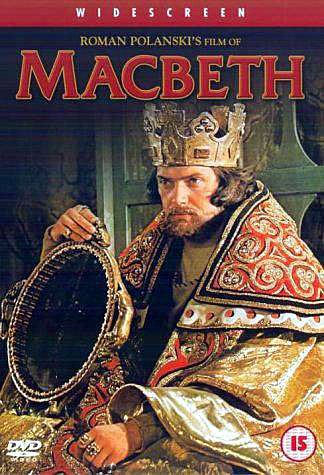



Commentaires récents