 Gros succès pour ce thriller suédois paru en 2005. Avec raison. Il s’agit – pour une fois – d’un polar économique où le héros n’est pas agent secret ou flic, mais journaliste d’investigation. De quoi nous rappeler que la Suède est une nation industrielle qui a su tirer des atouts de la mondialisation.
Gros succès pour ce thriller suédois paru en 2005. Avec raison. Il s’agit – pour une fois – d’un polar économique où le héros n’est pas agent secret ou flic, mais journaliste d’investigation. De quoi nous rappeler que la Suède est une nation industrielle qui a su tirer des atouts de la mondialisation.
Mikael Blomkvist aime l’économie, la justice, les droits de l’homme. Il est le Suédois que chaque famille aimerait pour gendre tant il répond au politiquement correct local. Sauf qu’un financier très puissant lui a fait mordre la poussière – procès, amende et trois mois de prison. Celui qui n’a comme fortune que sa réputation ne saurait pardonner !
C’est alors que l’histoire se complique. Le thriller économique se transforme en traque policière sur un tout autre sujet : un mystérieux tueur en série qui sévit depuis des dizaines d’années en Suède et aurait fait disparaître Harriet, la nièce du PDG d’un autre puissant groupe industriel familial suédois. Comme Mikael n’a rien à faire, en attendant que la profession oublie un peu son procès et qu’il fasse son temps de prison, le PDG octogénaire Heinrik Vanger l’embauche comme traqueur pour revoir toute l’affaire. Elle a été l’obsession de sa vie et il veut faire une dernière tentative avec un œil neuf.
C’est là que l’on découvre les techniques du journalisme d’investigation : elles s’apparentent fort aux techniques d’enquêtes policières – voire à celles des agents secrets. Une jeune fille, Lisbeth, à l’existence déstructurée et chaotique, se révèle experte en informatique avec des procédés sophistiqués de hacker. Après avoir lu ce livre, vous ne pourrez plus vous connecter à internet sans avoir au préalable vidé votre ordinateur de tout ce qu’il peut contenir de personnel – et soigneusement haché les fichiers transférés…
 Sans dévoiler l’histoire, palpitante et bien menée dans le décor exotique de l’hiver glacé d’une Suède constamment baignée par la mer, on peut résumer le tome 1 de Millénium de la façon suivante. ‘Millénium’ est le titre d’un magazine d’investigation économique ; c’est lui le vrai héros du livre. L’auteur a lui-même dirigé un magazine de ce type, ‘Expo’, avant de décéder en 2004. Son journaliste va sauver un empire industriel et en couler un autre ; il va soutenir la famille patriote et détruire en vol les escrocs apatrides. Voilà une belle quête pour une Suède du 21ème siècle en quête d’identité !
Sans dévoiler l’histoire, palpitante et bien menée dans le décor exotique de l’hiver glacé d’une Suède constamment baignée par la mer, on peut résumer le tome 1 de Millénium de la façon suivante. ‘Millénium’ est le titre d’un magazine d’investigation économique ; c’est lui le vrai héros du livre. L’auteur a lui-même dirigé un magazine de ce type, ‘Expo’, avant de décéder en 2004. Son journaliste va sauver un empire industriel et en couler un autre ; il va soutenir la famille patriote et détruire en vol les escrocs apatrides. Voilà une belle quête pour une Suède du 21ème siècle en quête d’identité !
N’hésitez pas à lire ce livre : vous allez entrer dans le monde contemporain où la combinaison ordinateur + connexion ADSL est désormais l’arme la plus puissante – comme la faille la plus grave de l’économie. Wikileaks le montre à l’envi, mais aussi les intrusions chinoises dans les centres serveurs ou le virus inoculé par Israël (?) aux ordinateurs des centrales nucléaires iraniennes.
Les nouveautés de la finance, qui frisent l’escroquerie, devraient être mises au jour et dénoncées par les journalistes si ceux-ci ne restaient pas fascinés par la richesse et trop frileux pour s’engager. Le roman a été écrit juste après l’éclatement de la bulle internet. « Les analystes économiques suédois étaient ces dernières années devenus une équipe de larbins incompétents, imbus de leur propre importance et totalement incapables de la moindre pensée critique » p.109. On peut en dire autant des journalistes spécialisés du monde entier. Surtout lorsqu’on empile des sociétés bidon qui traversent des places offshores. Stieg Larsson écrit, non sans humour : « Wennerström se consacrait à l’escroquerie sur une échelle tellement vaste qu’il ne s’agissait plus de crime – il s’agissait d’affaires. » p.543
La dernière pique est réservée aux affolés sociaux qui préfèrent ne jamais lever le voile, des fois que « l’économie suédoise » en pâtisse. Ils se font, ce faisant, complices de l’escroquerie. Or, déclare le journaliste, « il faut distinguer deux choses – l’économie suédoise et le marché boursier suédois. L’économie suédoise est la somme de toutes les marchandises et de tous les services qui sont produits dans ce pays chaque jour. (…) La bourse, c’est tout autre chose. Il n’y a aucune économie et aucune production de marchandises ou de services. Il n’y a que des fantasmes où d’heure en heure on décide que maintenant telle ou telle entreprise vaut quelques milliards de plus ou de moins » p. 560. Rappelons que la Suède est restée en couronnes, elle ne compte pas en euros.
Non que la bourse n’ait pas d’importance mais il faut garder à l’esprit que la spéculation se déconnecte des actifs réels. « Cela signifie qu’un tas de gros spéculateurs sont actuellement en train de transférer leurs portefeuilles boursier des entreprises suédoises vers les entreprises allemandes. Ce sont donc les hyènes de la finance qu’un reporter avec un peu de couilles devrait identifier et mettre au pilori comme traîtres à la patrie. Ce sont eux qui systématiquement et sciemment sapent l’économie suédoise pour satisfaire les intérêts de leurs clients » p.561.
Le patriotisme économique contre les requins apatrides, est-ce un signe des temps ?
Stieg Larsson, Millénium 1 – Les hommes qui n’aimaient pas les femmes (Man som hatar kvinnor), 2005, éd. française Actes sud poche Babel noir 2010, traduit du suédois par Lena Grumbach et Marc de Gouvenain, 575 pages, €10.93.
Les trois Millenium en 3×2 CD audio, 60 h d’écoute, Audiolib 2008, €68.40
Eva Gabrielsson, Millenium Stieg et moi, Actes sud 2011, 160 pages, €19.00



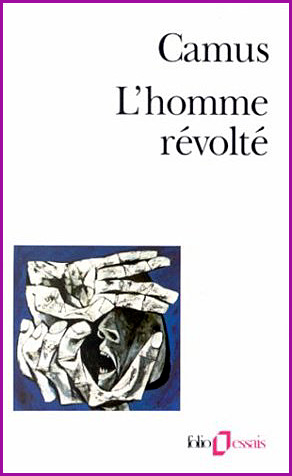
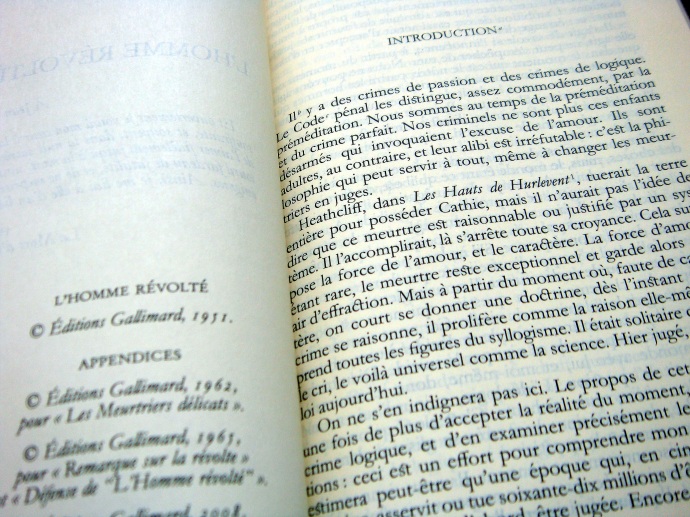








Commentaires récents