La fin du népotisme et des oukases présidentiels, le retour aux corps intermédiaires, à l’indépendance de la justice : le règne commençant de François Hollande et de son Premier ministre Jean-Marc Ayrault, fils d’ouvrier du textile et méritocrate républicain, ressemble fort au radical-socialisme relouqué, une sorte de « normal-socialisme » pour président « normal », un bruit de fond politique dans la société française.
 Mais prendre le pouvoir est une chose, l’exercer une autre. L’anti-sarkozysme primaire n’a jamais fait un projet, « revenir » sur les réformes de l’hyperprésident ne dessine aucun avenir… mais la fin de laborieuses économies budgétaires qu’il va falloir compenser par ailleurs. L’économie va mal dans la réalité et le déni va sans souci dans l’opinion de gauche. La mauvaise Grèce vient justement de se rappeler aux membres de l’Union. Elle refuse à la fois l’austérité et la sortie de l’euro, rejette son élite aux commandes et la discipline collective, ne veut pas payer d’impôts ni de tutelle budgétaire… D’où la montée des extrêmes, dits « populistes » pour dire leur immaturité violente : les gauchistes et les nazis, le Mélenchon et la Marine à la grecque. Avis de dérive possible à la gauche au pouvoir.
Mais prendre le pouvoir est une chose, l’exercer une autre. L’anti-sarkozysme primaire n’a jamais fait un projet, « revenir » sur les réformes de l’hyperprésident ne dessine aucun avenir… mais la fin de laborieuses économies budgétaires qu’il va falloir compenser par ailleurs. L’économie va mal dans la réalité et le déni va sans souci dans l’opinion de gauche. La mauvaise Grèce vient justement de se rappeler aux membres de l’Union. Elle refuse à la fois l’austérité et la sortie de l’euro, rejette son élite aux commandes et la discipline collective, ne veut pas payer d’impôts ni de tutelle budgétaire… D’où la montée des extrêmes, dits « populistes » pour dire leur immaturité violente : les gauchistes et les nazis, le Mélenchon et la Marine à la grecque. Avis de dérive possible à la gauche au pouvoir.
Contrer l’extrémisme veut dire donner des voix aux courants populaires. Cela passe par une dose de proportionnelle, peut-être, mais surtout par un rôle réévalué du Parlement où doivent être débattus dans la sérénité et la durée les grandes questions de société et d’économie. La « normalité » de la Vème République est que le président règne et que le Premier ministre gouverne, chef de la majorité parlementaire mais pas dispensé de ses avis. La normalité des institutions exige que les contrepouvoirs remplissent leur tâche sans interférence du politique, ni des partis, ni des ego des puissants. Cela passe aussi à la base par les associations, les syndicats, les débats publics, les référendums locaux, la presse locale, les blogs, les réseaux sociaux… Être citoyen, c’est participer, pas se retirer dans l’entre-soi en remâchant ses rancœurs sur le « tous pourris » ou « l’État PS ».
 Le socialisme Hollande n’est pas le socialisme Mitterrand et 2012 n’a rien à voir avec 1981, n’en déplaise aux histrions médiatiques qui adorent les rétrospectives (ce qui leur évite de réfléchir et d’inventer). L’étatisme jacobin des nationalisateurs taxeurs n’est plus d’actualité. Nous vivons dans le monde ouvert du XXIème siècle, pas dans la nostalgie du marxisme bismarckien début XXème. L’industrie lourde fond à vue d’œil et peut-être faut-il s’en préoccuper, mais il faut surtout encourager l’innovation, l’image de marque et le service !
Le socialisme Hollande n’est pas le socialisme Mitterrand et 2012 n’a rien à voir avec 1981, n’en déplaise aux histrions médiatiques qui adorent les rétrospectives (ce qui leur évite de réfléchir et d’inventer). L’étatisme jacobin des nationalisateurs taxeurs n’est plus d’actualité. Nous vivons dans le monde ouvert du XXIème siècle, pas dans la nostalgie du marxisme bismarckien début XXème. L’industrie lourde fond à vue d’œil et peut-être faut-il s’en préoccuper, mais il faut surtout encourager l’innovation, l’image de marque et le service !
Ce ne sont pas les subventions d’État qu’il faut aux Français, mais moins de paperasserie pour créer une entreprise, moins d’obstacles à toute réduction d’effectifs en cas de crise – ce qui rend l’embauche malthusienne – moins de mépris pour « le profit » s’il est réinvesti pour créer de l’activité, donc de l’emploi et des exportations, moins de mathématisation du cursus scolaire, la réévaluation des relations humaines et des réalisations en équipe. Vaste programme pour le normal-socialisme !
Mais n’est-ce pas cela avant tout, « changer la vie » ? Bien plus que rêver d’une utopie (qui n’a jamais que des bons côtés) ou régresser à un âge d’or (qui n’a jamais existé) ? On a vu ce qu’a donné l’utopie communiste en URSS, en Chine, à Cuba, au Cambodge… On a oublié que l’âge d’or des Trente glorieuses de la reconstruction et l’État-providence créé en 1945, ont généré les guerres coloniales, les rapatriés d’Algérie, la révolte fiscale des artisans-commerçants, les manifs d’agriculteurs excédés de « Paris et du désert français », les attentats OAS, le travail en miettes, l’homme unidimensionnel aboutissant à la révolte de mai 68 et l’effondrement des houillères et de la sidérurgie…
Le capitalisme actuel est moins industriel et familial (rhénan) que financier et anonyme (anglo-saxon). L’Allemagne, le Japon, la Chine, l’Inde, montrent que le capitalisme industriel est le seul qui donne la puissance aux États, alors que le capitalisme financier reste hors sol, cosmopolite, égoïste, évanoui dans les paradis fiscaux. La question est alors moins de savoir gérer l’existant (la finance) que d’encourager l’intérêt stratégique national et européen (l’industrie). « Dompter » la finance ne devrait donc pas suffire au normal-socialisme.
Le contraste allemand montre combien la France est loin de l’état d’esprit nécessaire ! En France : une éducation vouée à l’abstraction, le tabou sur l’apprentissage, le mépris de l’argent au profit des « honneurs », la lutte des classes permanente entre syndicats (très peu représentatifs et surtout du public) et les patrons (pas tous profiteurs), la propension des jeunes à vouloir « devenir fonctionnaires » à 70%, les 35h et la retraite à 60 ans, les quatre mois de vacances des enfeignants et les journées chargées des enfants, les « devoirs » à la maison et le jugement ultime sur les seuls maths pour « classer » les bons et les nuls, l’ouverture sans filtre de l’université où 70% des premières années n’atteignent jamais la troisième, générant un gaspillage de moyens et des rancœurs d’orientation…
L’apaisement normal-socialiste de la France passe par l’examen de ce qu’a réussi l’Allemagne. Il ne s’agit pas de copier un « modèle » (vieux tropisme scolaire des abstracteurs français mal éduqués par le système), mais de voir comment nous pourrions changer en mieux : des jours de classe moins chargés, des vacances plus courtes, des enseignants moins nombreux par élève mais mieux payés, des activités collectives, l’apprentissage en alternance, des syndicats bien plus représentatifs, la cogestion de crise syndicat-patronat, l’implication des collectivités publiques dans les entreprises d’intérêt stratégique, une paperasserie bien moindre et moins de taxes sur l’emploi et les revenus du travail. Rien que cela !
 Mais l’égalité, dit Pierre Rosanvallon (La société des égaux), est la capacité à se comporter en égaux : ce qui signifie être autonome, responsable et indépendant. Tel est le normal-socialisme : l’’inverse de la victimisation Royal ou du care Aubry où un État-maman distribue la becquée et les soins aux milliers de pauvres assistés réputés incapables et maintenus sous tutelle. Le normal-socialiste se constitue en égal des autres par l’éducation, les liens sociaux et l’intelligence des situations – au contraire de la gauche tradi qui croit encore à l’État niveleur rendant tout le monde pareil.
Mais l’égalité, dit Pierre Rosanvallon (La société des égaux), est la capacité à se comporter en égaux : ce qui signifie être autonome, responsable et indépendant. Tel est le normal-socialisme : l’’inverse de la victimisation Royal ou du care Aubry où un État-maman distribue la becquée et les soins aux milliers de pauvres assistés réputés incapables et maintenus sous tutelle. Le normal-socialiste se constitue en égal des autres par l’éducation, les liens sociaux et l’intelligence des situations – au contraire de la gauche tradi qui croit encore à l’État niveleur rendant tout le monde pareil.
La société devient plus complexe parce que l’individualisme s’approfondit avec la démocratie, Tocqueville l’avait déjà montré. La représentation politique ne peut dès lors plus passer seulement par les grandes machines de masse que sont les partis, ni la politique consister à imposer d’en haut des décisions technocratiques ou partisanes. Il faut plutôt écouter, faire remonter, expliquer, débattre, négocier. Associer la population et les qualifiés aux décisions, montrer qu’il y aura toujours des perdants à tout changement d’une quelconque situation, mais que l’intérêt national et européen doit primer. Que la dépense publique ne va pas sans rigueur budgétaire et que trop d’impôts tue l’impôt. Fini le « toujours plus ! », place au réalisme.
Non, 2012 ne ressemble en rien à 1981. Le socialisme à la française serait-il devenu « normal » ? Semblable aux autres socialismes européens ?





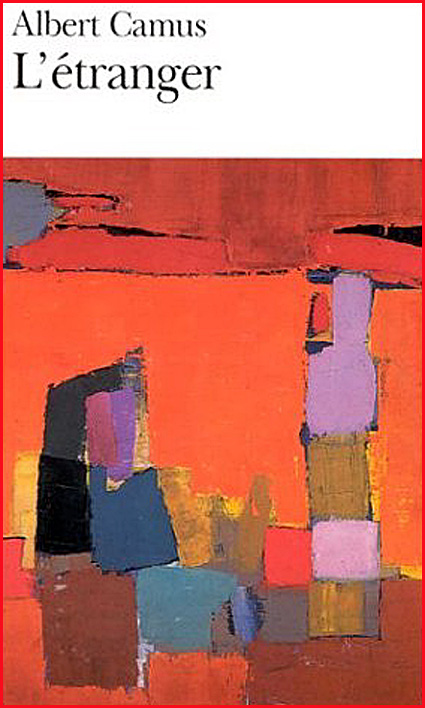
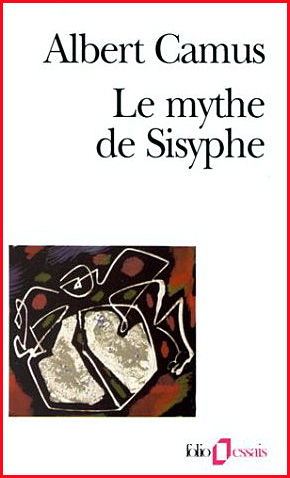

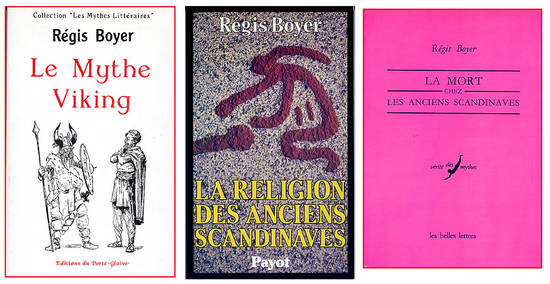
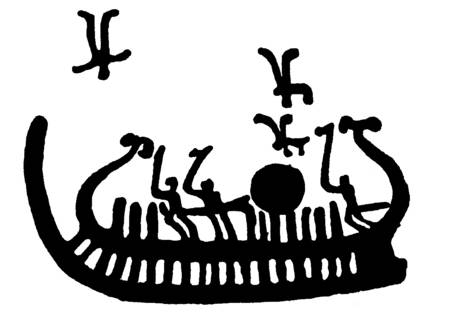
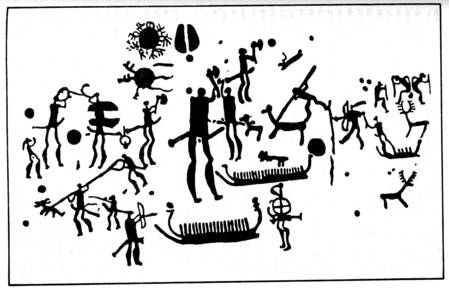

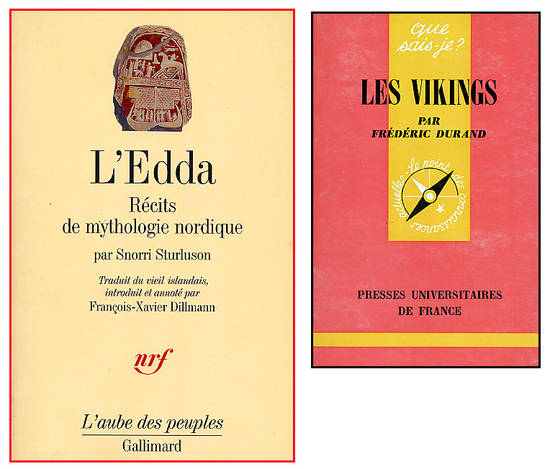

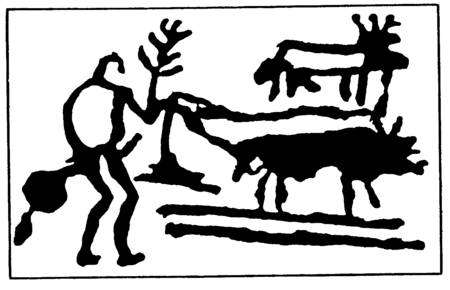

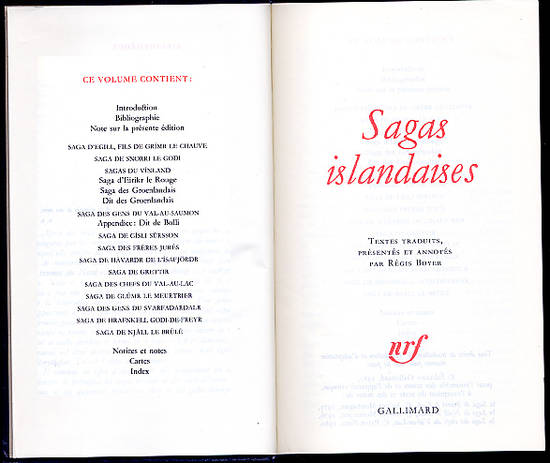
Commentaires récents