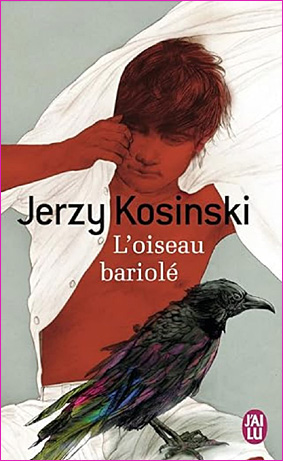
Un petit garçon juif né en 1933 est livré par ses parents à une paysanne pour le cacher sous une fausse identité catholique durant la guerre qui commence en Pologne ; il a 6 ans et ses parents l’abandonnent. Ce n’est pas la première fois où un couple se débarrasse d’un enfant devenu une gêne pour survivre, sous le prétexte « belle âme » de le sauver. On se souvient du Tanguy de Michel del Castillo. Toujours est-il que le petit juif Jozef se transforme en petit catholique Jerzy pour vivre à la campagne chez Marta, une vieille qui ne se lave que deux fois l’an, et encore seulement le visage et les bras.
Elle ne tarde pas à mourir et le gamin est livré à lui-même, devenant Juif errant, enfant orphelin qui ne vit que de rapines ou de petits boulots comme berger ou boy à tout faire dans les fermes. Il récuse constamment l’accusation d’être Juif, ou encore Bohémien, par souci littéraire de faire de ce roman auto-fictionnel une histoire exemplaire de la victime livrée nue et vulnérable aux bourreaux ; mais aussi peut-être parce qu’il ne se sent pas « juif » au sens où ses parents et sa famille l’ont laissé sans culture. Toujours est-il que l’enfant a les cheveux noirs dans un pays où la blondeur domine, et les yeux noirs perçants, insondables, parmi une ethnie aux yeux clairs et limpides. Les paysans polonais sont particulièrement arriérés au milieu du XXe siècle, loin de tout centre culturel et industriel. Ils cultivent leurs lopins en autarcie, élèvent des bêtes, se jalousent et s’entrebaisent comme des bêtes, se mêlant parfois à elles.
Car c’est l’enfer de Goya que décrit ingénument le jeune garçon sur le ton du conte. De chapitre en chapitre, il est pourchassé, à peine protégé par ceux qui l’exploitent, souvent battu, les vêtements arrachés, roué de coups par les jeunes bergers à peine plus grands que lui, enfoncé dans une fosse à merde par les fidèles de l’église parce qu’il a laissé tomber le lutrin de l’Évangile, trop lourd pour ses petits bras, pendu par les mains sous la menace des crocs d’un chien féroce s’il laisse aller les jambes, à demi-violé et enfoncé sous la glace par une bande à peine adolescente, condamné à être fusillé par les Allemands, assommé par les Kalmouks… De ses 6 à ses 12 ans, de 1939 à 1945, ce ne sont que sévices qui lui tombent dessus et le tourmentent. Le lecteur se demande comment le garçon a pu s’en tirer, même s’il est intelligent, observateur et débrouillard.
Quelques personnages prennent soin de lui, Olga la « sorcière » qui connaît les plantes et lui apprend, l’Oiseleur qui capture la gent ailée et s’amuse, quand il est triste, à peindre un oiseau de couleurs diverses avant de le relâcher parmi ses congénères. Ils ne le reconnaissent pas car il n’est pas conforme et le tuent à coups de bec. L’enfant se sent comme ces oiseaux marqués, un étranger parmi les siens.
Oh, comme il aimerait ressembler au jeune officier nazi dans toute la gloire de sa haute stature musclée, de son visage de marbre et de ses cheveux de soleil, bien pris dans son uniforme noir aux éclairs d’argent ! « Il me paraissait le modèle de la perfection incorruptible : des joues satinées et fermes, des cheveux d’or sous la casquette, des yeux de pur métal. Chaque mouvement de son corps semblait harmonieusement produit par quelque force souveraine. (…) Je ressentis tout à coup un élancement de jalousie passionnée que je n’avais jamais connu » p.161.
Cette admiration mimétique aurait pu l’invertir, comme cela est arrivé à Tanguy. Mais le garçonnet, à 10 ans, connaît déjà la femme, une Ewka de 18 ans énamourée qui le frotte, l’érige et plante en elle ce qu’il peut lui donner, mais sollicite surtout des caresses dont elle est avide et qui la font jouir. Tout comme son frère de 19 ans, son père Makar ou même un bouc excité par le frère et livré tout debout à ses emportements (p.206). Les amours paysannes sont dans la fièvre et l’intersexualité. L’auteur fantasme sans doute un brin lorsqu’il décrit ses amours de garçonnet avec la jeune fille. « Elle s’étendait nue à côté de moi et me caressait les jambes, m’embrassait les cheveux et me déshabillait d’une main preste. Nous nous enlacions, Ewka se pressait contre moi, me demandait de l’embrasser partout, ici et puis là. J’obéissais à tous ses désirs, essayant toutes sortes de caresses, même si elles me paraissaient douloureuses ou absurdes. (…) Puis elle me grimpait dessus, puis elle me faisait asseoir sur elle, puis elle me serrait de toutes ses forces entre ses jambes… » p.199.
A la fin de la guerre, le petit Jerzy de 11 ans voit déferler sur le village les Kalmouks, ces Mongols renégats de l’empire soviétique collaborant avec les Allemands, qui les laissent piller et violer tant qu’ils peuvent. Ils refluent devant l’Armée rouge qui est toute proche et se déchaînent. A demi-nus, ils violent les femmes, les filles et les fillettes, debout, couchés, nus à cheval, devant et derrière, à un ou a plusieurs, pris de frénésie et saouls, s’accouplant parfois entre eux, dans une bacchanale de sauvages déchaînés. « Un jeune soldat trouva dans une cabane une fillette de 5 ou 6 ans. Il la souleva à bout de bras, pour la montrer à ses camarades. Puis il déchira sa robe. Il lui envoya un coup de pied dans le ventre, sous les yeux de sa mère, qui rampait dans la poussière, en criant grâce. Tout en maintenant la fillette d’une main, il défit lentement son pantalon et transperça tout à coup l’enfant qui exhala une plainte déchirante » p.243. Ce sont ces images sexuelles fortes qui font de ce livre un roman mythique. Elles s’impriment dans la mémoire et je me souviens encore de celled-ci, plus de quarante ans après. L’auteur s’identifie vraisemblablement à cette fillette qui a l’âge qu’il avait lorsqu’il a été livré aux manants ; il aurait pu être violé ainsi, crucifié parce qu’étranger sur la terre.
Ce roman métaphorique a eu beaucoup de succès à sa parution aux États-Unis et a été traduit en plusieurs langues ; il a été interdit en Pologne soviétique, « le peuple » s’étant indigné de se voir peint sous de tels traits barbares. Mais on sait aujourd’hui par les travaux de Jan Tomasz Gross, Les Voisins, un massacre de Juifs en Pologne, combien « le peuple » polonais haïssait les Juifs et les Tziganes durant la guerre, n’hésitant pas à tuer même leurs propres concitoyens sous ce prétexte racial pour s’approprier leurs biens. Des pratiques qu’ils voudraient bien oublier et dont l’extrême-droite actuelle censure toute évocation. Mais les faits sont les faits ; la guerre débarrasse de toute morale et ce sont les instincts purs, grégaires et sexuels, qui se reprennent le dessus sans aucune bride.
Décédé aux États-Unis en 1991 à 57 ans, après y avoir émigré en 1957, Kosinski a obtenu de nombreux prix littéraires et a été président du Pen Club américain.
Jerzy Kosinski (né Jozef Lewinkopf), L’oiseau bariolé (The Painted Bird), 1965, J’ai lu 2007, 314 pages, €6,20 , e-book Kindle (version retraduite en texte « non censuré ») €2,54

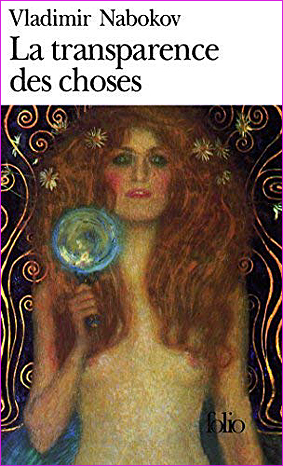




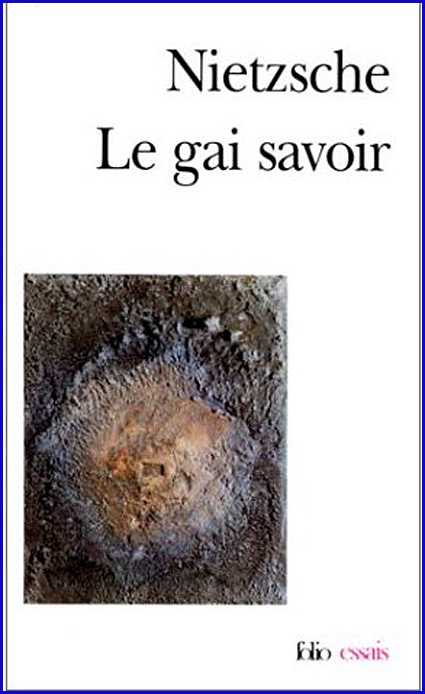



Commentaires récents