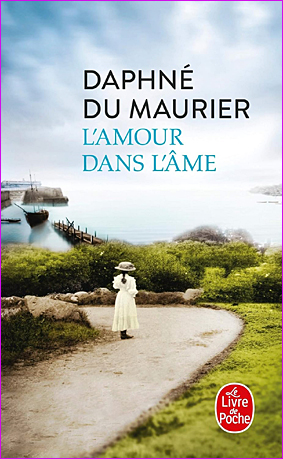
Ce premier roman, publié à 24 ans, campe le destin d’une famille de marins et charpentiers tournés vers la mer dans le village inventé de Plyn, décalque du réel Polruan, village en face de Fowey en Cornouailles. L’idée lui est venue de ce roman après avoir découvert l’épave d’une goélette appelée Jane Slade à Pont Creek, puis consulté les documents du chantier naval de la famille Slade, constructeurs au village voisin de Polruan. Dame Daphne du Maurier (sans accent sur le « e » en anglais), autrice de romans à succès, a été faite en 1969 chevalière de l’Ordre de l’empire britannique avant de décéder à 81 ans en 1989. Elle est surtout connue pour Rebecca, l’Auberge de la Jamaïque (chroniqués sur ce blog) et sa nouvelle Les Oiseaux qui a inspiré son film à Hitchcock.
Cette passionnée de voile et d’air marin conte une saga familiale sur un siècle et quatre générations. Elle commence par une femme, Janet, et se termine par une femme, Jenny ; entre elles, deux hommes, Joseph et Christopher.
Janet a une passion irrationnelle pour la mer et l’aventure ; elle ne sera que mère de famille au milieu de son siècle, le XIXe. Mais elle mettra au monde, avec son mari Thomas Coombe, pas moins de six enfants, dont Joseph, son préféré. C’est un gamin hardi qui ne pense qu’à l’eau salée, courant pieds nus dans les flaques, nageant nu dans les vagues, ramant en chemise ouverte sur la barque. Il est très fusionnel avec maman, qui voit en son troisième enfant cet homme libre sur la mer qu’elle-même aurait rêvé d’être. Son mari Thomas et ses fils Samuel et Herbert construisent une goélette qui portera le nom de Janet et dont la figure de proue sera sculptée à son effigie. Joseph, ayant obtenu son brevet de capitaine, sera le premier à commander le nouveau navire. Le jour de l’inauguration, c’est trop d’émotion : Janet meurt d’une crise cardiaque ; elle avait négligé les symptômes et brûlé sa vie par tous les bouts. Son esprit semble la quitter pour s’incarner dans la figure de proue.
Joseph ne vit que sur mer et pour la mer ; il aime à battre des records de vitesse avec sa goélette pour transporter des fruits et légumes depuis le continent, ou du poisson de Terre-Neuve. Il ne se marie que fort tard mais aura quand même quatre enfants, dont son aîné Christopher, qui a les yeux de sa grand-mère Janet. Hélas ! Le garçon déteste la mer, il en a le mal dès qu’il monte sur un bateau, et sa constitution frêle ne supporte pas la rudesse du métier de marin. Il tentera par deux fois de faire plaisir à son père, puis désertera pour aller se marier à Londres avec une grosse Bertha, fille de puritaine pas mal coincée qui lui donnera deux fils et une fille, la petite dernière nommée Jennifer.
C’est elle qui reprendra le flambeau de Janet et épousera John, son cousin né de Fred, fils d’Elisabeth, la petite sœur de Joseph. Après la chute de la marine à voile et des bateaux en bois au profit de la vapeur et du métal, le chantier Coombe est mis en faillite par l’infâme oncle Philip, né quatre ans après Joseph et jaloux de sa vitalité et de la préférence maternelle (le petit dernier se croit toujours le plus aimé). John recrée un chantier pour construire des voiliers de plaisance, avec le savoir-faire ancestral. Comme quoi rien n’est inéluctable, et quand on veut, on peut.

La romancière anglaise nous entraîne, avec un vrai talent de conteuse et une sensibilité pour les êtres, dans le siècle de 1830 à 1930, avec pour sel la mer, encore et toujours la mer. Il faut dire que, dans la région de Fowey (prononcez Foï, à la cornouaillaise) au sud-ouest de l’Angleterre – j’y suis allé jadis en voilier -, c’est tout l’océan Atlantique qui vient frapper, inlassablement, la côte rocheuse, sous le vent direct venu d’Amérique. Les femmes ne peuvent qu’être insoumises au can’t victorien, et les hommes ne peuvent que garder un peu de cette sauvagerie du large, confrontés en permanence aux flots et aux tempêtes. Dans ce milieu marin, les passions y sont exacerbées : amour, haine, vengeance et trahison y naissent et s’y épanouissent plus qu’à Londres.
Mais une chaîne génétique est née avec Janet, qui restera l’esprit tutélaire de ses descendants avec son portrait en figure de proue de la goélette en bois construite par son mari et ses fils, et qui voguera plus de quarante ans avant de s’échouer, un soir de tempête, en face du port. Christopher, qui s’était engagé comme sauveteur en mer, y a laissé la vie en voulant la sauver, se rachetant ainsi de sa lâcheté face aux flots, à son père et à sa grand-mère. Parfois mystique, le roman évoque un esprit d’amour qui se transmet par des visions, en général sur la falaise au-dessus de la mer – un titre tiré du poème « Self-Interrogation » d’Emily Brontë, cité en exergue. Reste de romantisme dans une littérature qui bascule, avec le siècle, vers la machine.
Daphne du Maurier s’est décrite en Janet Coombe, habitée comme elle du désir sauvage d’être libre. Elle a toujours lutté contre les façons de son milieu d’origine et désiré vivre avec l’absence de contrainte sociale d’un homme. Lorsqu’elle a découvert la Cornouailles, elle a dit : « Voici la liberté que je désirais, longtemps recherchée, mais encore inconnue. La liberté d’écrire, de marcher, d’errer. La liberté de gravir des collines, de tirer un bateau, d’être seule. » Dans l’imaginaire de ce roman, elle l’a fait. C’est ce qui lui donne sa puissance.
La Chaîne d’amour (The Loving Spirit — réédité aujourd’hui en français sous le titre L’Amour dans l’âme), 1931, Livre de poche 2014, 504 pages, €9,70, e-book Kindle €7,49
(mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés par amazon.fr)

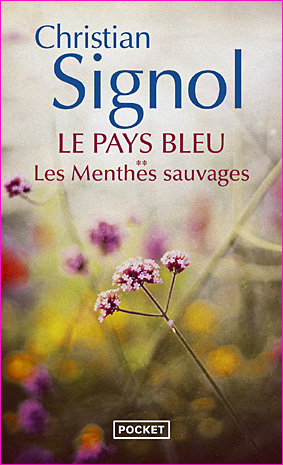
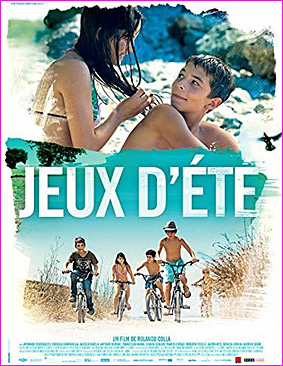









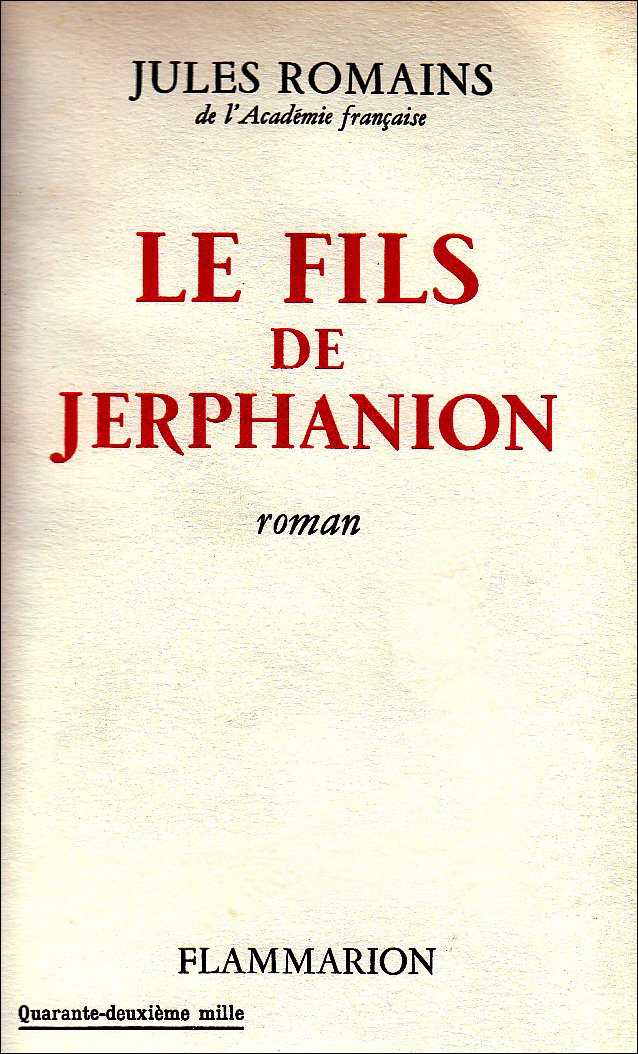


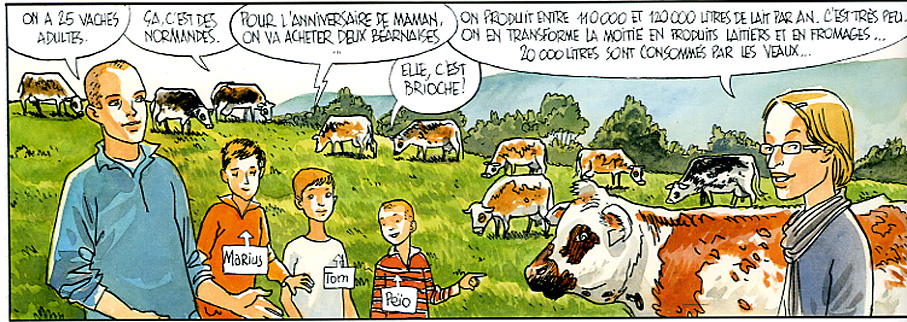
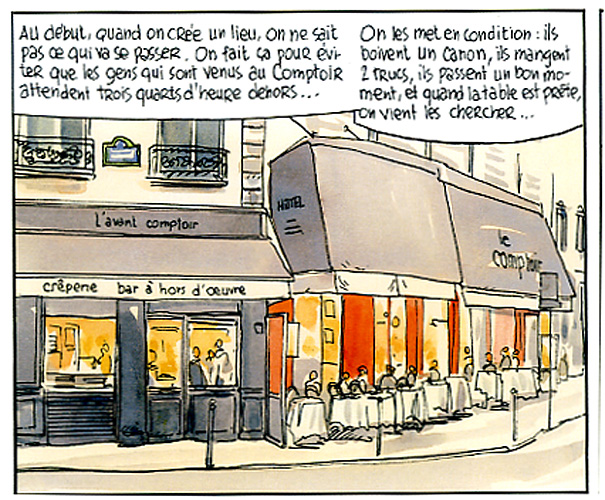
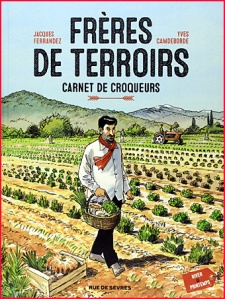


Commentaires récents