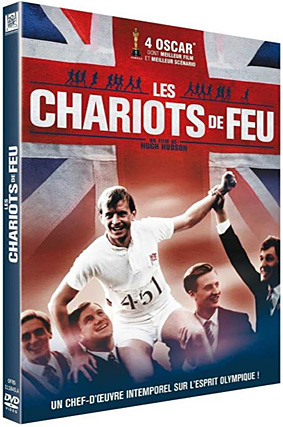
Un film engagé, à la gloire du sport olympique qui transcende les préjugés. Eric Liddell (Ian Charleson), croyant presbytérien écossais fervent court pour la gloire de Dieu, et Harold Abrahams (Ben Cross), juif anglais non pratiquant, court pour surmonter les préjugés. Le titre du film est inspiré d’un poème de William Blake, And Did Those feet in Ancient Time. Mis en musique par Charles Hubert Hastings Parry en 1916 dans son hymne Jerusalem, il est devenu chanson légendaire de la culture anglaise, un hymne patriotique utilisé pendant les guerres. L’histoire s’inspire librement de l’histoire de deux athlètes britanniques concourant aux Jeux olympiques d’été de Paris 1924, Harold Abrahams et Eric Liddell.
Tout commence dans la cour du collège de Cambridge, en 1919, lorsqu’Abrahams entre à l’université et se retrouve en butte à l’antisémitisme larvé du personnel. Il veut prouver qu’il est anglais comme les autres, et que les valeurs du collège sont les siennes. Même s’il ne chante pas à la chapelle, n’étant pas chrétien, il participe aux activités multiples : il joue du piano dans le groupe Gilbert & Sullivan, s’est inscrit au groupe d’athlétisme.


Il veut surtout réussir la course de la cour de la Trinité, épreuve que nul n’a réussi « depuis 700 ans », dit-on (faute d’avoir essayé ?). Il s’agit de courir autour de la cour de Trinity College dans le temps qu’il faut à l’horloge pour frapper les douze coups de midi. Départ au premier coup, arrivée obligatoire avant le dernier coup. Par esprit de solidarité, un élève, Lord Lindsay, se joint à lui, mais Abraham gagne haut la main. Il est désormais populaire parmi les étudiants et surveillé de près par la direction.
Les professeurs à la tête du collège sont conservateurs des valeurs britanniques et voient d’un œil à la fois intéressé (pour la réputation de l’école) et inquiet (pour la transgression des valeurs) l’étoile d’Abraham monter. Ils le convoquent et le lui disent, le sport pour l’esprit d’équipe oui, la compétition pour gagner « à tout prix », non. Or Abraham s’est adjoint un entraîneur professionnel pour améliorer sa foulée, faisant du sport non plus en « amateur » comme les autres élèves, mais comme une « affaire » – ce qui marque bien son caractère « juif ». Mais cet antisémitisme épidermique ne va pas sans reconnaître l’élite juive : « vous êtes Lévite », dit le principal de Trinity College (John Gielgud), cela vous engage. Les Lévites sont une tribu exclusivement vouée au service de Yahweh, mise à part des autres par Lui. Une sorte de noblesse héréditaire, en somme. Abraham doit lui faire honneur, même si son père est tombé dans « la finance ».
Ils lui opposent l’autre champion d’athlétisme du collège, Eric Liddell, écossais né en Chine de parents missionnaires, et voué à poursuivre leur œuvre une fois ses études à Cambridge terminées. Son grand frère et son petit frère l’encouragent ; sa sœur Jennie (Cheryl Campbell) est trop dévote, dans le sens rituel, pour l’approuver. Elle déclare que cela le détourne du Seigneur et de sa mission. Eric lui rétorque qu’il a été créé « rapide » par Dieu lui-même, et qu’il « sent son plaisir » lorsqu’il court. Ce sont en fait les endorphines dégagée par l’effort qui donnent ce sentiment d’euphorie – mais pour un croyant, tout vient de Dieu, même le plaisir qu’il donne « naturellement ».



La première fois qu’ils courent dans une compétition, Liddell bat Abrahams. Celui-ci le prend mal et se désespère d’un jour s’imposer, mais il rencontre Sam Mussabini (Ian Holm), entraîneur professionnel « mi-italien, mi-arabe », dira-t-il au principal du College pour le provoquer. Abrahams s’améliore et Liddell continue à courir jusqu’à ce qu’ils soient tous deux sélectionnés pour représenter le Royaume-Uni aux Jeux de Paris 1924.
Mais Liddell découvre que la compétition du 100 mètres aura lieu un dimanche. Impossible de violer le repos exigé le jour du Seigneur, et il refuse de participer. Sa foi est intransigeante et ses principes doivent être respectés. C’est alors la réunion au sommet du Comité olympique britannique et du prince de Galles (David Yelland) futur Edouard VIII qui abdiquera en 1936. Une solution amiable est trouvée par Lord Andrew Lindsay (Nigel Havers) qui a remporté une médaille d’argent aux 400 mètres haies. Il propose d’intervertir sa place avec Liddell dans la course du 400 mètres le jeudi suivant. Il accepte avec gratitude ce compromis qui met tout le monde d’accord. Cette controverse de principes entre la religion et le sport font les gros titres des journaux. Liddell prononce un sermon à l’église d’Écosse à Paris ce dimanche-là, en citant d’Isaïe 40 : « toutes les nations avant Lui ne sont rien »…


Abrahams a été battu au 200 mètres par les coureurs américains, mais remporte brillamment le 100 mètres. Liddell l’emporte au 400 mètres. Le Royaume-Uni revient triomphant en athlétisme avec ses deux médailles d’or. Les deux garçons, le blond et le brun, diffèrent par leurs valeurs, leurs modes de vie, leurs croyances et leurs comportements, mais concourent chacun à la gloire du collège et de la patrie. Après cet exploit donné au monde par leur courage et leur engagement, ils peuvent retrouver leur vie courante, la petite amie Sybil (Alice Krige) pour Abrahams, qu’il va épouser, et son travail missionnaire en Chine pour Liddell, jusqu’à sa mort à la fin de la Seconde guerre mondiale dans la Chine occupé par les Japonais.

La musique de Vangélis au synthétiseur et piano donnent au film une dimension parfois mystique, rythmant par exemple les foulées des jeunes coureurs pieds nus à l’entraînement en bord de mer, et justifiant le sourire béat des exaltés de l’espoir.
Meilleur film et meilleurs costumes pour Milena Canonero aux British Academy Film Awards 1982
Meilleur film en langue étrangère aux Golden Globes 1982
Meilleur film, meilleur scénario original pour Colin Welland, meilleure musique pour Vangélis et meilleurs costumes pour Milena Canonero aux Oscars 1982
DVD Les Chariots de feu (Chariots of Fire), Hugh Hudson, 1981, avec Ben Cross, Ian Charleson, Patrick Magee (I), Nicholas Farrell, Nigel Havers, 20th Century Fox 2000, doublé anglais, français, 2h03, €9,50
(mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés par amazon.fr)

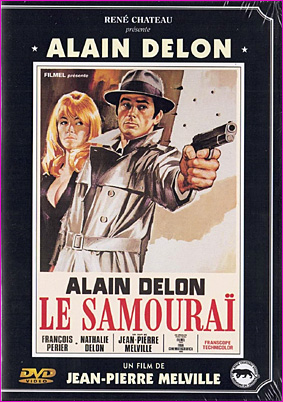











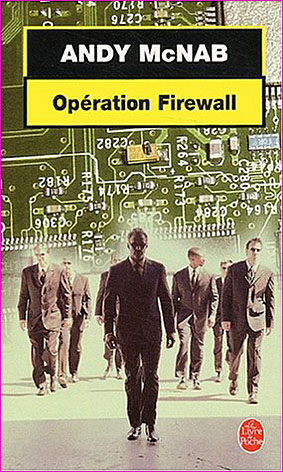
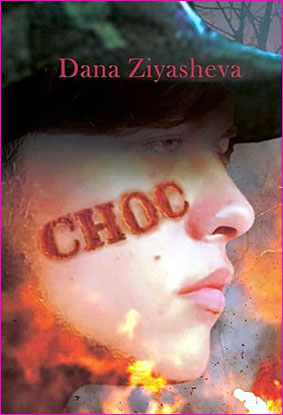









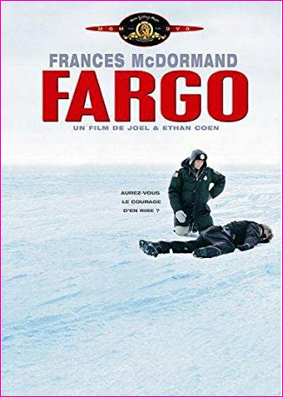






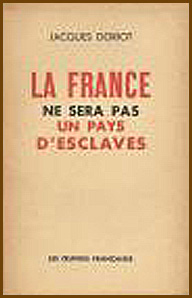


Commentaires récents