 Les romans policiers de Patricia Bourgeau, dite « MacDonald », me laissent un sentiment mitigé. J’admire le professionnalisme de l’intrigue, savamment amenée, conduite avec ce qu’il faut de suspense, sans temps mort. J’aime l’originalité des thèmes, qui change des autres. En revanche, je reste au bord du roman, sans vraiment entrer dans l’histoire. Je n’éprouve aucune empathie pour les personnages. Ils m’apparaissent comme des poupées mécaniques, de simples acteurs jouant un rôle social stéréotypé. Même les héroïnes ne sont pas sympathiques. « Un coupable trop parfait » représente pour cela un progrès : il est sans conteste le meilleur de la série !
Les romans policiers de Patricia Bourgeau, dite « MacDonald », me laissent un sentiment mitigé. J’admire le professionnalisme de l’intrigue, savamment amenée, conduite avec ce qu’il faut de suspense, sans temps mort. J’aime l’originalité des thèmes, qui change des autres. En revanche, je reste au bord du roman, sans vraiment entrer dans l’histoire. Je n’éprouve aucune empathie pour les personnages. Ils m’apparaissent comme des poupées mécaniques, de simples acteurs jouant un rôle social stéréotypé. Même les héroïnes ne sont pas sympathiques. « Un coupable trop parfait » représente pour cela un progrès : il est sans conteste le meilleur de la série !
Dans les histoires MacDonald, il s’agit habituellement d’une femme et mère qui se heurte à l’égoïsme et à la lâcheté des hommes. La femme est bête ; les hommes violents. Chacun joue son rôle : lui de macho qui a des comptes à régler avec sa mère ou son ex-femme ; elle de maman qui « par instinct » et par « convention sociale » défend bec et ongles ses petits, filles ou garçons. Pas trop grands, les garçons – sinon ils passent à l’ennemi ! En général, la femme-et-mère agit sans aucune rationalité, sans mesurer jamais les conséquences de ce qu’elle fait. Son ‘instinct » la propulse dans les ennuis et ce sont les autres qui l’en tirent. Comment voulez-vous trouver sympathiques de telles pétasses en folie ?
« Expiation » (1981) met en scène une ex-taularde (évidemment innocente !) qu’une société villageoise poursuit mystérieusement de sa vindicte.
« Un étranger dans la maison » (1983) narre la stupidité d’une mère qui laisse sans surveillance son bébé de 4 ans ; il est donc enlevé et retrouvé dix ans plus tard, son ravisseur étant bien sûr autre qu’on ne croit.
« Petite sœur » (1986) est le remord d’une grande sœur qui a fait sa vie hors de sa petite ville et de sa famille étriquée ; la mort du père la rapproche de sa sœur de 14 ans, dont le petit-ami de 21 ans (sic !) n’est pas très net.
« Sans retour » (1989) commence par le meurtre d’une adolescente modèle ; l’auteur donne alors toute la mesure de sa haine féministe en créant le personnage du « fils parfait », un éphèbe superbe de 16 ans dont tout le monde est amoureux ou au moins admire.
« La double mort de Linda » (1994) fait ressurgir une mère qui a abandonné sa fille et ce retour remue les turpitudes de la petite ville.
« Une femme sous surveillance » (1995) montre la femme-victime de la communauté, la veuve qui hérite, l’hystérique qui se remarie juste après le meurtre de son premier mari, celle qui vole le petit-fils.
« Personnes disparues » (1997) multiplie les coupables pour cet enlèvement d’un bébé et de sa baby-sitter adolescente ; les hommes seront malmenés, comme d’habitude, même si le coupable réel n’est pas celui qu’on croit.
« Dernier refuge » (2000) donne à voir la fille naïve qui croit trouver le grand amour à chaque mâle qui s’intéresse à elle ; et tout père qui se préoccupe beaucoup de ses enfants ne peut qu’être suspect pour la MacDonald – c’est le rôle de la « femme-mère », voyons, dans la culture américaine !
C’est ce parti-pris qui agace, au fond. Que chacun soit cantonné dans ses rôles par une société conventionnelle, au point de ne pas pouvoir en sortir autrement qu’en côtoyant la mort. Que chacun soit élevé de façon si étriquée qu’il finisse par confondre « ce qui se fait » avec « ce qui se doit », et les conduites éduquées avec des conduites « naturelles », « instinctives ».
« Un coupable trop parfait » (2002), renouvelle un peu le genre. Il s’agit toujours d’une épouse et mère, agissant « à l’instinct » – ou du moins selon les convenances qu’elle met sous ce nom. Comme d’habitude, elle ne se sent nullement en cause, elle n’a « pas de chance » : son premier mari se suicide sans rien laisser prévoir ; son second mari se noie dans sa propre piscine. A chaque fois, l’épouse-et-mère est absente, préoccupée de fanfreluches ou autres attraits superficiels de l’existence. Mais, cette fois, le héros du roman n’est pas la mère. C’est le fils, un petit garçon de huit ans d’abord traumatisé d’avoir découvert mort son père ; devenu adolescent de quatorze ans qui s’entend mal avec son beau-père et reste maladroit avec son bébé sœur.
Dylan est fragile… et plus fort qu’on ne croit. Il fait d’ailleurs un coupable tout désigné pour la vindicative procureur, ex-amoureuse du beau-père. Dylan remet en question le vernis de « bonne mère » et les hypocrisies adultes – notamment de tous ceux qui sont investis d’autorité : profs, flics et psychiatres. Dylan est sain, au fond : il rigole du féminisme imbécile qui court l’esprit américain ; il devient mâle en découvrant que ses père, beau-père et grand-père ne sont pas si nets que ça ; il choisit son troisième « père » sur la fin ; il prend les choses en mains, puisque sa mère est incapable.
Il y a du progrès dans la peinture des gens réels, Patricia, continuez ! Vous ferez moins de MacDo insipides et plus de vrais romans.
Patricia MacDonald, Un coupable trop parfait (Not Guilty), 2002, Albin Michel, 450 pages, €19.86 (et occasion €2.00)





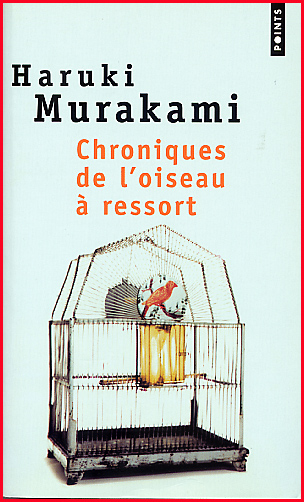





Commentaires récents