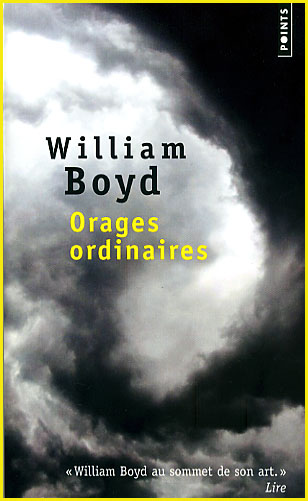 Nous sommes à Londres après la crise financière. Un jeune anglais divorcé d’une jument hystérique américaine (pléonasme) revient dans son pays pour trouver un poste de chercheur en climatologie. Il sort à peine d’un entretien lorsqu’il lie connaissance avec un convive dans un restaurant. Une brève conversation s’échange, le quidam acquitte son addition et quitte la salle. Il a oublié un dossier sur son siège. Comme tout le monde, Adam Kindred, le jeune chercheur, veut lui rapporter. Rendez-vous est convenu le soir même par téléphone. Lorsqu’Adam arrive à la résidence sécurisée de l’oublieux, il laisse son nom et son adresse à l’entrée, monte à l’étage, voit la porte entrouverte, puis son interlocuteur un couteau à pain planté dans la poitrine qui lui fait signe d’approcher…
Nous sommes à Londres après la crise financière. Un jeune anglais divorcé d’une jument hystérique américaine (pléonasme) revient dans son pays pour trouver un poste de chercheur en climatologie. Il sort à peine d’un entretien lorsqu’il lie connaissance avec un convive dans un restaurant. Une brève conversation s’échange, le quidam acquitte son addition et quitte la salle. Il a oublié un dossier sur son siège. Comme tout le monde, Adam Kindred, le jeune chercheur, veut lui rapporter. Rendez-vous est convenu le soir même par téléphone. Lorsqu’Adam arrive à la résidence sécurisée de l’oublieux, il laisse son nom et son adresse à l’entrée, monte à l’étage, voit la porte entrouverte, puis son interlocuteur un couteau à pain planté dans la poitrine qui lui fait signe d’approcher…
C’est ainsi qu’un jeune homme se trouve embarqué dans une histoire qui pourrait arriver à n’importe qui. Tout laisse soupçonner qu’il est le meurtrier, y compris sa panique en entendant du bruit sur le balcon. Rentré à son hôtel, ne voilà-t-il pas qu’un inconnu dans la rue l’interpelle ? Il ne se laisse pas faire et va désormais entrer dans l’ombre. Comment faire pour disparaître ? Dans une grande ville comme Londres, c’est assez facile : il suffit de ne plus être immatriculé nulle part. Exit téléphone portable, carte bancaire, compte en banque, carte de transport, immatriculation de véhicule, adresse, sécurité sociale. Quand vous n’êtes plus aucun des numéros, vous n’existez plus. Vous passez sous le radar du système. Vous êtes un sans domicile fixe, vivant d’expédients, mais libre et invisible.
Être intelligent ne nuit en rien à la clochardise, au contraire ! Adam trouve un square coincé à l’entrée d’un pont d’un quartier chic. Un buisson le rend invisible à tout le monde, très proche et ignoré à la fois. Mendier le rend presque riche, fréquenter une « église » parmi toutes celles qui pullulent permet un repas chaud (après un interminable sermon) et des rencontres utiles. Se laver dans les toilettes des gares, même payantes pour la totale, est à la portée de n’importe qui. C’est ainsi que l’on se reconstruit une identité, que l’on échappe aux préjugés policiers et – surtout ! – aux officines privées qui vous cherchent pour vous faire disparaître pour d’obscures raisons.
William Boyd côtoie sans cesse le roman policier dans ce roman littéraire. Il continue d’analyser la société anglaise, désormais hantée de fric, égoïste et médiatique au point que quiconque ne joue pas le jeu disparaît de la scène officielle en un clin d’œil. La différence avec le genre policier est que sa conclusion reste romanesque : pas de fin à l’enquête ni aux personnages. Ils sont laissés en plan sans conclusion. On ne sait même pas si ni pourquoi certaines officines des services secrets étaient impliquées. Tout reste possible, au contraire du happy end des thrillers ou des enquêtes dans le modèle consacré. Adam Kindred se trouve mêlé malgré lui à une affaire de tests en phase III pour homologuer un médicament attendu contre l’asthme. Des morts inexpliquées de cobayes, des enfants humains, pourraient compromettre le dossier. Est-ce pour cela que le chercheur responsable a été tué ? Kindred, pour sa seule défense, va chercher à fouiller, regarder l’informatique d’hôpital, impliquer un journaliste, jouer sur Internet, manipuler le système boursier… C’est l’ensemble du réseau alternatif qu’il va actionner pour échapper à la toile officielle qui cherche à l’immobiliser.
Adam Kindred est un universitaire spécialiste des nuages, qu’il sait faire tomber en pluie. Il aime les femmes et ne résiste pas à baiser qui lui plaît, après les préliminaires de sa génération. Il n’est pas indifférent aux enfants et ne peut s’empêcher de savoir ce qu’est devenu celui qu’il a apprivoisé et dont la mère, une demandeuse d’asile pakistanaise faisant la pute, l’a aidé et en est morte. Son nom, Kindred, signifie similaire, parenté, ressemblance. Autrement dit le parfait quidam, interchangeable, dans la société réduite des années 2000. Et pourtant la société hyper individualiste, égocentrée, à l’élitisme friqué et qui court à la catastrophe sans le savoir, comme un Titanic du XXIe siècle, recèle bien des surprises. « A savoir que les myriades de liens entre deux existences discrètes – proches, distantes, se chevauchant, se frôlant – sont là presque entièrement inconnues, inaperçues, un immense réseau invisible de l’à-peu-près, du quasiment, de ce-qui-aurait-pu-être. De temps en temps, dans la vie de tout un chacun, le réseau est entrevu, un court instant, et l’événement reconnu avec un cri d’étonnement ravi ou un frisson d’inconfort surnaturel » p.493.
Un bon roman, avec une histoire, une psychologie, de l’action, qui se lit avec fluidité.
William Boyd, Orages ordinaires, 2009, Points Seuil avril 2011, 498 pages, €7.60
Existe aussi en audio-livre, 2CD, Audiolib, octobre 2010, €21.85




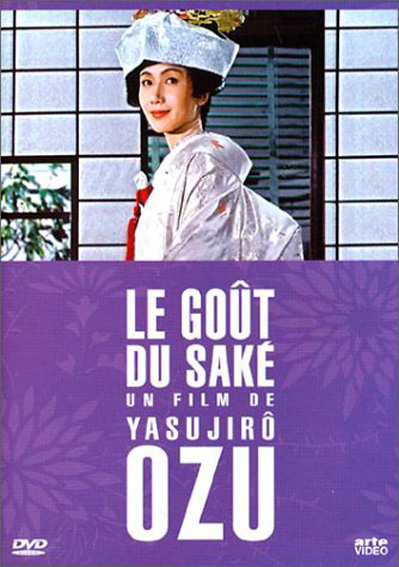










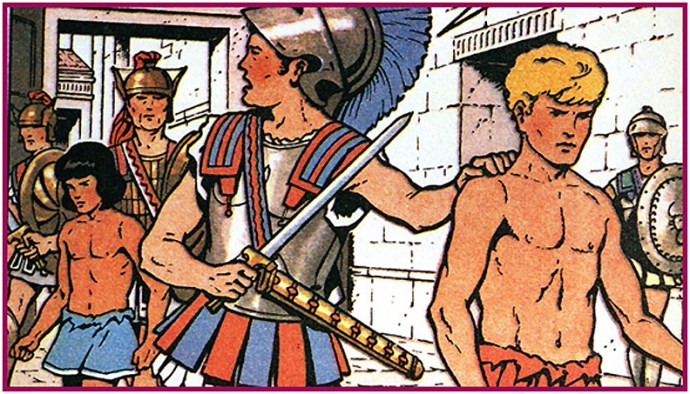


Commentaires récents