 Être amoral n’est pas être immoral ; ce n’est pas transgression de dire que le bien en soi n’existe pas, mais saine lucidité. Or, « c’est parce que le bien n’existe pas qu’il faut le faire » II.10. Tout n’est pas permis sous prétexte qu’il n’est ni Bien ni Mal dans l’immuable, ou commandé par un grand ordonnateur qu’on appelle Dieu. Je ne me permets pas tout car tout ne serait pas digne de moi. « Ma morale est cette dignité et cette exigence » II.14. Le nihilisme moral qui saisit notre époque où « tout se vaut » et où tous se vautrent, où tout s’excuse parce que tout peut s’expliquer, où la fameuse « tolérance » n’est qu’indifférence aux désirs des autres comme dans les maisons pour ça, la tolérance qui met tout le monde sur le même plan indulgent et relatif, n’est pas acceptable. Il n’y a pas de destin, on peut toujours faire autrement, chacun est donc toujours responsable. « Je suis libre de faire ce que je fais, selon Lucrèce, non parce que ma volonté serait indéterminée, mais parce qu’elle n’est déterminée, à chaque instant, que par l’état présent de mon corps (désirs, clinamen) et du monde (simulacres) ». Détermination de la volonté à la fois nécessaire (dans l’instant) et aléatoire dans le temps).
Être amoral n’est pas être immoral ; ce n’est pas transgression de dire que le bien en soi n’existe pas, mais saine lucidité. Or, « c’est parce que le bien n’existe pas qu’il faut le faire » II.10. Tout n’est pas permis sous prétexte qu’il n’est ni Bien ni Mal dans l’immuable, ou commandé par un grand ordonnateur qu’on appelle Dieu. Je ne me permets pas tout car tout ne serait pas digne de moi. « Ma morale est cette dignité et cette exigence » II.14. Le nihilisme moral qui saisit notre époque où « tout se vaut » et où tous se vautrent, où tout s’excuse parce que tout peut s’expliquer, où la fameuse « tolérance » n’est qu’indifférence aux désirs des autres comme dans les maisons pour ça, la tolérance qui met tout le monde sur le même plan indulgent et relatif, n’est pas acceptable. Il n’y a pas de destin, on peut toujours faire autrement, chacun est donc toujours responsable. « Je suis libre de faire ce que je fais, selon Lucrèce, non parce que ma volonté serait indéterminée, mais parce qu’elle n’est déterminée, à chaque instant, que par l’état présent de mon corps (désirs, clinamen) et du monde (simulacres) ». Détermination de la volonté à la fois nécessaire (dans l’instant) et aléatoire dans le temps).
L’indéterminisme n’est pas le libre-arbitre ; celui-ci est une illusion. La nature est aveugle et la réalité de l’homme se réduit à ce qu’il fait. Le moi n’est pas un être mais une histoire : ce qu’il fait le fait ; il ne saurait ni le choisir ni y échapper. Mais il est comme il veut et il veut comme il est (Schopenhauer). Le présente seul existe et l’action n’est que dans l’instant. Le bouddhisme zen s’entraîne au vide (qui n’est rien) pour se défaire de l’illusion du moi et du temps, afin de s’ouvrir à ce qui survient, de faire corps avec l’agir, toujours au présent. Il s’agit d’être ici et maintenant, pleinement celui qui agit, en pleine lumière, en harmonie. La volonté est le désir lui-même, mais en tant qu’il agit. Mon désir fait le tri : il y a un « goût » éthique et moral, le bien est ce qui fait plaisir sans nuire aux autres, l’éducation et la société font le reste. Car toute morale est historique : il n’y a ni Bien ni Mal en valeur absolues mais seulement du bon et du mauvais en valeurs particulières toujours relatives à l’époque et au lieu.
La morale est une illusion, mais nécessaire et bienfaisante (Spinoza). « Le sage, parce qu’il est sage, désire la sagesse pour autrui et, parce qu’il est heureux, le bonheur (pour autant que faire se peut) pour tous. Ainsi agit-il en conséquence, et cela est la moralité même » II.104. Toute joie est bonne et toute tristesse mauvaise. « Le sage ne fait que suivre jusqu’au bout la logique du désir qui est de joie, mais doit pour cela le soumettre à la logique de la raison, qui est de paix » II.107. « Le bien, au fond, c’est le désirable – mais, par la raison, libéré du sujet : le désir se soumet alors non au moi, mais au vrai, lequel est toujours singulier (il n’y a pas de ‘vérités générales’) mais aussi, étant vrai pour tous, toujours universel » II.108. La raison, commune à tous, universalise les valeurs propres à l’humain ; elle en fait la culture et la loi. « On passe alors de l’égoïsme (le désir sans raison, enfer né de sa particularité) à la vertu (le désir raisonnable, ouvert à l’universel) » II.108. Où l’on retrouve « la belle vertu grecque, généreuse et fière toujours ».
L’éthique ne s’oppose pas à la morale mais est sa vérité. La morale n’est pas le contraire de l’éthique mais son illusion. L’homme n’a que la morale qu’il s’invente, qu’il se mérite – ce qui ne va pas sans effort. La morale est joyeuse mais point toujours facile. Repère : « Agis de telle sorte que tu puisses rester l’ami de tes amis, des gens de bien et de toi-même » II.131. Traduit en langage philosophique, cela donne : « Anti-humanisme théorique, donc, et humanisme pratique : la notion d’homme n’explique rien (l’humanité n’est pas la cause de soi, ni l’homme sujet libre de ses actes) mais, réfléchie, constitue un ‘modèle’ qui vaut d’être défendu. Il ne s’agit pas de cesser d’être homme (en devenant cheval ou surhomme) mais de le devenir au mieux. L’humanité n’est pas un fait biologique (ce qu’il y a de naturel en l’homme n’est pas humain) mais une valeur culturelle » II.135. Homo homini deus.
L’amour est généreux par définition et moral par excellence. Lui seul réconcilie le désir et la loi. La seule éthique est l’amour tout court et tout entier, la joie pleine, consciente de soi et de sa cause, qui libère de la loi. La seule vraie morale est l’amour du prochain (Spinoza), amour imparfait, et moral pour cela : nul impératif ne saurait ordonner d’aimer, mais d’agir comme si on aimait. C’est raison, donc vertu – et libère des moralistes.
Seule l’action est réelle ; vouloir, c’est agir. La morale est une solitude qui s’érige en exigence universelle, nécessaire et bienfaisante : c’est le chef-d’œuvre de vivre. Et Comte-Sponville a cette phrase très nietzschéenne – Nietzsche que, pourtant il n’aime pas, trop sensible aux déviations que l’on en a fait – : « Tu es, à chaque instant, ce que tu penses, veux ou fais (…) Tu vaux, exactement, ce que tu veux » II.148.
Le commun habille de sens la vérité pour la supporter, l’apprivoiser. Le matérialisme joue la vérité contre le sens, le silence de la nature contre le bavardage des prêtres : n’interprète pas, applique-toi à connaître. Cette conception rejoint le bouddhisme qui ne croit qu’au non-sens (l’aucun sens, qui n’a rien à voir avec le nonsense, le sens détourné , retourné). Le désir crée le manque, le discours le met en forme, le fait exister en le nommant. Dieu nait du devenir-sens du désir. La prière crée Dieu, non l’inverse. Où Pascal avait raison. Le contraire du sens, auquel je crois, est le grand « oui » au réel. « Le rire est médiation : ce qui fait rire, c’est ce qui fait semblant d’avoir un sens, semblant de valoir, semblant d’être sérieux » II.193. Le rire fait place nette à la vérité en se moquant du sens supposé – car toute parole vraie a le silence pour objet. La vraie réponse est qu’il n’y a pas de question ; le vide du sens c’est le plein de l’être, et le présent de toute éternité.
« Les vérités qu’on ignore ne sont pas moins vraies que celles qu’on connait ni (en elles-mêmes) plus mystérieuses ou intéressantes. C’est où le sage, on l’a compris, se distingue du savant : celui-ci cherche la connaissance, celui-là se contente (à tous les sens du terme) de la vérité. Et puisque tout est vrai, toujours, partout – ce caillou, cette fleur, et même cette erreur vraiment fausse, cette illusion vraiment illusoire – le sage se contente, modestement, de tout, et tout le contente. La vérité n’est pas ce qu’il cherche, ni même ce qu’il connait, mais joyeusement ce qu’il aime et qui le contient » II.200.
Le « oui » au réel n’est pas l’hébétude du no future mais la confiance : ce présent même, renforcé par la certitude de sa joyeuse et sereine continuation. Epicure : ce n’est pas le jeune qui est bienheureux, mais le vieux qui a bien vécu. « Le sage est sans pourquoi, vit parce qu’il vit, n’a souci de lui-même, ne désire être vu » II.247. La vie n’est pas à interpréter mais à vivre ; le réel n’est pas à comprendre mais à connaître. La vérité ne se distingue du réel que pour l’esprit seul, qui se souvient, anticipe et compare ; il disjoint ainsi le temps qui, dans les faits, se confond au présent. Le temps n’est rien qu’imagination ; il n’est que le présent qui est l’éternité même. « La sagesse n’est pas un but (plutôt : elle n’est un but que pour les fous), ni un idéal (elle n’est un idéal que pour les niais). C’est la vérité de vivre, disais-je, laquelle, en tant qu’elle est vraie ou éternelle, n’attend rien, ne vaut rien, et ne veut rien dire (…) Moins tu t’occupes de la sagesse, plus tu t’en rapproches, et tu ne l’atteindras peut-être qu’en désespérant tout à fait (…) Vivre en vérité, ce n’est pas vivre une autre vie, c’est vivre autrement la même vie que tous » II.280.
Et cela encore qui est un parfait résumé du Traité et qu’il faut citer en entier : « Tout se tient ici : l’éthique (se désillusionner de soi, de l’avenir et de tout), la morale (cesser de mentir), la métaphysique ou l’ontologie (l’éternité du réel et du vrai)… Et ce tout est la sagesse : la vraie vie c’est la vie vraie. Qu’est-ce à dire ? Rien que de très simple, et que chacun connaît ou peut expérimenter. Vivre en vérité, c’est vivre sa vie – et jusqu’à ses rêves – au lieu de la rêver ; c’est agir au lieu de prier, rire au lieu d’espérer, connaître au lieu d’interpréter… Aimer, surtout, au lieu de juger : aimer et accepter au lieu de juger et détester. Et crier quand on a mal, et rêver quand on rêve… Infinite love, infinite patience… L’éternité c’est maintenant et il n’y en a pas d’autre. Le salut ne consiste pas à devenir éternel (expression bien-sûr contradictoire, et c’est pourquoi la béatitude ne peut être dite commencer que ‘fictivement’), mais à comprendre que nous le sommes » II.285.
Ne rien espérer, mais tout vivre. Seul le réel (matérialisme) et le présent (désespoir) existent. Ouverture à la présence : il n’y a plus que la vie, la vérité et l’amour. Le renoncement à l’esprit spéculatif fait place nette au bonheur (il est acceptation de l’ici) et à la béatitude (éternité du maintenant).
J’adhère pleinement à ce discours qui décape de toute illusion. Apollon l’ardent, le lucide, l’éclairant, a toujours été mon dieu préféré.
André Comte-Sponville, Traité du désespoir et de la béatitude, 1 Le mythe d’Icare, 2 Vivre, PUF Quadrige 2016, 720 pages, €19.00 e-book Kindle €14.99
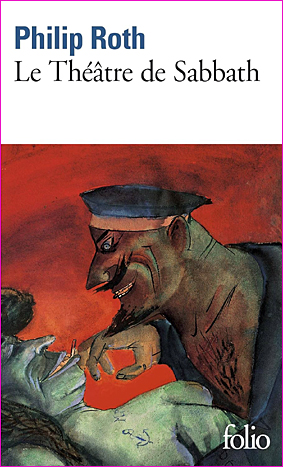


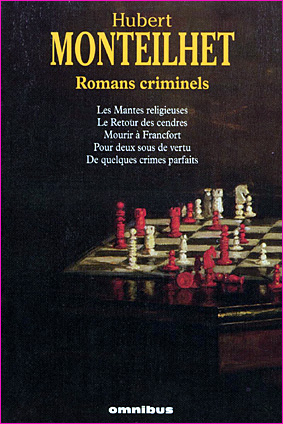
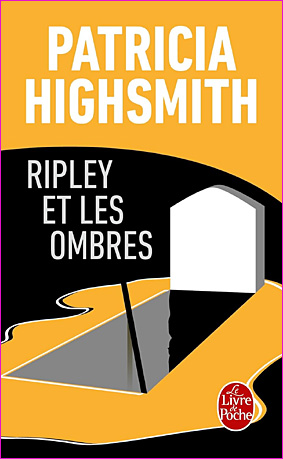
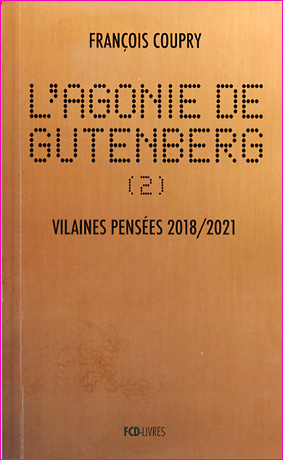
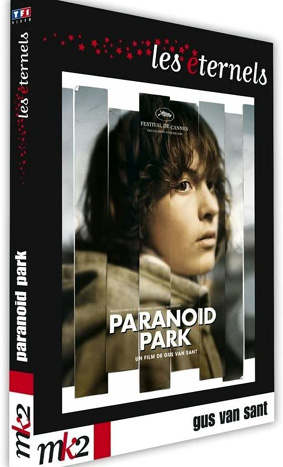






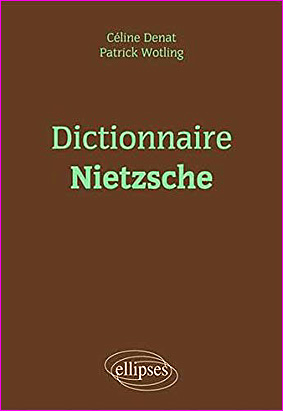

Commentaires récents